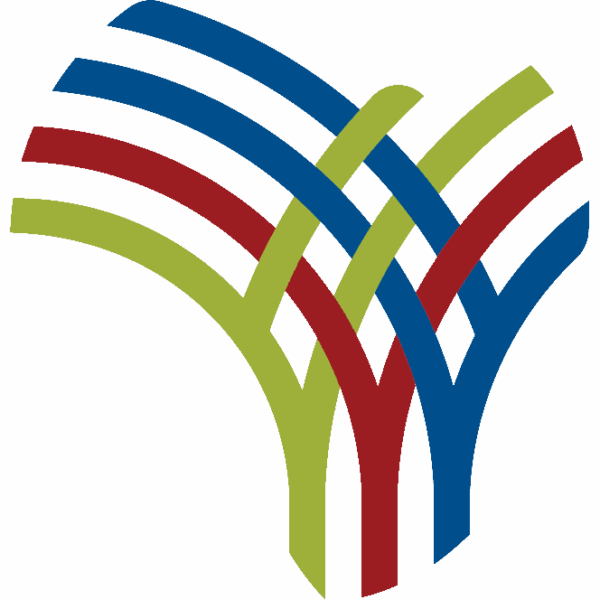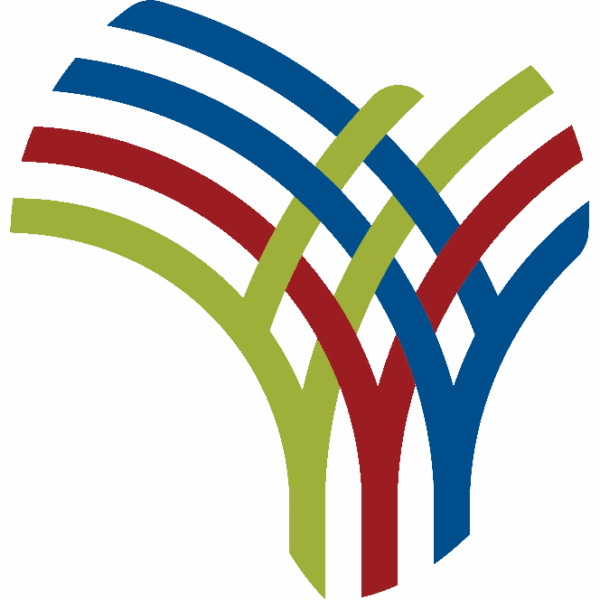Tunisie: Un équilibre fragile entre finances publiques et justice sociale

Les besoins de financement et la recherche d’un équilibre budgétaire sont devenus des arguments récurrents dans les lois de finances tunisiennes. Mais derrière ces impératifs macroéconomiques, ce sont les citoyens — et plus particulièrement leur pouvoir d’achat — qui en supportent les effets les plus directs.
Depuis plusieurs années, le poids croissant du système fiscal, combiné à la dégradation progressive des services publics, alimente un mécontentement social persistant et une remise en cause du modèle fiscal tunisien.
Ce malaise traduit une réalité : la politique budgétaire, censée garantir la solidarité nationale, semble aujourd’hui peser davantage sur les ménages que sur la performance économique de l’Etat.
La charge fiscale sur les salariés: un fardeau croissant
Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres
Depuis 2017, les lois de finances ont multiplié les mesures qui alourdissent la charge des salariés. La révision du barème de l’impôt sur le revenu des personnes physiques, combinée à la limitation de la déductibilité des frais professionnels à 2.000 dinars (au lieu de 10 % du salaire brut sans plafond), a réduit les marges de déduction et renforcé la pression sur les revenus moyens.
À cela s’est ajoutée en 2018 la contribution sociale solidaire (CSS), instaurée au taux de 1 % du salaire imposable pour les salariés et du revenu net imposable pour les autres personnes physiques.
Conçue à l’origine comme temporaire, elle a été reconduite et intégrée dans la durée, aggravant encore le poids fiscal.
L’inflation persistante a accentué ce phénomène. Alors que les prix ne cessent d’augmenter, les tranches d’imposition n’ont pas été réajustées pour tenir compte de l’érosion monétaire. Résultat : de nombreux salariés voient leurs revenus taxés à des taux plus élevés, sans aucun gain réel de pouvoir d’achat.
S’y ajoutent encore la contribution conjoncturelle, maintenue plusieurs années de suite, et l’élargissement du champ de la TVA, parfois accompagné d’une hausse des taux. Autant de mesures cumulatives qui réduisent le revenu disponible des ménages.
Des services publics affaiblis : la double peine des ménages
À cette pression fiscale croissante s’ajoute une autre réalité : la dégradation des services publics.
Santé, transport, enseignement, autant de secteurs essentiels où la qualité des prestations a reculé.
Les ménages doivent donc compenser par leurs propres moyens, en recourant à des écoles privées, à des soins coûteux ou à des transports alternatifs. Cette substitution, qui devrait normalement être couverte par l’impôt qu’ils paient, se traduit par des dépenses supplémentaires, souvent financées par l’endettement.
C’est une contradiction flagrante : alors que la pression fiscale augmente pour équilibrer les finances publiques, la qualité des services financés par ces impôts recule, transférant une part du coût directement sur les familles.
Lois de finances 2025 et 2026 : acquis fragiles et menaces
La révision du barème de l’impôt sur le revenu dans la loi de finances 2025 a été saluée comme un acquis, marquant un allégement significatif de la pression fiscale pour la classe moyenne. Mais une question demeure : la loi de finances 2026 préservera-t-elle cet acquis en ajustant les tranches d’imposition à l’inflation et à l’évolution du coût de la vie ?
Les orientations budgétaires pour 2026 annoncent, en effet, une logique d’austérité. Celle-ci ne se traduira pas par une hausse directe de l’impôt, mais par des restrictions salariales pour les fonctionnaires : seuls 40 % des agents éligibles pourront bénéficier d’une promotion. Une mesure qui prive la majorité d’augmentations pourtant légitimes, accentuant le sentiment d’injustice et fragilisant davantage la classe moyenne.
L’« inflation creep » : un impôt caché
Lorsque l’inflation fait grimper les salaires nominaux — le revenu affiché en dinars — sans ajustement parallèle des tranches fiscales, les contribuables basculent mécaniquement dans des tranches supérieures. Ce phénomène, connu sous le nom d »‘inflation creep » ou glissement fiscal, agit comme un impôt invisible : les ménages paient plus, mais n’ont pas plus dans leur panier.
Ce que font d’autres pays
Pour éviter ce piège, plusieurs pays ont instauré des mécanismes d’indexation automatique :
France : revalorisation annuelle du barème de l’impôt sur le revenu en fonction de l’indice des prix à la consommation.
Etats-Unis : ajustement annuel par l’IRS des seuils d’imposition, crédits d’impôt et déductions pour neutraliser l’effet de l’inflation.
Canada : indexation systématique du barème fiscal par le gouvernement fédéral et la majorité des provinces.
Maroc : depuis 2023, une réforme a introduit une révision progressive du barème de l’IR pour limiter l’impact de l’inflation sur les ménages.
Ces pratiques permettent aux Etats de maintenir leurs recettes fiscales tout en évitant d’asphyxier le contribuable.
Recommandations pour la Tunisie
Pour restaurer l’équilibre entre équité sociale et viabilité budgétaire, plusieurs pistes s’imposent :
Instaurer une indexation automatique des tranches d’imposition sur l’inflation.
Réévaluer la déduction des frais professionnels, en l’adaptant à l’évolution réelle du coût de la vie.
Renforcer la qualité des services publics (santé, éducation, transport), afin de réduire les dépenses directes supportées par les ménages.
Renoncer aux mesures d’austérité ciblant les fonctionnaires, qui alimentent les inégalités et érodent la confiance dans l’Etat.
Promouvoir un dialogue fiscal inclusif et transparent, pour que les réformes soient comprises, acceptées et perçues comme justes.
Conclusion
La question du pouvoir d’achat ne se limite pas à des mesures ponctuelles d’allégement fiscal. Elle appelle une réforme structurelle qui concilie équité, efficacité et transparence.
Tant que l’impôt pèsera davantage sur les classes moyennes, sans contrepartie réelle en services publics, la défiance envers le système fiscal continuera de grandir.
Restaurer la confiance suppose d’abord de rendre la fiscalité plus juste, plus lisible et mieux adaptée à la réalité du coût de la vie.
N.B. : L’opinion émise dans cette tribune n’engage que son auteur. Elle est l’expression d’un point de vue personnel.