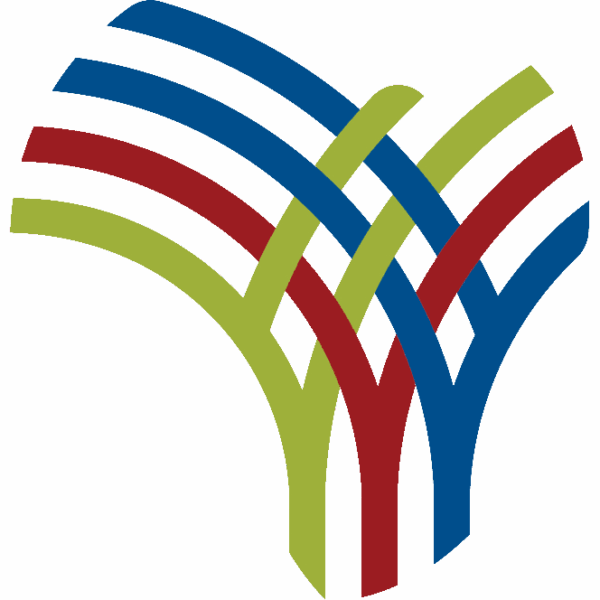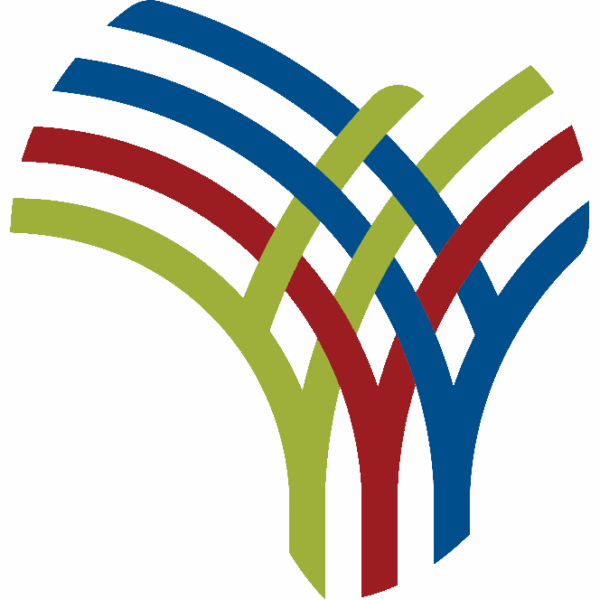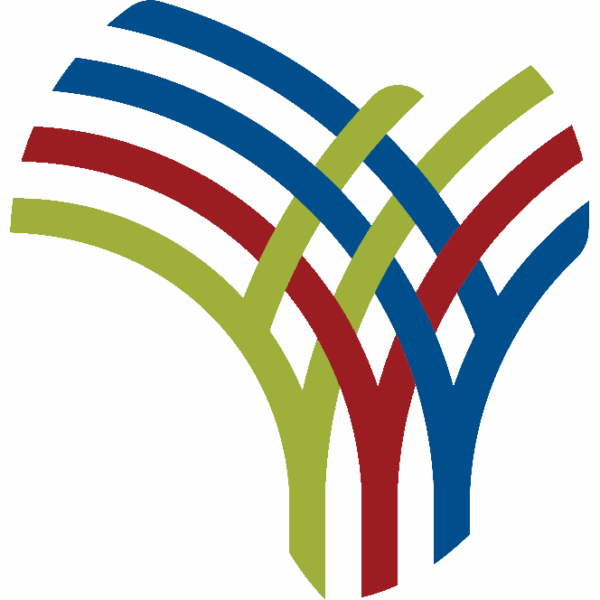Tunisie: Affaire de piratage de la plateforme de l'orientation – Punir ou reconstruire, le choix crucial de la justice

Un piratage inédit de la plateforme nationale d’orientation universitaire a bouleversé le destin d’une douzaine de bacheliers. A la manoeuvre, un adolescent recalé au bac 2025, aujourd’hui sous le coup de huit mandats de dépôt. Faut-il le condamner à vie pour une faute grave ?
Huit mandats de dépôt ont été émis contre un élève soupçonné d’avoir piraté la plateforme d’orientation dans le but de modifier les données d’orientation de douze bacheliers. L’adolescent, recalé au baccalauréat 2025, a été placé en garde à vue. Lors de son interrogatoire, il a reconnu avoir modifié un certain nombre de fiches d’orientation, tout en affirmant qu’il n’avait pas l’intention de nuire directement à ses camarades.
Parmi les douze bacheliers touchés par cette affaire, figure Mohamed Abidi, lauréat brillant qui avait obtenu la moyenne exceptionnelle de 18 au baccalauréat. Il avait légitimement postulé pour une filière prestigieuse, Médecine ou Pharmacie, mais a été orienté vers un choix qu’il n’avait pas formulé, conséquence directe des manipulations subies par la plateforme d’orientation universitaire.
Ce cas symbolise à lui seul l’injustice infligée à des étudiants qui avaient travaillé dur pour décrocher leur place, et dont l’avenir a été bouleversé par un acte illégal mais surtout lourd de conséquences. Et les conséquences sont bien là ; plusieurs élèves, dont certains au parcours académique remarquable, ont été dirigés vers des filières qui ne correspondaient pas à leurs aspirations, malgré l’obtention des notes nécessaires pour atteindre leurs objectifs.
L’enquête, confiée à la cinquième Brigade de lutte contre la cybercriminalité de la Garde nationale de l’El Aouina, a rapidement permis d’identifier et de localiser le pirate.
Le suspect serait un élève ayant échoué aux épreuves du baccalauréat, a affirmé, mardi 12 août 2025, le porte-parole et substitut du procureur de la République près le Tribunal de première instance du Kef, Yosri Houami. Il a précisé qu’il avait été interpellé, placé en garde à vue et que huit mandats de dépôt avaient été émis à son encontre. La garde à vue a été prolongée de 48 heures. Il encourt « une peine qui peut atteindre dix ans pour chacune des huit affaires. »
La sévérité des lois tunisiennes en question
Si l’acte commis est grave et doit être sanctionné, il est légitime de s’interroger sur la nature et la proportionnalité de la peine encourue. Dans l’état actuel du droit tunisien, les dispositions prévues pourraient envoyer ce jeune homme en prison pour 80 ans, ouvrant la voie à un cycle de marginalisation et de ruine sociale. Le piège s’est refermé sur lui, et une chape de plomb s’est abattue sur sa tête. Impossible d’y échapper.
Pour rappel, la justice, dans sa mission fondamentale, ne se limite pas à punir, elle doit aussi permettre la réhabilitation. Or, ici, la peine privative de liberté telle qu’elle se dessine pourrait non seulement détruire à jamais l’avenir du jeune contrevenant, mais également infliger un traumatisme durable à sa famille. Une telle sanction extrême ressemble davantage à un châtiment moyenâgeux qu’à une mesure moderne visant à protéger la société tout en corrigeant le contrevenant.
Punir sans anéantir
Tout citoyen a droit à une seconde chance, sauf dans le cas de crimes d’une gravité exceptionnelle. Dans le dossier du jeune hackeur, priver la société de sa contribution potentielle pour le reste de sa vie n’apportera aucun bénéfice concret.
On aura anéanti un potentiel, désespéré une famille et perdu un citoyen qui, bien encadré, pourrait devenir un atout pour le pays. Une sanction doit viser à ce que la leçon soit retenue, mais elle ne doit pas condamner à l’exclusion définitive. En emprisonnant ce jeune homme pour des décennies, la société risque de transformer une erreur grave mais réversible en condamnation sans retour.
Un talent à canaliser
Ce qui interpelle dans cette affaire, c’est que l’élève a réussi, seul, à contourner un système informatique protégé à l’échelle nationale. Cette performance technique, même illégale, témoigne d’un haut niveau de compétence et d’une capacité de réflexion stratégique rare pour un adolescent. Cela ne justifie pas l’acte, mais démontre qu’il possède un potentiel qui, bien dirigé, pourrait être utile à la collectivité.
Plutôt que de l’enterrer sous une peine disproportionnée, pourquoi ne pas envisager des solutions alternatives ? Ce jeune pourrait être intégré dans un programme officiel de formation en cybersécurité, placé sous un contrôle strict et avec l’obligation de mettre ses compétences au service de l’État.
Il pourrait repasser son baccalauréat, terminer ses études et s’engager, sous supervision, dans des missions de protection des données publiques. La Tunisie manque cruellement de profils spécialisés en sécurité informatique. Transformer ce pirate en défenseur des systèmes numériques serait non seulement une mesure intelligente, mais aussi un symbole fort : celui d’un pays capable de transformer une faute en opportunité.
La justice comme outil de reconstruction
Cette affaire nous oblige à nous interroger sur le sens profond de la justice. Une justice véritablement intelligente ne se contente pas de frapper fort pour dissuader. Elle sait aussi réparer ce qui a été brisé, redonner une direction à ceux qui se sont égarés, et tendre une main pour les ramener vers la société.
Ce jeune, qui a franchi une ligne rouge, a également révélé, à travers son geste, un talent brut et une capacité rare. Le réduire à sa faute, c’est nier tout ce qu’il pourrait devenir. L’opinion publique, bouleversée par la gravité des faits, pourrait l’être tout autant par un choix audacieux ; celui de sauver un talent plutôt que de l’éteindre.
Imaginer un tribunal dire à un adolescent : « Tu as détourné ton intelligence dans un but illégal, nous allons t’apprendre à la mettre au service du bien commun », c’est imaginer une Tunisie qui croit en la rédemption et en la valeur de chaque citoyen, même défaillant.
Donner à ce jeune l’occasion de se reconstruire, c’est envoyer un message fort : la société ne se résigne pas à perdre ses enfants, même quand ils se trompent de chemin. C’est montrer que la justice n’est pas un couperet définitif, mais un outil pour façonner des avenirs meilleurs. Et peut-être qu’un jour, celui que l’on appelle aujourd’hui « le hackeur du Kef » pourrait devenir un protecteur des données du pays, un professionnel respecté, et la preuve vivante qu’une seconde chance donnée au bon moment peut tout changer.