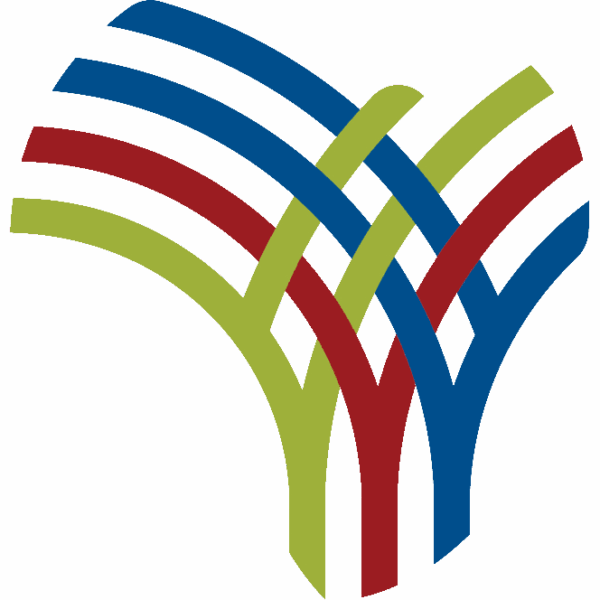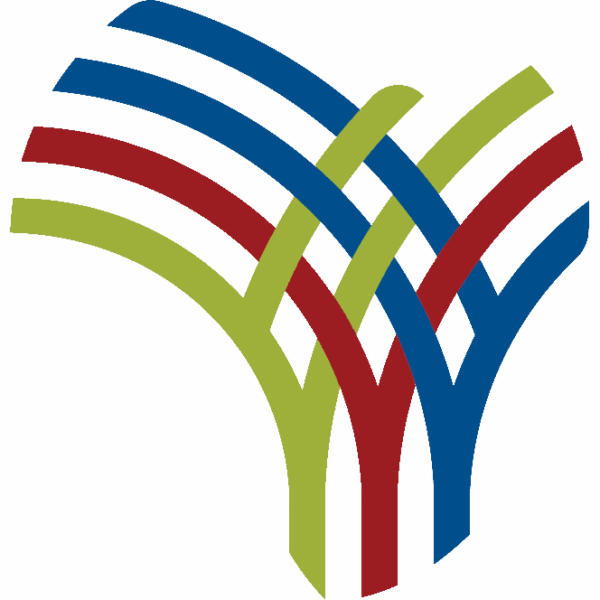Sénégal: Un sociologue relève l'actualité de la pensée du professeur Amadou-Mahtar Mbow

Dakar — L’héritage du professeur Amadou-Mahtar Mbow, auquel le Sénégal rend un hommage national ce mardi, demeure d’une brûlante actualité, au regard de certains enjeux contemporains relatifs à l’éducation, au numérique et à la souveraineté intellectuelle, estime le sociologue Mahamadou Lamine Sagna.
Dans un entretien avec l’APS, à l’occasion de cet hommage national, M. Sagna, directeur du programme Africana Studies à Worcester Polytechnic Institute, aux États-Unis d’Amérique, invite à relire Amadou-Mahtar Mbow comme « une boussole morale » face aux défis contemporains de l’éducation, du numérique et de la souveraineté intellectuelle.
« De Louga à Paris, en passant par Dakar, Amadou-Mahtar Mbow fut de tous les combats. Il nous apprend l’humilité et le courage – des vertus forgées dès sa tendre enfance », se souvient Mahamadou Lamine Sagna, l’un de ses anciens collaborateurs.
Amadou-Mahtar Mbow fut le premier Africain à être élu directeur général de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), qu’il a dirigée de 1974 à 1987, après avoir été ministre de l’Education puis de la Culture au Sénégal.
Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres
Il a traversé deux guerres mondiales, et loin de se retirer, il « s’est réengagé par conviction, par sens du devoir, par amour de son pays et de l’humanité », a rappelé M. Sagna.
Il considère que ce courage était déjà « une pédagogie ». Amadou-Mahtar Mbow, souligne-t-il, c’était aussi « le don de soi – dans les amphithéâtres comme dans les écoles de brousse, les salles sans lumière où naît la connaissance ».
Il parcourait le Sénégal, de Rosso (en Mauritanie) à Youtou, de Badiana à Daroul Mouhty, « non pour imposer, mais pour écouter, comprendre, co-construire », a poursuivi le professeur Mahamadou Lamine Sagna.
Selon le sociologue, l’écoute et la concertation résument toute l’approche d’Amadou-Mahtar Mbow, fondée sur le dialogue et le respect, ce qui rend compte en même temps d’une « humanité immédiate, simple, rayonnante, qui faisait de chaque rencontre une leçon, et de chaque regard un dialogue ».
Une éthique de la dignité et de la responsabilité
« S’il fallait résumer son héritage en un mot, je dirais : dignité », une dignité « intellectuelle, morale et politique » sur laquelle il s’est basé pour montrer que l’Afrique pouvait parler au monde sans se renier et participer à l’universel, « sans s’y dissoudre », poursuit le sociologue.
Amadou Mahtar Mbow « n’a jamais cherché les honneurs : son parcours fut celui d’un pédagogue engagé, convaincu que la liberté n’a de sens que si elle s’accompagne de responsabilité et de justice », a-t-il témoigné.
M. Sagna estime que le message de l’ancien directeur général de l’UNESCO aux jeunes générations reste tout aussi clair : « Éduquez-vous. Cultivez-vous. Non pour imiter, mais pour inventer. »
De l’avis d’Amadou-Mahtar Mbow, a-t-il rappelé, « l’éducation n’était pas un moyen d’ascension sociale, mais un acte de libération », de même la culture n’est « pas une parure, mais un langage de résistance et de création ».
« Et la souveraineté – intellectuelle, politique, économique – n’était pas un slogan, mais un projet d’humanité », observe Mahamadou Lamine Sagna, ajoutant qu’Amadou-Mahtar Mbow « nous a appris que le savoir n’est pas neutre : c’est un champ de bataille ».
Cela veut dire « conquérir le droit de penser par soi-même, de produire sa propre science, de raconter son propre monde ».
Un penseur visionnaire du numérique et du savoir mondial
L’auteur d »‘Aux sources du futur » (1982) avait anticipé l’ère des technologies de l’information et de la communication. « Il y voyait, pas une menace, mais un défi moral et culturel », rappelle M. Sagna.
Déjà, il percevait que la révolution numérique transformerait les rapports de pouvoir, la production du savoir et la transmission de la mémoire. Cette clairvoyance lui valut l’hostilité de certaines puissances, « la Grande-Bretagne et les États-Unis notamment, qui redoutaient sa vision d’une redistribution du pouvoir symbolique mondial et iront jusqu’à se retirer de l’UNESCO ».
Amadou-Mahtar Mbow fut « l’un des premiers à comprendre que la bataille du futur se jouerait dans les esprits. Ses écrits invitent aujourd’hui à repenser l’éducation comme une école du discernement et de la responsabilité, une éducation qui réconcilie science et culture, modernité et mémoire, innovation et humanité », poursuit Mahamadou Lamine Sagna.
À l’âge de 98 ans, Amadou-Mahtar Mbow utilisait encore Internet, preuve de sa curiosité intacte et de sa foi dans la modernité qu’il ne craignait pas mais cherchait toujours à comprendre, à situer et à donner un sens, selon le sociologue.
Son regard, nourri de son expérience à l’UNESCO, était toujours critique et constructif à la fois, observe Mamadou Lamine Sagna, auteur d’une biographie consacrée à l’ancien directeur général de l’UNESCO et intitulée « Amadou-Mahtar Mbow, une légende à raconter ».
Un flambeau qui ne s’éteindra jamais
Il était critique, « parce qu’il dénonçait la concentration des savoirs, des infrastructures et des récits dans quelques mains. Mais [aussi] constructif, parce qu’il croyait en la capacité des peuples à créer leurs propres instruments de libération ».
Selon lui, Amadou-Mahtar Mbow voyait dans la domination des grandes plateformes numériques « une continuité, sous d’autres formes, des déséquilibres qu’il dénonçait dès les années 1970 ».
« Il reconnaissait dans ce nouvel ordre numérique la même concentration du pouvoir symbolique, sauf qu’au lieu d’être entre les mains des États, ce pouvoir est désormais entre celles d’entreprises globales, presque hors de tout contrôle démocratique », rappelle M. Sagna.
Il ajoute : Amadou-Mahtar Mbow « saluait, bien sûr, les promesses du numérique – l’accès élargi au savoir, la communication sans frontières, la démocratisation apparente de la parole. Mais, fidèle à sa lucidité, il voyait aussi le piège de l’illusion », qui empêchait de voir que derrière cette liberté apparente se cachait un nouvel empire : celui des données, des algorithmes et des dépendances invisibles.
« L’Afrique ne doit pas seulement consommer le monde, elle doit le penser », répétait-il souvent, selon son biographe.
Il dit être sûr que si Amadou-Mahtar Mbow était vivant aujourd’hui, il « nous aurait appelés à une souveraineté numérique, qui soit aussi culturelle et intellectuelle – une manière d’habiter le numérique sans s’y dissoudre ». « Car, pour lui, la véritable modernité n’a jamais consisté à suivre le monde, mais à y apporter sa lumière. »
Pour Mahamadou Lamine Sagna, relire Amadou-Mahtar Mbow « aujourd’hui nous rappelle que la vraie modernité n’est pas dans l’imitation, mais dans la fidélité à une vision : celle d’une Afrique debout, lucide, créatrice, qui parle au monde d’égal à égal ».
« Mbow n’a pas seulement marqué l’histoire de l’UNESCO, il a inscrit dans la mémoire africaine une promesse : celle d’un savoir qui libère, d’une culture qui relie et d’une humanité qui s’élève », souligne-t-il, affirmant que tant qu »‘il restera une voix pour dire son nom, une main pour transmettre son geste, une conscience pour méditer son oeuvre, le flambeau de Mbow ne s’éteindra jamais ».