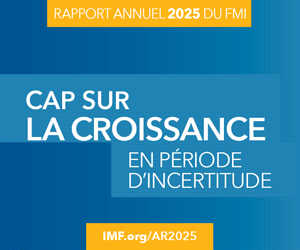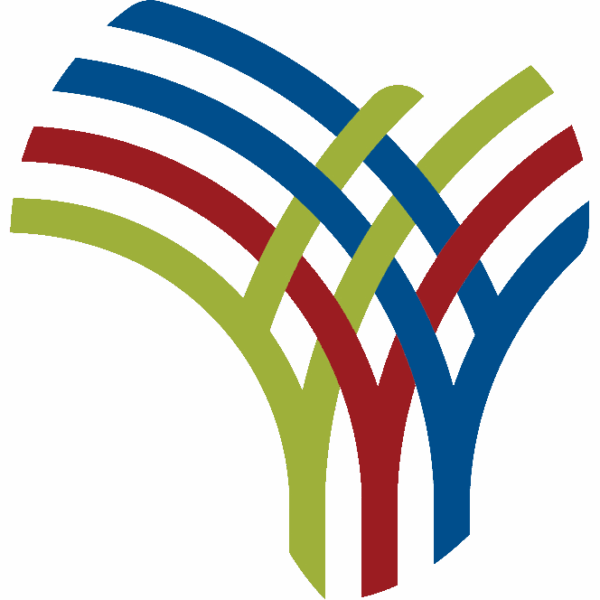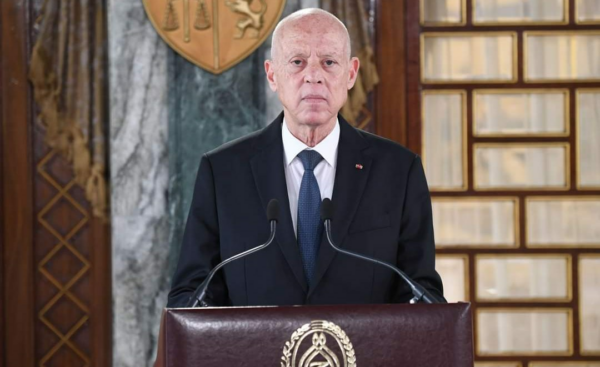Sénégal: Pôles territoriaux – Une concertation nationale inédite pour une réforme inclusive

C’est au pas de course que le ministre de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement du territoire, Moussa Bala Fofana, a mené les concertations avec les populations de l’intérieur, pour la mise en place des pôles territoriaux.
Des kilomètres avalés, des mains serrées, des avis et désaccords entendus, avec en toile de fond l’objectif de rendre les territoires de l’hinterland plus dynamiques économiquement. Depuis plus d’un demi-siècle, le Sénégal a fait des pas de géant pour se rapprocher de ses citoyens, par le truchement de la déconcentration et de la décentralisation.
En effet, rappelle le ministre de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement du territoire, Moussa Bala Fofana, en 1970, «nous avons assisté à la création des communautés rurales, marquant le tout premier pas vers une démocratie locale, jetant les bases d’une gestion plus proche des populations». Plus tard, en 1996, l’Acte II de la décentralisation transfère neuf compétences essentielles aux collectivités territoriales, renforçant leur autonomie et confirmant le principe de la libre administration locale.
Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres
Cette dynamique s’est poursuivie jusqu’en 2013, avec l’Acte 3, qui est allé plus loin, avec la communalisation intégrale et l’érection du département en collectivité territoriale à part entière, complétant ainsi le processus pour une administration plus locale et efficace, a fait savoir le ministre. Mais malgré tout, les déséquilibres restent criants, a dit le ministre, car «près de 47 % de la population est concentrée à l’Ouest, autour de Dakar, Thiès et Diourbel, sur à peine 5 % de la superficie du pays».
C’est pourquoi, sous l’impulsion des autorités, le nouveau régime s’est attelé à poser sa pierre à l’édifice dans les politiques de décentralisation initiées par les différentes administrations. Avec l’Acte 4, il sera question, selon le ministre, de mettre en place des pôles territoriaux, véritables bassins de développement, instruments de souveraineté économique et de justice sociale.
Mais la démarche est inclusive, avec des rencontres initiées dans les huit pôles. Mobilisations diverses Ainsi, entre février et septembre 2025, «nous avons conduit une campagne nationale sans précédent avec 5 574 kilomètres parcourus à travers villes, villages et terroirs, 8 pôles visités, de Kaolack à Podor, de Louga à Sédhiou, de Tambacounda à Matam et de Thiès à Dakar».
Pour le volet mobilisation des acteurs, 2 327 participants ont pris part aux différentes rencontres, dont 1 253 pour les concertations sur les pôles territoriaux et 1 074 pour discuter de l’Acte IV. Pour Moussa Bala Fofana, « jamais une réforme n’aura été autant discutée, débattue et coconstruite avec les citoyens et leurs représentants. Et les chiffres illustrent l’ampleur du processus ». À Dakar, on a enregistré 651 participants (28 % du total), ce qui reflète son rôle de capitale et de métropole. Au niveau du sud du pays (Sédhiou-Kolda-Ziguinchor), 411 personnes ont pris part aux rencontres, soit 18 %, traduisant les attentes fortes d’un pôle structurant.
À Tambacounda-Kédougou, 321 participants (14 %) ont participé aux débats malgré l’éloignement géographique. Au Nord (Saint-Louis, Podor), 320 délégués, soit 14 %, ont pris part aux échanges. Le Nord-Est (Matam) a rassemblé 260 participants, soit 11 %. L’axe Diourbel-Louga a compté 162 participants (7 %), et Thiès 202 acteurs (9 %), qui ont participé aux discussions sur le pôle. Du point de vue de la catégorisation des acteurs, la tendance est claire, a avoué le ministre, car «nous avons enregistré la présence de beaucoup d’élus locaux avec 38,3 %, preuve que les collectivités s’approprient la réforme ».
Les acteurs du secteur privé représentaient 12,9 %, confirmant que le développement des pôles sera économique avant tout, les services techniques déconcentrés et administrations locales 16 %, la société civile 4,4 % et les partenaires au développement 2,3 %. Ce qui montre, selon le ministre, que «cette mobilisation démontre que cette réforme n’est pas une décision imposée d’en haut, mais bien une construction collective, enracinée dans les réalités locales ».