Se soumettre, fuir ou disparaître: les crimes contre les journalistes en Afrique se multiplient
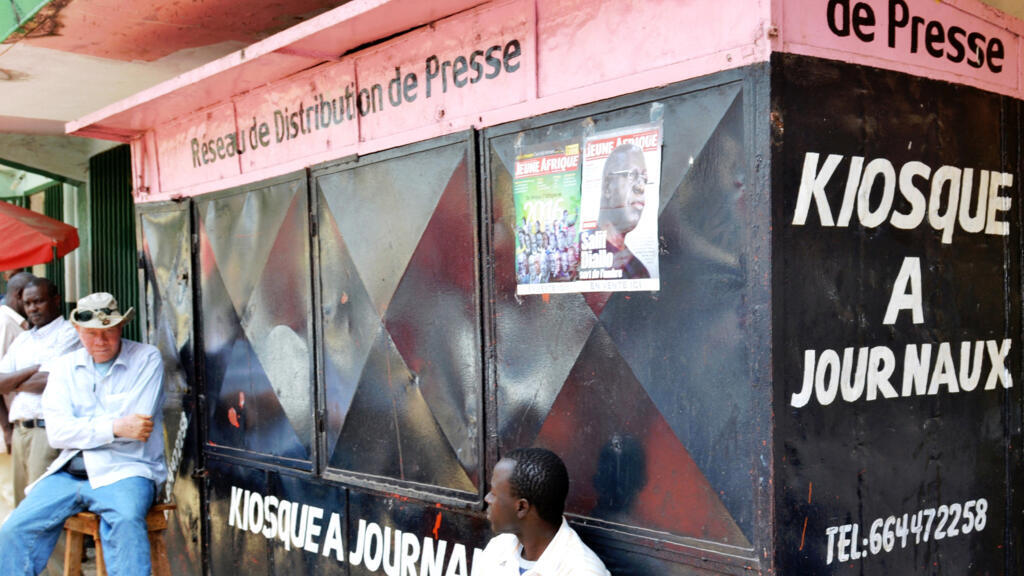
De la Guinée à l’est du Congo, les attaques contre la presse sont de plus en plus graves sur le continent et l’impunité persiste alors que les auteurs bien souvent sont connus.
Le visage de Serge Oulon orne la dernière Une de L’Evènement, en date de juillet 2024, comme si le bi-mensuel, véritable institution au Burkina Faso, attendait le retour de son directeur de publication pour reparaître.
Au matin du 24 juin 2024, un commando armé débarque au domicile du journaliste d’investigation et l’importe vers une destination inconnue. Une dizaine d’autres figures de la presse burkinabè seront enlevées dans des conditions similaires les mois suivants.
Les autorités militaires du pays n’hésitent pas à forcer les portes du Centre national de presse Norbert Zongo de Ouagadougou, nommé d’après le célèbre journaliste assassiné en 1998, devenu symbole de la liberté d’expression d’une presse jadis reconnue pour sa vitalité bien au-delà du continent.
Arrivé au pouvoir à la faveur d’un coup d’État fin 2022, le régime du capitaine Ibrahim Traoré ne tolère plus aucune voix discordante. Seuls peuvent exercer les « journalistes patriotes », ceux « qui se cantonnent à publier les articles pré-écrits par la présidence », résume un confrère burkinabè.
Les autres, de même que les opposants, avocats, magistrats, religieux, membres de la société civile, sont arrêtés ou réquisitionnés pour combattre au front l’insurrection jihadiste qui secoue le pays depuis une décennie.
Ils réapparaissent parfois dans de courtes vidéos, vêtus de treillis militaire pour faire une déclaration de repentance, visiblement sous la contrainte.
À lire aussiEntre enlèvements et menaces, la liberté de la presse en danger au Burkina Faso
Le « prisonnier personnel » d’Ibrahim Traoré
Mais pas Serge Oulon : est-ce parce que le journaliste refuse de plier ? Ou parce qu’il n’est pas un détenu comme les autres ?
Cinq jours après son enlèvement, le Prix de la lutte anti-corruption lui est décerné en son absence. Pour la quatrième fois, le jury récompense « la rigueur et le travail méticuleux porté par un style dépouillé, clair et limpide » du journaliste « à la déontologie chevillée au corps », selon un proche collaborateur. La dernière fois que Serge Oulon a reçu cette récompense, c’est pour une enquête sur des détournements de fonds au sein des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP), dans lesquels Ibrahim Traoré est accusé à demi-mot.
Convoqué par la justice militaire, sommé de divulguer ses sources, menacé, Serge Oulon tient bon… Jusqu’à sa disparition. Il serait pour certains le « prisonnier personnel » d’Ibrahim Traoré.
Lui aussi, avait refusé de se soumettre : le 3 décembre 2024, alors que le soleil décline sur les interminables embouteillages de Conakry, Habib Marouane Camara, journaliste et administrateur du site guinéen Le Révélateur 224, est extirpé violemment de son véhicule et arrêté par un groupe de gendarmes et de militaires, selon les témoins. Avec son sourire insolent, le journaliste de 36 ans est une figure incontournable du paysage médiatique guinéen. Les auditeurs ont savouré ses chroniques acerbes, ses prises de positions sans concession et son engagement pour la liberté d’expression.
« J’en suis l’exemple vivant !, sourit Sekou Jamal Pendessa, secrétaire général du syndicat des professionnels de la presse de Guinée. Lorsque j’ai été moi aussi arrêté, il n’a eu de cesse de dénoncer ma détention et la responsabilité du porte-parole du gouvernement, Ousmane Gaoual Diallo » rappelle-t-il.
À lire aussiKenya: la liberté de la presse sous pression économique
« C’est une catastrophe et je pèse mes mots »
Habib Marouane se savait menacé, en particulier depuis qu’il tenait tête au ministre qui le poursuivait pour diffamation. Depuis sa disparition il y a bientôt un an, les autorités se murent dans le silence, poussant son épouse, Mariama Lamarana Diallo, à prendre la plume pour adresser une lettre ouverte au président de la transition, le général putschiste Mamadi Doumbouya. Elle y exprime sa détresse ainsi que celle de ses enfants, demandant à « connaître la vérité pour avoir le sommeil tranquille » mais ne reçoit aucune réponse.
Le 6 décembre 2024, le Tribunal de première instance de Dixinn déclare que « cette arrestation a été opérée sans ordres des autorités constituées et hors des cas prévus par la loi ». L’ONG Reporters sans frontières saisit donc le Groupe de travail des Nations unies sur les disparitions forcées, qui planche déjà sur le cas de Foniké Menguè, et Mamadou Billo Bah, deux figures de la société civile, enlevés le 9 juillet 2024.
Avec une chute de 25 places, la Guinée est le pays qui enregistre le plus fort recul dans le Classement mondial de la liberté de la presse publié par RSF en 2025. « C’est malheureux, mais les faits sont là, soupire Sékou Pendessa. Les principaux médias indépendants ont été interdits par le régime et il ne se passe pas un jour sans qu’un journaliste soit menacé ».
En Afrique centrale, la situation est particulièrement dramatique dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC). Selon RSF, plus d’une cinquantaine d’attaques contre des journalistes ont été recensées depuis 2024 dans la province du Nord-Kivu, contrôlée par la rébellion de l’AFC/M23.
« C’est une catastrophe et je pèse mes mots, lâche l’ancien directeur provincial de la Radio-télévision nationale congolaise à Goma, Tuver Tuverekweyo Wundi. Une trentaine des radios communautaires sont réduites en silence, les professionnels des médias n’ont d’autre choix que de fuir ou de se soumettre aux nouvelles autorités » résume-t-il.
À lire aussiRSF inquiète pour la liberté de la presse au Bénin, en Côte d’Ivoire et au Sénégal
« Déposer plainte, inonder les juridictions pour que subsistent des traces »
Son confrère Fiston Wilondja n’a pas eu le temps de s’exiler. Le corps du journaliste de la Centrale de monitoring des médias de Bukavu a été retrouvé le 5 août 2024, « un câble de batterie autour du cou » après avoir été « enlevé, torturé, ligoté, étranglé et tué », selon un communiqué de l’Union nationale de la presse du Congo. Il portait encore sa carte de presse.
« Les auteurs étaient des porteurs d’armes identifiés dans un bataillon de la rébellion, comme l’a reconnu le gouverneur, explique Tuver Wundi, mais il n’y a jamais eu de procès, alors que des témoins les ont entendus dire « toi, tu parles trop dans les médias » ».
Tuver Wundi a décidé de fuir Goma après 11 jours en détention dans les geôles du M23 : « Je ne pouvais plus travailler, raconte-t-il, les rebelles voulaient me faire chanter les louanges de leur action. Alors, j’ai pour ainsi dire pris ma clause de conscience ». Arrivé dans la capitale congolaise Kinshasa, Tuver Wundi est de nouveau arrêté, cette fois par les services de renseignement gouvernementaux, et passe quatre jours au cachot.
Maigre consolation dans ce calvaire sans fin, Reporter sans frontières a remis cette année le prix de la liberté de la presse à l’organisation congolaise « Journaliste en danger », dont il est le correspondant à Goma. « C’est un grand honneur de voir récompenser notre travail, confie Tuver, mais c’est maintenant que le boulot commence pour continuer à informer les populations de l’Est. »
Pour le directeur Afrique de Reporters sans frontières, ces quelques exemples dessinent une tendance grave. « De plus en plus souvent, détaille Sadibou Marong, ce sont les États ou les autorités locales – ceux-là mêmes qui sont censés protéger les journalistes en vertu du droit international-qui commettent ces crimes. »
Que faire, dès lors ? « Documenter sans relâche, répond Sadibou Marong, dénoncer, déposer plainte, inonder les juridictions pour que subsistent des traces » et pour qu’un jour, puisqu’aucun régime autoritaire n’est éternel, justice soit enfin rendue.



