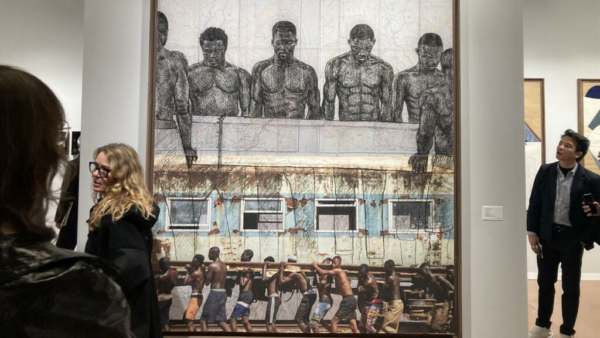Mali: les conséquences du blocus sur l’économie et le quotidien à Bamako

Au Mali, le président de transition, le général Assimi Goïta, a appelé le 3 novembre 2025 les Maliens à rester « unis » et à « éviter la panique ». Depuis début septembre, le Jnim, lié à al-Qaïda, attaque les convois de camions citernes circulant sur les routes, provoquant une pénurie d’essence massive dans tout le pays et jusque dans la capitale. De nombreuses activités sont suspendues. Aucune pénurie alimentaire, mais les habitants commencent à constituer des réserves.
Publié le :
5 min Temps de lecture
« Nous devons rester unis et éviter la panique. » Après être longtemps resté muet sur le sujet, le général Assimi Goïta s’est finalement résolu à commenter l’embargo jihadiste sur le carburant. Le président de transition du Mali s’exprimait lundi en marge d’un déplacement à Bougouni pour l’inauguration d’une mine de lithium.
Bougouni se trouve à 160 kilomètres de Bamako, dans le centre du pays. C’est le premier déplacement en région du président de transition depuis que le Jnim a renforcé sa présence sur les axes routiers maliens, début septembre. Comme un défi lancé aux jihadistes. Le général Assimi Goïta a également appelé les Maliens à ne pas se diviser et à modérer leur consommation pour faire face à la pénurie de carburant.
À Bamako, 250 citernes par jour seraient nécessaires
Pendant des semaines, ce sont surtout les régions maliennes qui ont souffert de la pénurie d’essence, notamment à Ségou, San, Mopti ou Koutiala. Depuis début octobre, la capitale malienne subit à son tour les effets de l’embargo jihadiste, pénalisant les activités économiques et le quotidien de tous les Bamakois.
Outre l’essence, puis le gasoil, le gaz butane est devenu une denrée rare et chère. Des convois de camions citernes sous escorte militaire parviennent occasionnellement à passer les mailles du blocus jihadiste – leur arrivée est célébrée comme un événement – mais les besoins de Bamako, estimés par plusieurs experts à environ 250 citernes par jour, sont très loin d’être satisfaits.
À lire aussiMali: rançon en échange d’otages et poursuite du blocus, comment le Jnim resserre l’étau sur Bamako
Les prix du carburant au marché noir ont explosé – les autorités de transition affichent dans les médias d’État leur détermination à combattre les « trafiquants » – mais également les prix des transports eux-mêmes. Les Bamakois qui n’ont pas pu remplir leur réservoir, même après avoir fait la queue pendant plusieurs heures devant les quelques stations encore ouvertes, doivent désormais payer le double du prix habituel pour emprunter les transports collectifs ou les motos-taxis qui parviennent encore à circuler dans la capitale. C’est ce qu’indiquent plusieurs témoignages recueillis par RFI.
Selon ces témoignages, les tarifs des autocars pour se rendre en région ont également augmenté, mais dans de moindres proportions. Des soutiens des militaires au pouvoir incitent sur les réseaux sociaux à prendre le vélo. Les moins enthousiastes déplorent devoir recourir aux vieilles charrettes et aux ânes.
Écoles, entreprises, services publics impactés
Parce que ni les enseignants, ni les élèves, ne parvenaient à se rendre dans leurs établissements, les autorités de transition ont suspendu les cours dans toutes les écoles et universités du Mali pour au moins deux semaines : réouverture annoncée le 10 novembre.
Dans de nombreuses entreprises privées ou services publics, les retards ou les absences obligent aussi à réduire ou à suspendre les activités. C’est le cas jusque dans les tribunaux maliens, où des prévenus ou des avocats ne parviennent pas à se rendre à leur audience. « J’en ai manqué deux la semaine dernière », déplore un ténor du barreau du Mali.
Un chef d’entreprise estime que plus de 80% de ses salariés manquent désormais à l’appel. Dormir au bureau ? « Ils préfèrent passer la nuit dans les stations essence », répond ce patron, qui explique ne sortir actuellement que 15% de sa production habituelle. En cause : l’absence des salariés, mais aussi les coupures de courant et le manque de carburant pour faire tourner les générateurs et les machines dont dépend son industrie.
« Le pays de l’Uemoa où l’inflation est la plus élevée depuis début 2025 »
« De toute façon, nos clients n’ont plus d’argent pour acheter », commente encore ce chef d’entreprise, désabusé : « Nos activités avaient déjà diminué depuis deux-trois ans à cause des coupures d’électricité, maintenant nos coûts de production augmentent encore, c’est la mort ! »
Sur le plan alimentaire, on trouve de tout à Bamako et les prix, ces dernières semaines, sont restés globalement stables.
À lire aussiBlocus pétrolier et attaque du Jnim: «La situation à Bamako est incertaine»
Toutefois, les produits maraîchers ont commencé à voir leurs tarifs augmenter, en raison des difficultés d’acheminement et surtout de l’impossibilité de faire tourner les pompes à irrigation, ce qui occasionne des pertes dans les cultures. Tomates, aubergines, choux, carottes : plusieurs témoignages font état de prix multipliés par deux voire plus. Des boulangeries ont arrêté temporairement de fabriquer du pain.
« Le Mali est le pays de l’Uemoa où l’inflation est la plus élevée depuis le début 2025, explique un économiste malien. La pénurie de carburant et les délestages vont encore augmenter cette inflation ».
« J’ai acheté pour trois mois de riz »
À Bamako, personne ne craint un assaut violent du Jnim, mais la stratégie d’asphyxie économique mise en œuvre par les jihadistes suscite des craintes pour l’avenir immédiat. De nombreux habitants ont donc commencé à faire des réserves, à constituer des stocks.
« J’ai acheté pour trois mois de riz, de sucre et d’huile », confie un Bamakois. Un autre a prévu d’acheter « des produits de première nécessité en quantité suffisante » dans les prochains jours. Un troisième explique vouloir le faire… Mais ne pas en avoir les moyens.