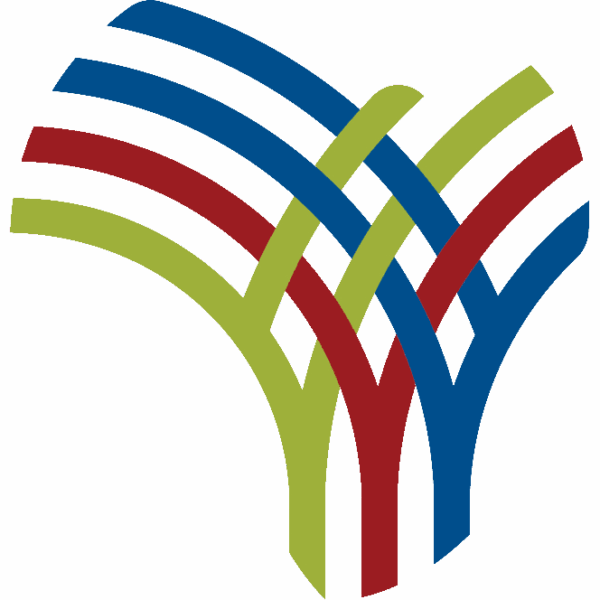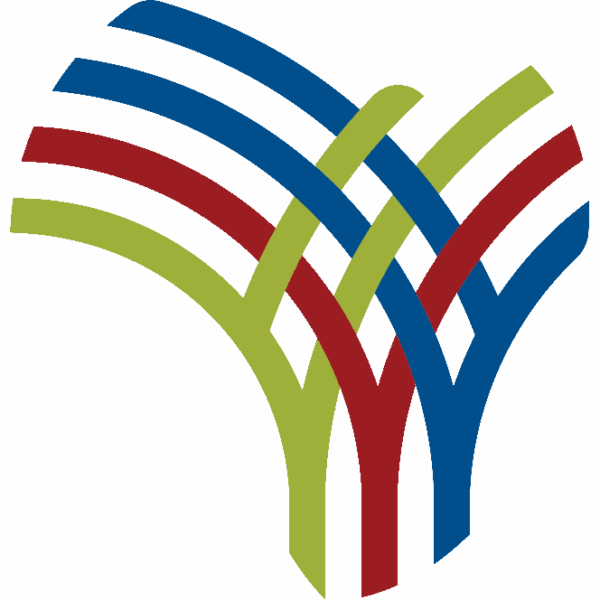Madagascar: L'armée prend le pouvoir, place à la «rénovation nationale»

Madagascar a basculé dans une nouvelle ère politique. Hier, au terme d’une journée d’une intensité rare, l’armée a pris le pouvoir, suspendu la Constitution de 2010 et dissous plusieurs institutions républicaines. Cette journée marque une rupture nette avec l’ordre établi et ouvre une transition militaire annoncée comme temporaire, mais dont les contours restent incertains.
Tout a commencé en début d’après-midi, avec une montée de tensions au Parlement. Alors que 110 députés avaient signé une motion pour convoquer une session extraordinaire en vue d’un vote de destitution, Andry Rajoelina avait, lui, annoncé la dissolution de l’Assemblée nationale. Un geste de dernière minute, interprété comme une tentative de conserver le pouvoir, mais aussitôt contesté. Le vice-président de l’Assemblée, Siteny Randrianasoloniaiko, dénonce «un décret sans valeur juri- dique» en raison de l’absence de signature et de tampon officiels. L’hémicycle entre alors dans un moment de gravité institutionnelle.
Un peu plus tard, la motion d’empêchement est votée : 130 députés sur 131 valident la destitution du président de la République, Andry Rajoelina. La Cour constitutionnelle devait prendre le relais pour confirmer ce vote. Mais le cours des événements s’emballe. En arrière-plan, des mouvements militaires s’organisent autour du palais d’État.
Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres
Peu avant le crépuscule, la voix du colonel Randrianarina, au nom des forces armées, retentit depuis Ambohitsorohitra. Son ton est calme, solennel, presque froid : «La Constitution est suspendue. Le Sénat, la HCC, la CENI, la HCJ et le Haut conseil pour la défense de la démocratie sont dissous.» Un silence lourd s’abat dans la capitale, suivi d’un éclatement de joie. L’armée annonce la mise en place d’un Comité conjoint pour la Rénovation nationale, composé de représentants de l’armée, de la gendarmerie et de hauts conseillers civils. Ce comité exercera les prérogatives présidentielles pour une période de transition de deux ans maximum, le temps d’organiser un référendum constitutionnel et de nouvelles élections nationales.
Dans sa déclaration, le colonel affirme que cette prise de pouvoir est une «réponse aux aspirations profondes du peuple malgache», visant à restaurer la confiance dans les institutions et à construire une gouvernance «juste, transparente et redevable». Devant le palais présidentiel, les blindés se positionnent, les soldats verrouillent les accès : le symbole est clair, le pouvoir a changé de mains.
Cette bascule intervient dans un contexte de crise sociale et politique sans précédent. Les pénuries d’eau et d’électricité ont enflammé la rue. Le mouvement Gen Z, fer de lance de la contestation, réclame depuis des semaines un nouveau contrat social. Les voix de la société civile et de l’opposition se sont unies autour d’un mot d’ordre : rupture.
Plus tôt encore, le général Deramasinjaka Manantsoa Rakotoarivelo, tout juste nommé ministre des Forces armées, avait donné le ton lors d’un discours devant ses hommes : «discipline», «rigueur», «responsabilité». Ce message, présenté comme un appel au calme, prend aujourd’hui des airs de prélude à une prise de pouvoir planifiée.
La communauté internationale suit la situation de près. La Commission de l’Union africaine, réunie la veille, avait annoncé l’envoi d’une mission de haut niveau à Antananarivo pour «accompagner le dialogue politique» et éviter tout «changement anticonstitutionnel de gouvernement». Ce scénario s’est pourtant imposé en l’espace de quelques heures.
L’armée reste divisée, ce qui ajoute une couche d’incertitude. Une partie des officiers se range derrière le Comité conjoint, tandis que d’autres plaident pour un retour à une transition civile rapide. Les relations civilo-militaires seront déterminantes dans les jours à venir : elles traceront la frontière entre stabilisation et dérive autoritaire.
Et nouveau rebondissement hier soir : dans une dé- cision datée du 14 octobre, la Haute cour constitutionnelle (HCC) a pris acte de la vacance du pouvoir à la tête de l’État. Elle a désigné le colonel Michaël Randrianirina comme chef de l’État par intérim, estimant qu’il incarne «l’autorité militaire compétente». La HCC fixe un délai de 60 jours pour l’organisation d’une élection présidentielle. En attendant, les institutions et organes constitutionnels en place poursuivent l’exercice de leurs fonctions habituelles.
Sur les pavés d’Ambohitsorohitra, le crépuscule a une teinte lourde. Dans les rues, la rumeur enfle : un régime est tombé. Un autre vient de s’installer.