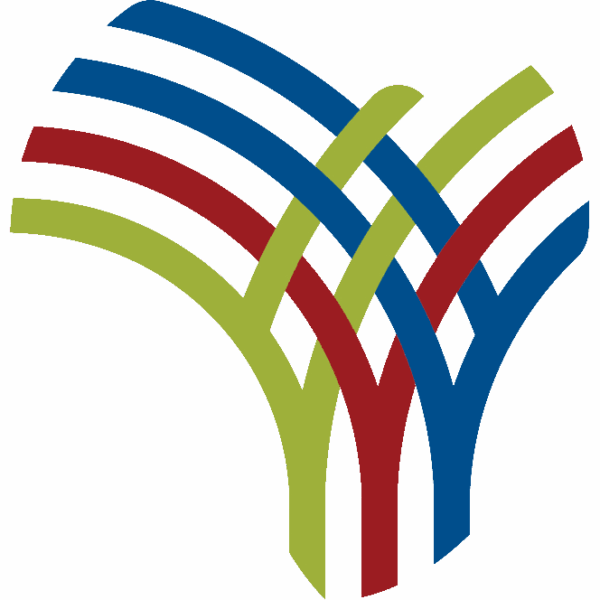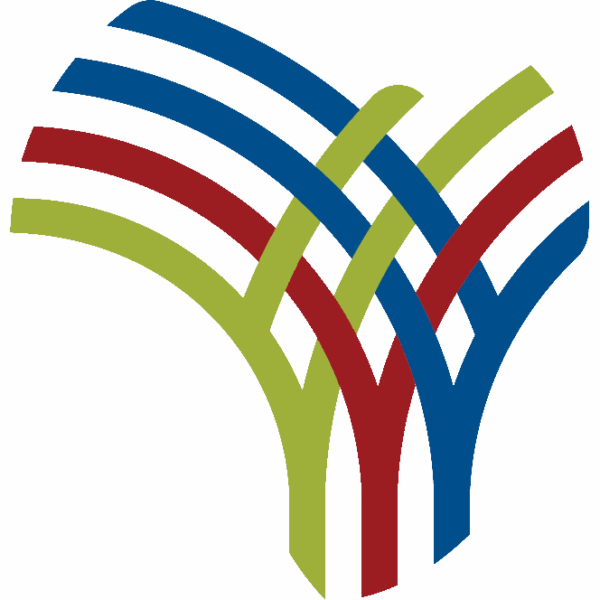Madagascar: Antananarivo en flammes – La voix des expatriés

Le jeudi 25 septembre, la capitale malgache a connu une journée de violences et de pillages sans précédent lorsque des milliers de manifestants, pour la plupart des jeunes, ont défié l’interdiction de rassemblement pour protester contre des coupures d’électricité et d’eau à répétition, la pauvreté et la corruption. Des scènes de chaos ont éclaté dans plusieurs quartiers : barricades, incendies, pillages de centres commerciaux et attaques contre des domiciles de personnalités proches du pouvoir. Les autorités ont décrété un couvre-feu nocturne pour «rétablir l’ordre».
La mobilisation, largement organisée sur les réseaux sociaux et relayée par des collectifs de jeunesse – le Gen Z Madagascar aussi connu comme le mouvement Leo délestage – a commencé comme une protestation contre les délestages électriques qui laissent des foyers sans électricité pendant de longues heures, affectant écoles, commerces et hôpitaux. «Nous avons des cours en ligne, des dossiers à imprimer, des enfants à soigner – comment tenir sans eau ni électricité ?» raconte une étudiante manifestante.
Les slogans scandés par la foule étaient simples et implacables : «Nous voulons de l’eau, nous voulons de l’électricité.»
Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn
La réaction des forces de l’ordre a été immédiate et musclée. Selon le général Angelo Ravelonarivo, qui dirige une force mixte police-armée, des «individus profitent malheureusement de la situation pour détruire les biens d’autrui» et c’est pour «protéger la population et leurs biens» qu’un couvre-feu de 19 h à 5 h a été instauré «jusqu’à la restauration de l’ordre public». Des tirs de gaz lacrymogène et des balles en caoutchouc ont été utilisés pour disperser les manifestants.
Le bilan des victimes reste incertain et controversé : plusieurs médias locaux et internationaux font état d’au moins cinq décès, certains rapports hospitaliers suggérant que des victimes ont été blessées par armes à feu.
Des dizaines de blessés ont été transportés aux urgences, tandis que de nombreux commerces et infrastructures ont été saccagés, notamment les stations du nouveau téléphérique urbain et les bureaux de Jirama, la compagnie publique d’eau et d’électricité. Les autorités n’avaient pas encore publié de bilan officiel des victimes au moment de la rédaction de ce rapport.
Des scènes de chaos ont éclaté dans plusieurs quartiers.
La crise a pris une dimension politique : le président Andry Rajoelina, présent à New York pour l’Assemblée générale des Nations unies, a appelé au calme et condamné les actes de pillage et de violence, soulignant que «la division et la haine ne sont pas des solutions».
Dans un geste destiné à apaiser l’opinion, le gouvernement a annoncé, le lendemain, le remplacement du ministre de l’Énergie, Olivier JeanBaptiste limogé, après les critiques sur la gestion des délestages. Pour l’opposition et une partie de la population, cette décision arrive trop tard et ne répond pas à l’ampleur des souffrances quotidiennes.
Les réactions de la société civile ont été vives. Le Conseil des Églises chrétiennes, catholique, luthérienne et anglicane de Madagascar (FFKM) a appelé à la fin de la violence. Il rappelle que l’accès à l’eau et à l’électricité relève de droits élémentaires et nécessite un dialogue immédiat entre l’État et la population. Des organisations de défense de la liberté de la presse ont, par ailleurs, dénoncé des violences policières à l’encontre des journalistes présents sur le terrain.
La voix des expatriés
Au coeur de ce tumulte, la communauté étrangère installée à Madagascar vit elle aussi une période de forte inquiétude. Ravin Goonmeter, Mauricien établi à Antananarivo depuis 22 ans, aujourd’hui directeur général adjoint d’un groupe sud-africain actif dans la sécurité privée et la protection animale, décrit une atmosphère de tension permanente :
«Étant dans le secteur de la sécurité privée, nous sommes en alerte dans cette période. Nous travaillons le matin et restons toujours en contact avec notre équipe de direction et nos divers clients. Nous évitons les zones rouges pour éviter de nous mettre à risque.
Nous suivons sur les réseaux sociaux les infos en temps réel et partageons ces informations ainsi que des consignes de sécurité sur notre page Expats Maurice Madagascar, que j’anime avec Sam Jodhun. C’est la troisième fois en 22 ans que je vis ce type d’événement. Nous suivons toujours les mêmes consignes pour la sécurité personnelle et celle de nos compatriotes.»
L’expatrié mauricien Ravin Goonmeter décrit une atmosphère de tension permanente
À ses côtés, d’autres Mauriciens témoignent également de leur quotidien bouleversé. Cédric Allaghen, artisan dans le secteur de la construction et installé à Madagascar, confie son désarroi face à la situation : «C’est la première fois que je vis un tel événement. Je ne peux sortir car il y a un couvre-feu actuellement. J’ai dû faire des provisions en avance. J’espère que la situation se rétablira très vite.»
Ces témoignages traduisent l’inquiétude des expatriés, qui doivent concilier leur vie quotidienne et leurs activités professionnelles avec un climat de crise, tout en maintenant un haut niveau de vigilance pour leur sécurité et celle de leurs proches.
Un climat délétère
Sur le terrain, l’atmosphère était lourde le lendemain : rues désertes, commerces fermés, écoles annoncées fermées «jusqu’à nouvel ordre» dans plusieurs régions. Les transporteurs aériens ont suspendu certains vols intérieurs et les autorités temporisent l’ouverture des marchés principaux afin d’éviter de nouvelles flambées de violence. Des images partagées sur les réseaux sociaux montrent des quais et avenues jonchés de débris, des vitrines brisées et des incendies éteints par des habitants.
Les causes profondes de l’explosion sociale sont bien connues des Malgaches : un taux de pauvreté élevé, des infrastructures vieillissantes, une mauvaise gouvernance et des promesses de modernisation qui peinent à se traduire en services fiables pour la population. Pour beaucoup de jeunes, la colère est aussi politique et générationnelle : «Il ne s’agit pas seulement d’électricité – c’est l’ensemble du système qui nous étouffe», confie un jeune.
Les différentes perspectives
Au plan international, quelques chancelleries ont appelé au calme et recommandé la retenue dans l’usage de la force, tandis que des organisations humanitaires surveillent la situation pour évaluer d’éventuels besoins d’assistance, notamment en eau potable et soins d’urgence. Les prochains jours seront décisifs : soit le gouvernement parviendra à apaiser la colère par des mesures concrètes et un dialogue ouvert, soit la contestation continuera de gagner en intensité, avec le risque d’un engrenage incontrôlable.
Pour l’instant, Antananarivo panse ses plaies, mais la question cruciale demeure : comment garantir, rapidement et durablement, l’accès aux services de base qui ont déclenché ce soulèvement ? Les réponses attendues – techniques financières et politiques – devront être claires et rapides si l’on veut éviter que ce qui a commencé comme une manifestation de colère sociale ne se transforme en crise prolongée.