«Kusadikika»: un conte philosophique à la Voltaire sous la plume d'un grand romancier tanzanien
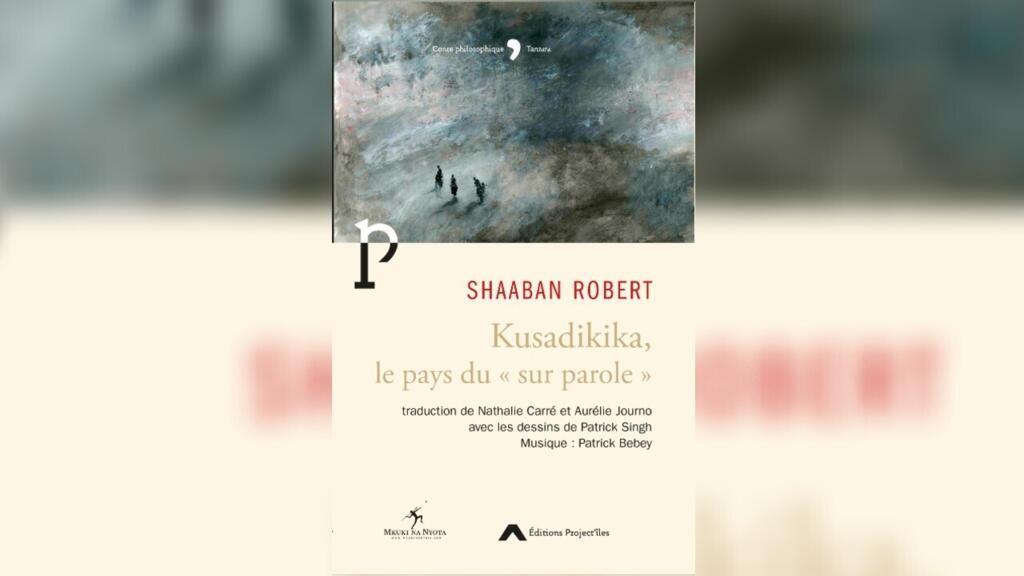
Le « Shakespeare » de la littérature swahili est le surnom que ses admirateurs donnent au romancier tanzanien Shaaban Robert. Considéré comme le père de la littérature swahili, l’homme est peu connu dans les pays francophones. Son roman Kusadikika qui vient de paraître est le deuxième livre de l’écrivain qu’on peut lire en français. Ce conte philosophique met en scène une réflexion, à la fois grave et ludique, sur le devenir de la société tanzanienne et sa renaissance, au terme de longues années de colonisation. Entretien avec Nathalie Carré et Aurélie Journo, traductrice et spécialiste de la littérature swahili.
Comment est née l’idée de traduire en français Kusadikika, le pays « sur parole » du Tanzanien Shaaban Robert ?
Nathalie Carré : Au départ, ce projet était une commande de l’Alliance française de Dar-es-Salam, mais il s’inscrivait dans un cadre plus large, celui du gouvernement tanzanien de republier les œuvres de Shaaban Robert, considéré comme le père des lettres swahili modernes. Né en 1909, l’écrivain est mort en 1962. En 2012 déjà, le pays avait commémoré le cinquantenaire de sa mort, et à cette occasion, il y avait déjà eu plusieurs publications, surtout par des maisons d’édition britanniques car le pays était alors encore sous le joug colonial. Le projet de rééditer l’œuvre de l’écrivain a été confié à Mkuki Na Nyota, qui est une très belle maison d’édition en Tanzanie et qui travaille beaucoup avec l’Alliance française. Ensemble, elles ont eu envie de republier Kusadikika en français.
Donc, nous, on n’a pas choisi le texte à traduire, on nous l’a amené. L’idée était à la fois de proposer une nouvelle édition de ce classique, enrichie par le travail de deux artistes : Patrick Bebey, qui a composé la musique qui accompagne le texte et qui est accessible à l’aide d’une application, et Patrick Singh qui est dessinateur-peintre et qui est l’auteur des illustrations splendides effectuées pour cette édition spéciale. Le texte a aussi été republié en swahili dans une édition spéciale, toujours avec de la musique et des illustrations.
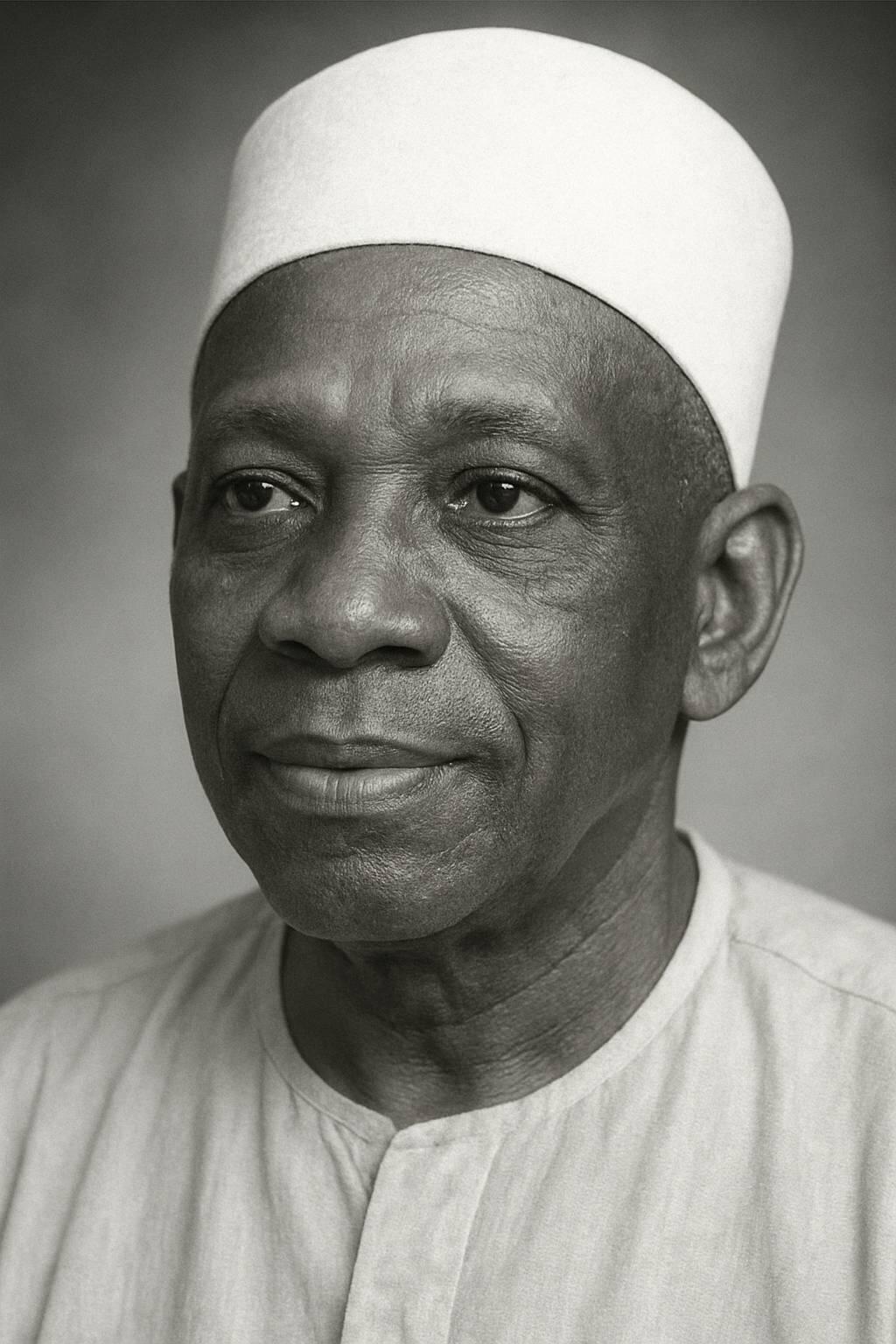
Le swahili est considéré comme lingua franca de l’Afrique orientale. Quels sont les pays où cette langue est couramment parlée ?
Aurélie Journo : Historiquement, le swahili se parlait sur toute la côte orientale de l’Afrique, mais qui progressivement, grâce aux commerçants, a pénétré à l’intérieur du continent, jusqu’au Congo. Aujourd’hui, elle est la langue véhiculaire dans de nombreux pays, notamment au Kenya, en Tanzanie, au Congo, en Ouganda, et c’est aussi une langue très, très apprise dans d’autres pays africains, en Afrique du Sud, au Ghana, par exemple. Du coup, le swahili est souvent considéré aussi comme une langue panafricaine.
À quelle date peut-on situer l’émergence de la littérature en swahili ?
Nathalie Carré : Les premières œuvres dont on a gardé la trace sont des œuvres manuscrites. Il s’agit essentiellement de la poésie. Ce sont les premières traces de littérature swahili, très influencée par la littérature arabe parce qu’on a traduit très tôt des textes de l’arabe vers le swahili. Par exemple, l’épopée la plus célèbre et dans laquelle, selon les historiens, se cristallise pour la première fois l’identité swahili, c’est l’épopée de Fumo Lyongo, qui daterait du XIIIᵉ siècle. Elle s’est transmise oralement. On l’a transcrite à partir des copies manuscrites datant du XIXᵉ. Son style se caractérise par un mélange à la fois de formes dites « traditionnelles » ou « classiques », héritées de l’arabe, avec un fond bantou et des thématiques propres à la culture swahili. Il y a des chansons d’auto-glorification, ce qui relève vraiment de la tradition bantou.
Les premiers textes écrits sont difficiles à dater, mais ils sont en adjami, c’est-à-dire rédigés avec l’alphabet arabe. Ensuite, sous la colonisation britannique, on a assisté à une standardisation du swahili, qui est favorisée par les autorités coloniales parce que c’est une langue unificatrice. On va basculer progressivement vers l’alphabet latin et la colonisation va mettre en place aussi de nouveaux genres en prose. Puis, l’arrivée des premiers romans sous l’influence occidentale.
On peut dire, comme pour Malherbe, « Et Shaaban Robert vint ». Il est aussi appelé le Shakespeare de la littérature swahili. Quelle place ce dernier occupe-t-il dans la littérature swahili moderne ?
Nathalie Carré : En effet, Shaaban Robert a beaucoup œuvré pour la standardisation du swahili. En 1946, il est entré dans l’East African Swahili Committee. Il a beaucoup fait aussi pour que cette langue soit reconnue. C’est pour ça, entre autres, qu’on le considère un peu comme le premier écrivain moderne de la littérature swahili. Il y a eu dans son sillage une foultitude d’écrivains, notamment un certain Eurphrase Kezilhabi qui a créé une poésie swahili affranchie des maîtres traditionnels. Ce poète est aussi considéré, avec Shaaban Robert, comme un monument des lettres swahili. La relève est venue avec la jeune génération d’écrivains post-coloniale, qui sont nombreux et talentueux. Les livres de Shaabane Robert, pour leur part, sont entrés dans le cursus scolaire. C’est quelqu’un qui reste important, en effet.
Aurélie Journo : Shaaban Robert était un auteur prolifique, avec plus de 22 livres à son actif. De par la variété des styles et des genres qu’il a abordé dans ses écrits. Il a créé le premier corpus de littérature swahili moderne qui a été une source d’inspiration majeure pour les jeunes écrivains venus après lui. On lui doit l’établissement du swahili comme langue littéraire moderne. L’homme a écrit aussi bien de la poésie que de la prose, des contes, une autobiographie, une biographie, et des textes théoriques sur la langue elle-même. Et, enfin des poèmes qui sont perçus comme une sorte de défense et d’illustration du swahili.

Que raconte Kusadikika, l’ouvrage que vous venez de traduire ?
Aurélie Journo: C’est un texte très court, très ramassé, composé de six chapitres consacrés aux voyages de contrée en contrée de six émissaires envoyées d’est en ouest, du nord au sud, pour s’imprégner de différentes manières de vivre et de gouverner. Le livre est construit comme un récit emboîté, où on entend la parole rapportée du personnage principal, Karama, qui est le conteur de ces récits de voyage. Les récits des émissaires permettent de déplacer le regard et de repenser le pays à partir des exemples puisés chez d’autres peuples.
Nathalie Carré : Pour moi, Kusadikika n’est pas un roman, mais plutôt un conte philosophique. Shaaban Robert utilise les moyens de la fiction pour interroger le réel.
Aurélie Journo : Le récit de Shaaban Robert s’ancre dans la tradition de l’oralité, puisqu’il met en scène la figure du narrateur qui raconte. Il s’agit de Karama, accusé dans le procès qu’on lui fait pour avoir introduit l’enseignement du droit. L’intrigue est située dans un cadre merveilleux, en l’occurrence dans les cieux. Karama prend la parole pour se défendre six jours durant, au cours desquels il raconte les expériences rapportées par les émissaires envoyés dans six directions. C’est à travers ces récits rapportés par Karama que vont s’élaborer petit à petit les fondements d’une utopie à construire, qui servira de modèle pour une société juste dans laquelle le droit règne et où le peuple est respecté par ses dirigeants.
Nathalie Carré : C’est surtout l’histoire d’un homme qui se dresse contre les puissants pour critiquer sa société en confrontant son regard à d’autres façons de vivre. Karama souhaite que le droit s’applique dans son pays où les lois sont malmenées. Ce qui m’a beaucoup plu, en traduisant ce texte, c’est sa dimension allégorique. On peut trouver la démarche de Karama assez naïve en fait, mais elle réaffirme la nécessité de retourner aux racines du droit. L’auteur rappelle que les citoyens ont le droit de réformer les lois si celles-ci s’avèrent mauvaises, si elles sont déposées dans les mains de personnes qui en font un mauvais usage. J’ai trouvé que les propos de Shaaban Robert résonnent vraiment avec ce qui se passe dans nos sociétés. Le livre fait triompher le sens du collectif et dénonce les sociétés où une certaine élite concentre les pouvoirs en ses mains et en abuse pour faire avancer ses propres intérêts.

Que signifie le titre Kusadikika ?
Nathalie Carré : En fait, ce nom vient du verbe « croire ». Kusadikika est le nom de la capitale du pays fictif dans le récit et il signifie en swahili les choses qui doivent être crues. D’où le sous-titre : « Le pays du sur parole ». On croit sur parole. Au lecteur de décider si c’est bien ou pas.
À part Kusadikika, quels sont les autres livres de Shaaban Robert qu’on peut lire en français ?
Nathalie Carré : L’autobiographie de Shaaban Robert intitulée simplement Autobiographie d’un écrivain swahili (Karthala 2010) a déjà été traduite. Mais, c’est en effet la seule œuvre disponible en français de cet auteur. Nous venons de traduire Kusadikika, qui était une commande. J’ai été vraiment ravie de le redécouvrir. Mais moi, j’aimerais bien que soit traduite aussi la biographie que l’écrivain a consacrée à la reine du Taarab sur la côte ouest africaine, Siti Binti Saad. Elle était née fille d’esclave. Mais elle a chanté avec Oum Kalsoum, avec qui elle était partie enregistrer en Inde.
Il reste plein de choses à traduire de Shaaban Robert : sa poésie par exemple. Cela représente un gros travail, mais sans doute passionnant. L’écrivain a rédigé en vers, son expérience de la Seconde Guerre mondiale. Voilà un homme qui est un citoyen britannique à l’époque de la rédaction de ses écrits sur la guerre. Ce texte retraçant l’histoire du conflit mondial, vu de la côte est-africaine, est un document exceptionnel.

Peut-on dire qu’en sa qualité de pionnière de lettres swahilies contemporaines, l’œuvre de Shaaban Robert a permis d’asseoir les thèmes et les tendances de fond de la littérature swahilie ?
Nathalie Carré : La littérature swahili est une littérature qui a pour ambition de faire réfléchir. Donc, une littérature à visée pédagogique. Shaaban Robert, dans tous ses textes, interroge vraiment la question sociale, les valeurs sur lesquelles une société est fondée. Il s’attarde aussi dans ses récits sur la notion d’exemplarité, comme on le voit dans Kusadikika. C’est aussi le sujet dans sa biographie de la chanteuse Siti Binti Saad, qui donne à voir une femme du peuple qui a continué à défendre la cause des femmes, la cause du petit peuple. Et, même dans son autobiographie, l’écrivain se demande : qu’est-ce qui serait digne d’être rapporté dans sa vie ?
On a aussi parlé de l’optimisme de Shaaban Robert. Son œuvre véhicule en effet une vision optimiste du monde. Sa démarche volontaire me rappelle Starobinski, pour qui Voltaire était le dernier des écrivains heureux, qui croyait en un avenir meilleur. Il y a en effet quelque chose de cela chez Shaaban Robert, qui est conscient des difficultés à venir, mais qui se dit que si on réfléchit tous ensemble, collectivement, on peut s’amender et on peut aller vers le bien.
Aurélie Journo : La conclusion de Kusadikika est en effet optimiste, typique des contes. Tout est bien qui finit bien. En refermant le livre, on ne peut s’empêcher d’imaginer l’avènement d’une société plus juste du fait de l’intervention de Karama précisément. Il faudrait peut-être aussi lire ce livre en le replaçant dans son contexte de production, à savoir le début des années 1950, en pleine luttes anticoloniales en Afrique. Ce texte est une critique voilée du colonialisme d’une part, et d’autre part, on le lira comme une réflexion sur ce que pourrait être la société tanzanienne à venir, maîtresse de son destin. L’optimisme de Shaaban Robert inscrit Kusadikika dans cette volonté des écrivains de son temps de contribuer à la renaissance de leur société par le biais de la fiction.
Kusadikika, le pays du « sur parole », par Shaaban Robert. Traduit du swahili par Nathalie Carré et Aurélie Journo, avec les dessins de Patrick Singh. Editions Project’îles, 85 pages, 17 euros.



