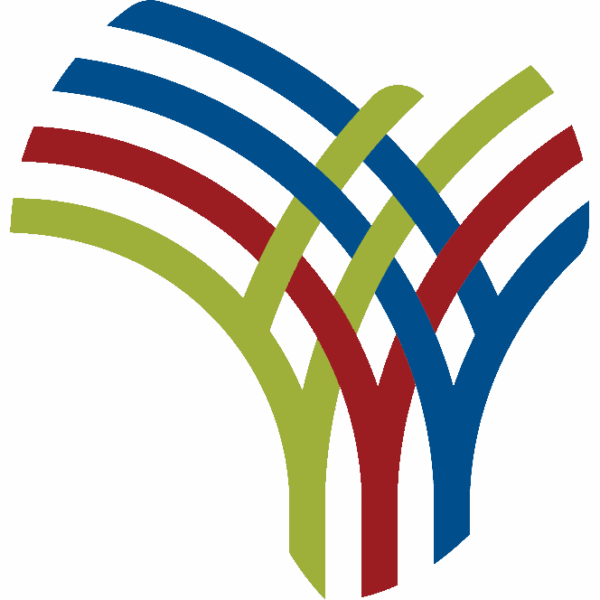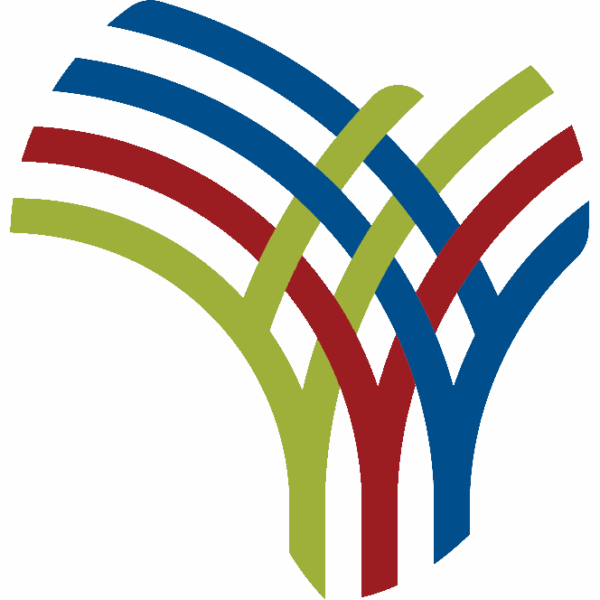Ile Maurice: Mais qu'en est-il de «l'hospitalité mauricienne» ?

Face à un déficit de main-d’oeuvre locale, les hôtels mauriciens recrutent massivement à l’étranger. Entre désintérêt des jeunes, émigration et exigences salariales, le secteur doit relever le défi de préserver son authenticité tout en assurant la continuité de ses services.
Le secteur hôtelier fait face à une pénurie de main-d’œuvre locale. De nombreux jeunes, jadis attirés par les métiers de l’hôtellerie et de la restauration, se détournent aujourd’hui de cette filière. Les horaires contraignants, les salaires jugés trop bas et la difficulté à concilier vie privée et professionnelle les poussent à chercher ailleurs de meilleures opportunités. Ce désintérêt s’ajoute à un autre phénomène : l’émigration.
Selon un rapport publié par AXYS en mars, plus de 182 000 Mauriciens vivent aujourd’hui à l’étranger, dont beaucoup en âge de travailler. Cet exode, lié aux écarts salariaux et aux perspectives professionnelles limitées, prive le pays de compétences locales et accentue le vide dans des secteurs comme l’hôtellerie.
Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres
D’autre part, le pays fait face à un déclin démographique. Plus de naissances et moins de décès, mais la migration internationale réduit le solde. Entre mi-2024 et mi-2025, la population mauricienne a diminué de 2 038 habitants, avec un solde migratoire négatif de 1 593 personnes.
«Travailler dans un hôtel, c’est accepter de passer les week-ends, les fêtes et les vacances loin de la famille», confie Akshay, un ancien employé reconverti dans un restaurant. Une autre jeune femme, qui a quitté son poste de serveuse, raconte qu’elle gagnait à peine assez pour couvrir ses dépenses mensuelles.
«Quand on compare l’effort fourni et le salaire, ça ne motive pas», dit Samantha Babajee. Face à ces contraintes, certains choisissent de partir à l’étranger, que ce soit en Europe, au Canada, en Australie, en Angleterre ou encore à bord de bateaux de croisière. «Ici, je n’avais pas de perspective. À l’étranger, je gagne plus et j’apprends davantage», explique Hemant, cuisinier désormais basé en Europe. Mais il nuance : «La pression est énorme et les longues heures sont partout. L’herbe n’est pas toujours plus verte.»
D’autres préfèrent rester au pays, mais en dehors du circuit hôtelier. «Dans un petit restaurant, je travaille moins d’heures et je peux rentrer chez moi plus tôt», explique Bryan Ramgutty, barman. Ces choix creusent un vide dans les hôtels, qui peinent à fidéliser du personnel local. Pour combler ce manque, le secteur a recours à la main-d’oeuvre étrangère.
Selon le ministre du Travail, Reza Uteem, plus de 30 000 travailleurs étrangers sont actuellement employés dans le pays. Il avait déclaré à l’Assemblée nationale, le 7 mars, que parmi eux, environ 4 000 se trouvent en situation irrégulière : 2 000 n’ont pas de permis de travail, leurs employeurs refusant de renouveler leurs contrats, et 2 000 autres sont portés disparus.
Ces travailleurs, venus d’Asie et d’Afrique, occupent aujourd’hui des postes clés dans les cuisines, le housekeeping, la restauration ou l’animation. Mais certains clients perçoivent un changement dans l’expérience hôtelière. «L’accueil n’est plus le même. On ne retrouve plus cette chaleur qu’on associait à l’hospitalité mauricienne», regrette Noor Shabazz, habitué des séjours en bord de mer. Une autre cliente ajoute :
«Parfois, les employés étrangers ne comprennent ni le français ni l’anglais et cela crée des malentendus.» Ces critiques, relayées par plusieurs vacanciers locaux, traduisent un malaise : le recours massif aux étrangers, s’il permet de maintenir les opérations, peut affecter l’authenticité de l’expérience touristique.
Toutefois, certains rappellent qu’il serait injuste de les blâmer. «Ils ont quitté leur pays et leurs familles pour venir ici. Ils contribuent à la croissance économique et aident à pallier le manque de staff. Il faut leur donner du temps pour s’habituer à notre culture et à nos langues»,souligne Suren Ramdeal, un ancien manager d’hôtel.
Les hôteliers
Bissoon Mungroo, président de la Small and Medium Hotels Association of Mauritius, explique que le secteur hôtelier est confronté à un manque crucial de main-d’oeuvre locale. Selon ses observations, beaucoup de jeunes ne restent que quelques mois. «Ils sont formés, obtiennent une attestation, puis partent travailler à l’étranger ou sur des bateaux de croisière. Certains ne restent que quelques semaines pour tester les conditions avant de partir.»
Face à cette situation, les hôtels n’ont pas d’autre choix que de recruter des travailleurs étrangers, malgré la lourdeur administrative que cela implique. Une fois recrutés, ces employés doivent suivre une formation de plusieurs mois pour s’adapter à la langue, aux systèmes et aux méthodes locales, même s’ils possèdent des diplômes élevés. Malgré cela, certains ne s’adaptent pas et souhaitent repartir rapidement.
Bissoon Mungroo souligne que ce phénomène entraîne une perte de l’hospitalité mauricienne et de l’authenticité locale. Selon lui, environ 80 % de cette authenticité est déjà perdue et seuls les employés ayant plus de 20 ans de service restent fidèles à ces valeurs. «Les jeunes recrues n’arrivent pas à s’adapter, et l’hospitalité perd ainsi une partie de sa valeur et de sa raison d’être. La différence salariale en euro et en dollar rend également la rétention des talents difficile, car elle n’est pas soutenable financièrement pour les hôtels locaux.»
Un directeur d’établissement hôtelier du nord souligne également que le recours aux étrangers est devenu une nécessité. «Nous n’avons pas le choix. Sans eux, certains départements ne pourraient tout simplement pas fonctionner. Bien sûr, l’idéal serait d’avoir une majorité de Mauriciens dans nos équipes, car cela correspond à l’image que nous voulons transmettre. Mais avec le désintérêt des jeunes, nous devons assurer la continuité du service et cela passe par l’internationalisation de notre main-d’œuvre», explique-t-il.
De son côté, une responsable des ressources humaines dans un hôtel de la côte ouest insiste sur les efforts consentis pour former ces recrues. «Le défi n’est pas seulement de recruter, mais d’intégrer ces travailleurs venus d’horizons différents. Nous organisons des ateliers linguistiques et des sessions de sensibilisation culturelle afin qu’ils puissent mieux communiquer avec les clients et comprendre nos spécificités locales. C’est un investissement à long terme, mais nécessaire pour maintenir un service de qualité», affirme-t-elle.
Les efforts pour former et intégrer les travailleurs étrangers sont essentiels dans tous les établissements, mais leur mise en pratique varie selon les structures et les profils des recrues. Selon Asso Khuttur, directeur de l’Association Villa, ces employés s’adaptent généralement bien une fois formés. «Il faut leur donner une formation, expliquer comment cela fonctionne à Maurice, et ils comprennent et appliquent», explique-t-il.
Selon lui, les travailleurs malgaches s’adaptent mieux car ils parlent français, et peuvent même parler anglais et kreol, tandis que les Indiens parlent surtout anglais et moins français. Même au niveau administratif, il souligne le manque de personnel capable de coopérer efficacement.
L’arrivée massive de travailleurs étrangers pose aussi la question de leurs permis et de leurs conditions de vie. Comment le gouvernement entend-il encadrer tout cela ? La réforme des permis de travail, validée par le Conseil des ministres, promet plus de transparence, de rapidité et de protection pour les travailleurs étrangers. Mais syndicats et acteurs du terrain pointent des zones d’ombre et réclament une véritable volonté d’application pour éviter que ces mesures restent lettre morte.
Le Conseil des ministres a donné vendredi son feu vert à la mise en œuvre des recommandations issues du rapport du comité interministériel sur les permis de travail. Présidé par le ministre du Travail et des relations industrielles, ce comité réunissant plusieurs ministres stratégiques et le secrétaire aux Affaires intérieures s’est attaqué à une problématique sensible : les lourdeurs et zones d’ombre dans le recrutement de travailleurs étrangers à Maurice
Au coeur de cette réforme, une mesure symbolique : la fin du système de quotas préétablis. Désormais, les employeurs devront démontrer l’impossibilité de recruter localement avant d’embaucher à l’étranger. Ce basculement vise à trouver un équilibre entre la préservation de l’emploi mauricien et la réponse aux besoins du marché. Autre changement majeur : la durée maximale de séjour des travailleurs étrangers est désormais fixée à dix ans, tous secteurs confondus.
Le gouvernement entend ainsi mieux encadrer la présence étrangère, tout en donnant une visibilité aux entreprises. La transparence dans le recrutement est également au menu. Les agences privées devront se plier à de nouvelles règles pour garantir éthique et efficacité. Parallèlement, Maurice signera des protocoles d’accord avec les pays sources afin d’assurer un flux régulier et ordonné de main-d’oeuvre étrangère.
Côté logement, le système évolue. Un permis spécifique (LAP) sera délivré directement aux propriétaires des dortoirs, déchargeant les employeurs de cette responsabilité. De plus, les demandes de LAP et de permis de travail pourront désormais être traitées en parallèle, évitant des délais jugés trop longs. Le gouvernement promet aussi une modernisation du système électronique national de permis, permettant une gestion simplifiée des demandes, annulations et exemptions.
Enfin, un fonds spécial alimenté par une contribution de Rs 500 par travailleur migrant et par an sera créé afin d’assurer leur bien-être, notamment en cas de litiges ou de difficultés de subsistance.
Si certains visiteurs constatent un changement dans l’accueil, les responsables hôteliers soulignent que ces employés découvrent la culture mauricienne et ont besoin de temps pour s’y familiariser.
Critiques des syndicalistes
Si le gouvernement se félicite de ces mesures, plusieurs syndicats émettent de sérieuses réserves. Reeaz Chuttoo, président de la Confédération des travailleurs du secteur privé (CTSP), déplore que certaines propositions clés aient été écartées. «Application for work permit will be able to be done online; migrant workers are a commodity that you shop online», lance-t-il, critiquant une logique de marchandisation de la main-d’œuvre.
Selon lui, la CTSP avait demandé que soit introduit un mécanisme de due diligence sur le respect des droits humains et du travail pour chaque demande de recrutement étranger, mais cette idée n’a pas été retenue. Il regrette également l’absence de garanties sur la protection sociale universelle, en ligne avec la Constitution qui interdit toute discrimination fondée sur l’origine. Quid du retour au pays des travailleurs en cas de violation avérée de leurs droits ?
Là encore, rien n’a été prévu, souligne-t-il. L’obligation d’obtenir l’aval du ministère du Travail avant toute décision de rapatriement par le Passport and Immigration Office a aussi été balayée. «Même la responsabilité des employeurs de fournir nourriture et logement en cas de litige a été transférée à un fonds dont on ne connaît pas les limites de financement», ajoute-t-il.
Pour Fayzal Ally Beegun, président de l’Union des travailleurs des industries textiles et alliées, ces amendements paraissent séduisants sur le papier, mais l’essentiel est leur mise en pratique. «Tous les cinq ans, des changements sont annoncés pour répondre aux critiques internationales sur le trafic humain. Mais depuis 30 ans, six gouvernements ont fermé les yeux sur des recruteurs véreux», accuse-t-il. Il insiste particulièrement sur la question des dortoirs.
«Il faut mettre fin aux poulaillers humains. Un minimum de quatre à six personnes par chambre est acceptable, mais pas des conditions indignes. Ces travailleurs doivent pouvoir installer une télévision, une table…»
Le syndicaliste rappelle que de nombreux travailleurs étrangers n’obtiennent pas de compensation à la fin de leur contrat et se retrouvent parfois à mendier devant le ministère du Travail pour obtenir de l’aide. D’où sa demande d’un fonds directement géré par l’État pour assurer nourriture et logement en cas de faillite d’entreprise. Il plaide également pour renforcer la Special Migrant Unit, qui manque cruellement d’inspecteurs. «Ils doivent pouvoir visiter régulièrement les dortoirs, mais leur sécurité doit aussi être garantie.»
Un équilibre à trouver
Fayzal Ally Beegun met aussi en garde contre l’exploitation des étudiants étrangers et des footballeurs recrutés localement. «Ces jeunes et ces sportifs doivent être suivis, leurs conditions de logement vérifiées et leurs agents contrôlés.» Du côté du Regrupman Artizan Morisien, la critique se concentre sur le déséquilibre entre travailleurs étrangers et opportunités locales. Pour Stéphane Maurymoothoo, le gouvernement privilégie depuis deux décennies l’importation de main-d’oeuvre, au détriment des Mauriciens.
«Beaucoup de nos travailleurs manuels sont partis vers l’Europe, l’Australie et maintenant, le Canada, faute de soutien ici. Même les jeunes formés par le Mauritius Institute of Training and Development ne trouvent pas leur place. Les entreprises les gardent un an, puis les laissent partir pour accueillir un nouveau groupe, moins coûteux.»
Il estime qu’au lieu de recruter massivement des étrangers dans le secteur hôtelier, le gouvernement aurait dû exiger que ces jeunes soient embauchés. «Les étrangers accueillent des étrangers ; l’expérience n’est pas la même», souligne-t-il, tout en pointant un manque de suivi politique.
Entre volonté affichée du gouvernement de moderniser les procédures et inquiétudes syndicales sur la protection réelle des travailleurs, la réforme des permis de travail soulève plus de questions qu’elle n’apporte de réponses définitives. La réussite de cette refonte dépendra non seulement de sa mise en oeuvre rigoureuse mais aussi de la capacité des autorités à écouter les syndicats, et à protéger à la fois les travailleurs étrangers et les opportunités pour les Mauriciens.
«Le véritable enjeu est la rétention des talents»
Quelles sont les principales raisons du manque de travailleurs locaux dans le secteur hôtelier ?
Ce n’est pas une question de formation ou d’attractivité du métier, mais plutôt d’absence de main-d’œuvre disponible. Le Covid-19 a laissé des cicatrices importantes. L’industrie touristique globale s’est effondrée et le travel trade également. Les petits et moyens opérateurs ont été particulièrement touchés financièrement. De nombreux employés et entrepreneurs se sont retrouvés dans l’incertitude. Certains opérateurs ont même perdu des actifs acquis.
Les coûts de production étant très élevés, le recrutement est également ralenti. Avant de remplacer un employé, les employeurs doivent évaluer combien la production augmenterait, ce qui ajoute à la prudence. Une combinaison de facteurs tels qu’incertitudes financières et conditions de travail poussent les demandeurs d’emploi à considérer d’autres opportunités ailleurs, contribuant ainsi au déficit de travailleurs locaux dans le secteur.
Quelles difficultés rencontrent les hôteliers lorsqu’ils recrutent des travailleurs étrangers, notamment pour préserver l’authenticité mauricienne dans leurs services ?
Les hôteliers rencontrent plusieurs difficultés. Tout d’abord, un établissement ne peut pas recruter une personne qui ne parle que l’anglais ou le français, car le marché est mixte et la maîtrise du kreol ou de la culture locale est souvent nécessaire, surtout pour les postes en contact direct avec les clients. Pour les fonctions qui ne sont pas directement en contact avec les clients, comme la cuisine, le recrutement est plus facile, mais le front office reste complexe.
L’hospitalité mauricienne est un atout majeur qu’il ne faut pas perdre. Un recours massif aux travailleurs étrangers pourrait diluer cette touche mauricienne, car ces employés ne peuvent pas transmettre l’authenticité locale aux visiteurs. Dans ce cas, l’expérience touristique pourrait ressembler davantage à celle d’un «bateau de croisière», où la destination perd sa singularité et son authenticité.
L’hôtellerie mauricienne peut-elle continuer à se distinguer à l’international si la proportion de travailleurs étrangers augmente ?
Beaucoup de destinations touristiques sont confrontées au même problème de manque de main-d’œuvre locale. Le véritable enjeu pour l’hôtellerie mauricienne est la rétention des talents. Si les jeunes continuent à partir à l’étranger et que le secteur dépend trop des travailleurs étrangers, il devient difficile de maintenir l’authenticité, qui est un atout clé pour se distinguer à l’international. Il est donc essentiel de mettre en place des stratégies pour retenir les employés locaux, et préserver la compétitivité et l’identité unique de notre hôtellerie.
Quelles solutions pourraient être envisagées pour attirer et retenir les talents ?
L’hôtellerie fait partie intégrante du secteur touristique et il est essentiel de travailler sur un plan de rétention à long terme. Retenir les jeunes ne dépend pas seulement de l’environnement de travail, mais aussi de leur offrir des perspectives de développement personnel et professionnel. Il y a une urgence à mettre en place une vision économique et sociale à long terme, capable d’inspirer la confiance des jeunes pour augmenter la capacité à retenir les talents locaux.
Propos recueillis par Olivia Edouard