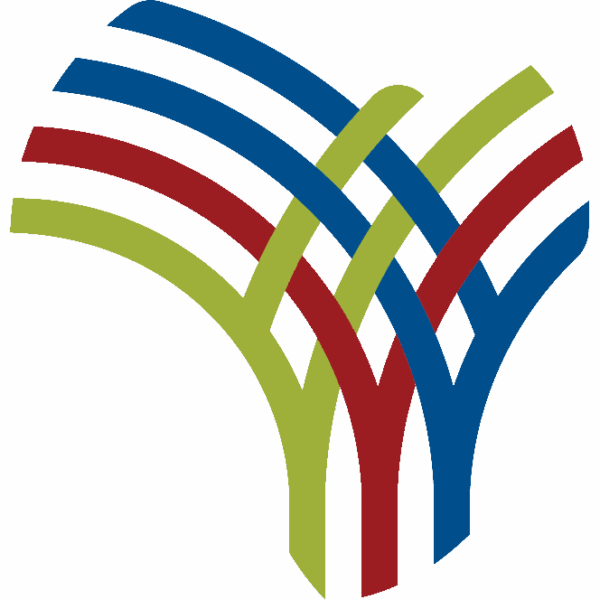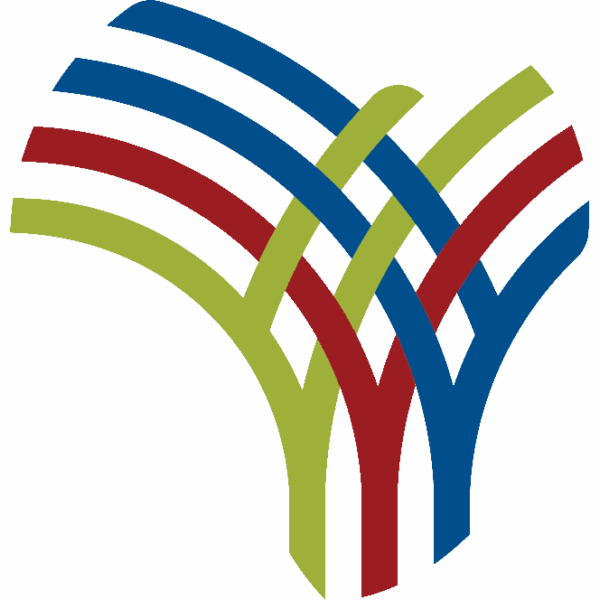Ile Maurice: Le pari risqué de la relance à crédit

Alors que les grandes économies s’enlisent dans une spirale d’endettement postpandémie, la question de la soutenabilité refait surface à Maurice.
Les dernières statistiques du ministère des Finances, au 30 septembre 2025, indiquent une hausse de Rs 26 milliards depuis mars, portant la dette publique à Rs 654 milliards, soit 89,3 % du Produit intérieur brut (PIB). Un chiffre qui dépasse la simple technicité budgétaire et illustre la dépendance croissante d’une économie insulaire qui, malgré une reprise graduelle, continue de financer sa résilience par la dette.
Indicateur économique à forte charge émotionnelle, la dette est devenue un symbole politique. Elle a été au coeur de la dernière campagne électorale, l’Alliance du changement ayant fustigé la gestion de l’ancien régime. Les projections initiales pour 2024-25 tablaient sur Rs 574 milliards, soit 71,9 % du PIB. Mais le Budget 2025-26, présenté par le tandem Navin Ramgoolam – Paul Bérenger, a révisé cette estimation à Rs 642 milliards, frôlant les 90 % du PIB.
Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres
Dans les faits, cette montée de l’endettement s’explique par plusieurs facteurs : l’intégration de dettes parapubliques (Rs 30,7 milliards) dans la dette consolidée, dont Rs 7,6 milliards pour le Central Electricity Board ; l’explosion des dépenses sociales, conséquence des promesses électorales et de la flambée du coût de la vie: les prestations sociales, dont les pensions, représentent désormais près d’un tiers des dépenses courantes (Rs 235,5 milliards) ; et une trésorerie généralement tendue au cours du premier trimestre de l’exercice budgétaire, traduisant un décalage structurel entre les flux de trésorerie entrants (principalement les recettes fiscales et autres revenus) et les flux sortants (dépenses budgétaires), selon le ministère des Finances.
Au-delà de ces causes structurelles, le train de vie de l’État reste un gouffre récurrent. La dette du gouvernement central est passée de Rs 558 milliards (79 % du PIB) en mars à Rs 590 milliards (80,6 %) en septembre 2025. Une hausse qui résulte d’emprunts élevés destinés à couvrir les besoins de financement d’un appareil public toujours aussi coûteux, sur fond de croissance molle.
Ce déséquilibre relance un débat récurrent : faut-il réduire les dépenses publiques ou continuer de miser sur une relance à crédit ? Le dilemme n’est pas propre à Maurice : la France peine elle aussi à faire voter un budget équilibré, tandis que la Commission européenne plaide pour des trajectoires budgétaires plus crédibles. Mais pour Maurice, le pari est risqué : cette stratégie repose sur l’hypothèse d’une croissance durablement supérieure au coût moyen de la dette, une condition encore loin d’être acquise.
Maurice n’est pas un cas isolé. La dette publique globale atteint aujourd’hui plus de 93 % du PIB mondial, contre environ 84 % avant la pandémie, selon le Fonds monétaire international (FMI). Aux États-Unis, elle dépasse 120 % du PIB et le paiement des intérêts sur la dette fédérale a excédé les dépenses de défense en 2024. En Europe, la France et l’Italie évoluent entre 110 et 145 % du PIB tandis qu’au Japon, elle dépasse 250 % du PIB, un record mondial.
Cette flambée n’épargne pas les économies émergentes, où les vulnérabilités sont plus aiguës : la dette moyenne avoisine 70 % du PIB et le service de la dette absorbe une part croissante des recettes publiques. Des pays comme la Zambie, le Ghana ou le Sri Lanka ont déjà dû restructurer leur dette, révélant la fragilité d’un modèle trop dépendant de l’emprunt.
Dans ce paysage, Maurice se situe dans une zone grise : son endettement est élevé, mais encore soutenable, grâce à la stabilité de ses institutions, à la solidité de son système bancaire et à une gestion monétaire prudente. Cependant, sa dépendance à la dette interne, la concentration des emprunts dans les mains d’institutions publiques et la faiblesse relative des marges fiscales limitent sa flexibilité budgétaire.
La vraie question : emprunter pour quoi ?
Le débat ne devrait pas se focaliser sur le montant de la dette, mais sur sa qualité économique. Une dette qui finance des infrastructures, modernise le système énergétique ou stimule la productivité peut devenir un levier de croissance et améliorer la soutenabilité à long terme. Mais une dette, qui finance la consommation courante, des subventions électoralistes ou des dépenses sans rendement économique, devient un fardeau structurel.
Maurice se trouve aujourd’hui à un tournant stratégique : les investissements massifs dans les routes, les logements sociaux ou la transition énergétique doivent impérativement produire des retombées mesurables. Or, la transparence budgétaire reste limitée et la distinction entre dette productive et dette de fonctionnement demeure floue. Tant que la gestion de la dette restera perçue comme un instrument politique plutôt qu’un outil de stratégie économique, le pays courra le risque d’un glissement durable vers ce que certaines appellent «l’endettement de confort».
Les économistes n’écartent pas le risque d’un debt trap, ce cercle vicieux où la faible croissance contraint les recettes fiscales, obligeant l’État à emprunter davantage, ce qui alourdit à son tour les charges d’intérêts. Selon la Medium Term Macroeconomic Framework, Fiscal Strategy and Debt Management Strategy 2024-2028, le ratio du service de la dette augmentera de 3,2 % du PIB actuellement à 3,4 % du PIB à moyen terme, soit inférieur au seuil de 6 % du PIB fixé comme plafond, mais il absorbe déjà une part croissante des ressources publiques – au détriment des dépenses d’avenir, comme l’éducation ou la recherche.
Face à cette dérive, certains plaident pour l’adoption d’une règle d’or budgétaire, limitant le ratio dette/PIB – à l’image de la règle européenne des 60 % ou des programmes d’ajustement du FMI. Les arguments en faveur sont clairs : une telle règle renforce la crédibilité macroéconomique ; rassure les investisseurs et les agences de notation ; et évite de transférer le coût des choix politiques actuels sur les générations futures.
Mais cette rigueur a un revers : une règle trop stricte limiterait la capacité d’action en période de crise, sans distinguer la nature de la dépense – investissement ou consommation. Dans une économie insulaire vulnérable aux chocs externes (cyclones, chute du tourisme, flambée des prix mondiaux), une certaine flexibilité budgétaire reste indispensable.
Une approche plus réaliste, soulignent les spécialistes consisterait à définir une trajectoire de réduction progressive : ramener la dette à 75 % du PIB d’ici 2030, avec des clauses d’ajustement en cas de choc externe. Le gouvernement vise déjà une baisse modeste, de 90 % du PIB en juin 2025 à 88 % en juin 2026.
Derrière les chiffres, se cache une réalité politique : la qualité de la gouvernance financière. Tant que les institutions de contrôle resteront faibles, que les audits publics tarderont et que la transparence budgétaire sera partielle, toute règle d’endettement restera théorique.
La dette n’est pas un mal en soi ; elle devient problématique lorsqu’elle remplace la réforme, lorsqu’elle diffère les choix difficiles ou sert à acheter du temps politique. Le véritable débat pour Maurice ne devrait donc pas être : combien pouvons-nous emprunter ? mais plutôt : pour quoi empruntons-nous ? Dans un monde où les taux d’intérêt remontent, où les investisseurs deviennent plus sélectifs et où les agences de notation surveillent chaque dérapage, la prudence budgétaire n’est plus un luxe, mais une nécessité stratégique.
Maurice doit désormais trouver un équilibre lucide entre ambition économique et discipline financière – faute de quoi, la relance à crédit pourrait se transformer en dépendance à la dette.