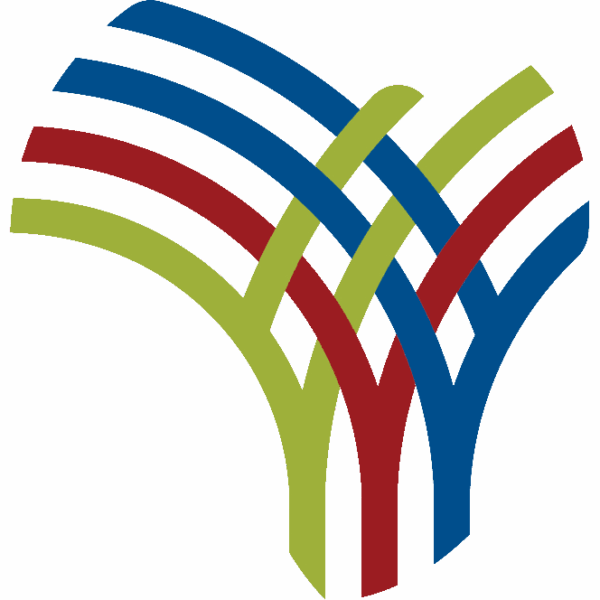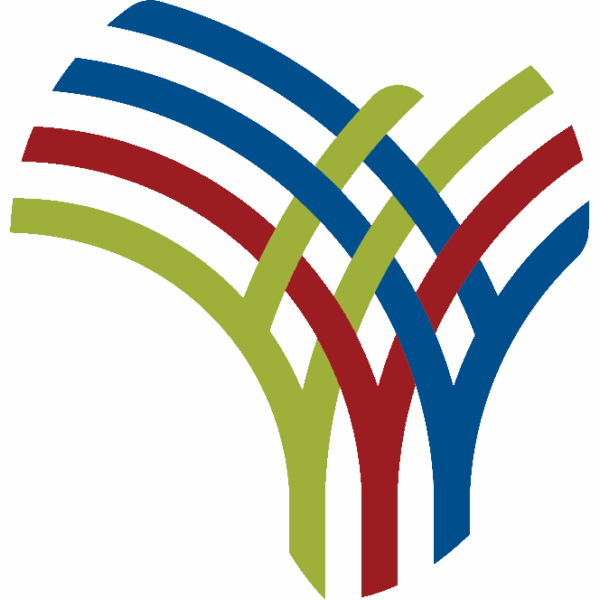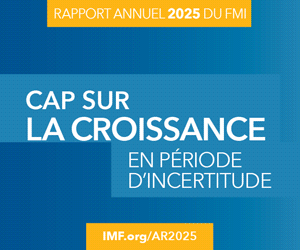Ile Maurice: La leçon botswanaise – Quand un écosystème vaut mieux qu'un éclair de génie

Au-delà de l’émotion, l’athlétisme botswanais rappelle une vérité froide : les médailles se planifient. En septembre 2025 à Tokyo, le Botswana a conquis l’or du 4×400 m dans un final d’anthologie (2:57.76), arrachant la victoire aux États-Unis, tandis que Busang Collen Kebinatshipi devenait champion du monde du 400 m dans un record national (43.53) au coeur d’une finale qui comptait trois Botswanais. Un signe de profondeur rare sur le tour de piste. Un an plus tôt, Letsile Tebogo avait offert au pays sa première médaille d’or olympique en remportant le 200 m à Paris (19.46, record d’Afrique), symbole d’une bascule durable vers l’excellence.
Flashback, Brazzaville 2004
Sur la piste du 400 mètres, l’Afrique vibrait aux exploits d’Éric Milazar, auteur d’un sacre historique pour Maurice (triple champion d’Afrique). Derrière lui, le Kényan Ezra Sambu et le Zimbabwéen Talkmore Nyongani complétaient le podium, tandis que le Botswana repartait bredouille :
Johnson Kubisa terminait 7e et Oganeditse Moseki ne franchissait même pas le cap des demis. Vingt ans plus tard, le contraste est saisissant. Le Botswana a patiemment construit une véritable pépinière de sprinters qui brille aujourd’hui sur la scène mondiale, alors que l’athlétisme mauricien n’a pas su prolonger l’élan de son âge d’or.
Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres
De la filière à la culture : l’architecture botswanaise
Si le Botswana gagne aujourd’hui, c’est parce qu’il a commencé hier. Le pays a bâti une filière complète : un programme communautaire de développement piloté par la Fédération (BAA) pour détecter, former et accompagner les talents dès 5 ans, et une trame institutionnelle via la Botswana National Sport Commission avec le programme «Re Ba Bona Ha»(«on les voit ici»), qui identifie et encadre la pratique dès l’école.
Cette logique s’inscrit dans une vision de long terme avec le Botswana Long-Term Athlete Development (BLTAD), une progression planifiée de l’initiation jusqu’au haut niveau.
Ce maillage vertical est renforcé par la compétition à domicile : le Botswana Golden Grand Prix (ex-Gaborone International Meet) a été hissé au rang du World Athletics Continental Tour Gold, amenant l’élite mondiale jusqu’au Botswana et offrant aux locaux un banc d’essai de classe internationale sans quitter le pays. Ce pont entre base et sommet alimente l’ambition et normalise l’exigence, année après année.
Le pipeline de talents : former, garder, faire progresser
La force botswanaise, c’est la continuité. Tebogo s’est d’abord construit au pays, sous la houlette du coach Kebonyemodisa «Dose» Mosimanyane, preuve qu’un encadrement local compétent peut faire éclore un champion olympique sans exil systématique, des stages ciblés venant ensuite compléter la progression. Dans la même veine, Kebinatshipi et Ndori illustrent la densité en sprint long, avec un relais 4×400 m présent au plus haut niveau depuis plusieurs saisons.
Isaac Makwala, autre spécialiste du 400 m, a été un fer de lance de cette montée en puissance botswanaise. Ses mots résonnent comme un manifeste de politique publique : «Mes défis m’ont façonné… je remercie mes entraîneurs, mes professeurs et le gouvernement qui ont cru en moi.» La réussite individuelle s’arrime à un système école-club-fédération-État qui accompagne l’athlète de bout en bout.
Jeunesse et cap politique
La trajectoire récente du ministère en charge de la jeunesse et du genre, avec un passage de témoin après 2024, a prolongé ce cap en faveur de la jeunesse et de l’égalité, avec une nomination remarquée : Lesego Chombo, 26 ans, devenue ministre en novembre 2024. Au-delà du symbole, ce choix, cohérent avec l’investissement dans la jeunesse, consolide un environnement où le sport est levier de mobilité et d’identité nationale.
Rien n’est toutefois linéaire. Le Botswana a connu des accrocs de gouvernance (suspension des sports scolaires pendant la pandémie, tensions d’organisation autour du Golden Grand Prix 2024). Mais c’est précisément parce que la colonne vertébrale détection-coaching-compétition existe que le pays a encaissé ces à-coups sans briser sa dynamique de performance.
Maurice après Milazar et Buckland : un modèle sans système…
À Maurice, Éric Milazar (record national du 400 m, triple champion d’Afrique) et Stéphan Buckland (finales mondiales, triplé or aux Jeux de la Francophonie, argent aux Jeux du Commonwealth) ont incarné l’excellence. Mais ils l’ont souvent portée seuls, Buckland s’appuyant même sur le Centre IAAF de Dakar pour structurer sa progression.
Après eux, la filière s’est grippée : pas de relais compétitif, pas de densité en sprint long, seulement des «pics» isolés. À titre d’exemple, Noa Bibi est le détenteur des records nationaux du 100 m (10.11) et du 200 m (19.89). Il est devenu le premier Mauricien à passer sous la barre des 20 secondes dans cette discipline. Mais une hirondelle ne fait pas le printemps de l’athlétisme mauricien.
Sauf que le handisport montre la voie
C’est dans le handisport que Maurice a trouvé un modèle gagnant. Noém ie Alphonse a décroché l’or mondial 2024 (100 m T54 à Kobe) après l’argent en 2023 à Paris, puis a joué le podium aux Jeux de Paris (4e sur 100 m T54), confirmant un projet de haut niveau stable.
Anaïs Angeline est devenue vice-championne du monde de saut en longueur T37 dames à Kobe. Yovanni Philippe a offert à Maurice sa première médaille paralympique (bronze sur 400 m T20 à Paris 2024). Leur parcours prouve que lorsque détection, encadrement et planification sont réunis, la performance suit. Ce schéma doit désormais inspirer l’athlétisme valide.
Politiques sportives : l’écart entre vision et réalité
Le pays ne manque pourtant pas de textes : la Politique nationale Sport & Activité Physique 2018-2028 diagnostique une pratique insuffisante (seulement 23 % d’adultes au seuil OMS) et surtout l’absence d’un centre clair d’imputabilité pour le haut niveau, un vide que Team Mauritius devait précisément combler. Sur le papier, tout y est. Dans les faits, l’implémentation reste incomplète : manque d’alignement écoleclub, faiblesse du coaching structuré et calendrier domestique trop pauvre en meetings de référence.
Éric Milazar l’a dit avec lucidité: «Il faut être patient avec nos jeunes sportifs, mais surtout leur donner les moyens.» Stéphan Buckland l’a aussi rappelé : «Malheureusement, je constate qu’en 2024, les mêmes problèmes persistent où les perdants sont toujours les athlètes. C’est comme si on travaillait toujours au petit bonheur la chance, on ne prévoit pas le sport de haut niveau.» Voilà le coeur du problème : la patience ne remplace pas la structure. Sans programme national de relève qui agrège préparation physique, technique, médicale et psycho-sociale, les talents s’étiolent entre deux saisons.
Que faire maintenant ? Six décisions concrètes, inspirées de Gaborone
Unifier la base : relancer un programme national de détection 6-16 ans sur le modèle Re Ba Bona Ha, avec des centres régionaux et un suivi individuel digitalisé (tests trimestriels).
- Professionnaliser le coaching : bourses de certification World Athletics pour 10 entraîneurs par an, tutorat par des experts africains (Kenya, Botswana, Sénégal).
- Créer un meeting de référence : candidater à un Continental Tour (Bronze/Silver) à Côte-d’Or, pour donner à nos jeunes une ligne d’horizon annuelle et attirer la concurrence régionale.
- Aligner école-club-sélections : un seul référentiel de performance (tables WA) pour les convocations en équipes nationales et l’accès aux aides Team Mauritius.
- Parité valide/para : mutualiser les cellules de préparation (maté- riel, biomécanique, nutrition) entre athlétisme valide et handisport.
- Transparence et cap : publier annuellement un tableau de bord (licenciés, records, minima, médailles) et lier financement public et indicateurs pour créer une responsabilité partagée.
Conclusion : passer du récit au système
Le Botswana ne nous humilie pas, il nous éclaire. Il montre comment un pays de taille moyenne peut, grâce à une école d’athlétisme structurée, des coachs outillés, un meeting-vitrine et un cap politique lisible, produire des finalistes par grappes plutôt que des héros isolés.
À Maurice, Milazar et Buckland ont allumé la flamme du talent mauricien. Alphonse, Angeline et Philippe ont montré qu’avec une organisation solide, cette flamme peut durer. Ce qu’il reste à construire, c’est le foyer qui rassemble et entretient ce feu pour toute une génération.
Comme le résume Makwala, devenu mentor d’une génération: «Mes défis m’ont façonné», mais ils l’ont fait parce qu’un système l’accompagnait. À nous de bâtir ce système, maintenant.