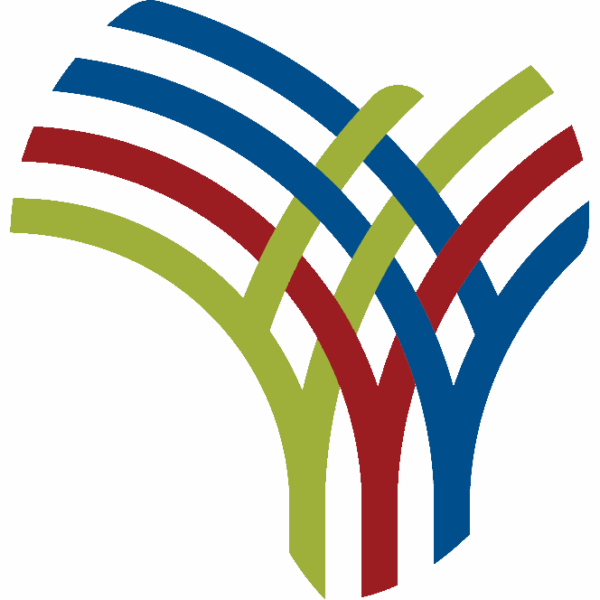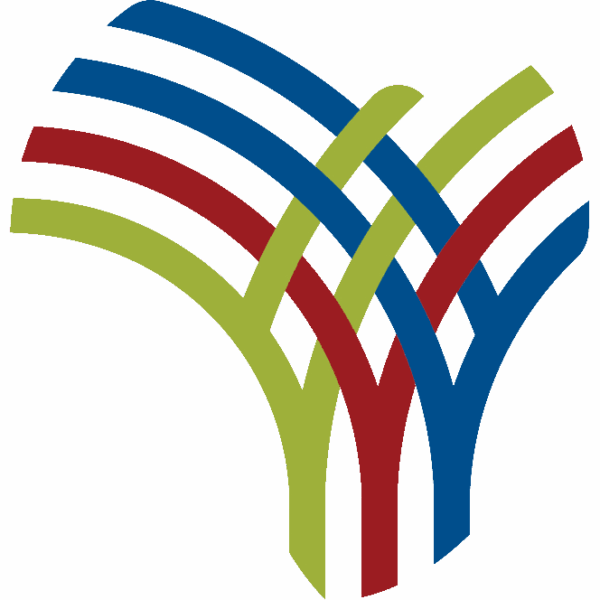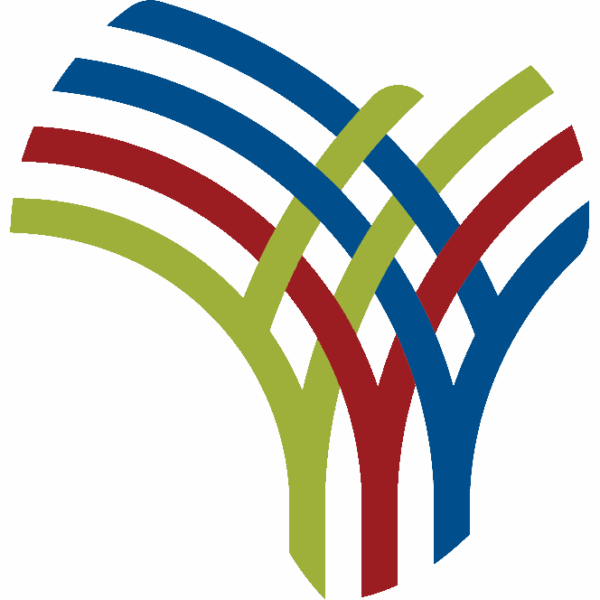Ile Maurice: Joseph Gabriel Semeon – L'Histoire à l'heure de vérité

Démarche atypique que celle de Joseph Gabriel Semeon. Celle d’interpeller historiens et citoyens. Aux premiers, l’auteur, un ancien fonctionnaire âgé de 85 ans, demande de «faire des recherches et (…) non pas de laisser perdurer des non-vérités».
Aux seconds, il réclame «d’avoir un esprit critique, ouvert et sans préjugés». Même si on n’est pas d’accord avec la méthodologie ou plutôt l’absence de méthodologie de ce petit ouvrage, «Quelques incongruités de l’histoire de l’île Maurice» de Joseph Gabriel Semeon est de ces curiosités qui disent bien plus qu’elles n’en ont l’air.
Il prends des pincettes. Demande dès le départ aux lecteurs d’être «indulgents et d’avoir un esprit critique, ouvert et sans préjugés». Met en avant son grand âge en précisant qu’il est né en 1941. Pourquoi est-ce que Joseph Gabriel Semeon prend-il autant de précautions dans Quelques incongruités del’histoire de l’île Maurice ? Son premier ouvrage imprimé par les éditions Le Printemps a été lancé récemment.
Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres
C’est que l’auteur, un fonctionnaire à la retraite, fait la chasse à ce qu’il nomme pudiquement des «non-vérités». Les questions qui le travaillent : «d’où sont venus les habitants de Maurice», «d’où viennent les connotations», «les places et les lieux qui changent de place». Pour Joseph Gabriel Semeon, «répéter une non-vérité (…) ne lui donne pas un semblant de vérité. Cela ne lui donne pas une virginité».
Au fil des chapitres, l’auteur égrène lui-même quelques énormités, (re)découvre que le kreol morisien a aussi des racines réunionnaises. Tente d’égratigner le Diksioner morisien. Postule qu’au départ des Hollandais au 17e siècle, des Javanais «avaient décidé de rester car la nourriture n’allait pas manquer» dans l’île.
On peut ne pas être d’accord avec ce qu’écrit Joseph Gabriel Semeon. Ni avec le fond, ni avec la forme, ni surtout avec la méthodologie, ou plutôt l’absence de méthodologie. Car pour prouver ses affirmations, que fait l’auteur ? Il nous rapporte des bribes de conversations avec des interlocuteurs qui restent dans l’ombre. Il ne fournit pas la moindre bibliographie pour étayer les «recherches» qu’il affirme avoir menées. Et tout au long de son récit, il se fie à ce que d’autres lui ont dit.
«Non-vérités»
Or, cela est contreproductif. Comment mettre à mal des «non-vérités» sans apporter la démonstration éclatante de leur inexactitude ? Les sources de l’auteur sont systématiquement anonymes. Avec seulement des initiales cryptiques, dont il est seul à connaître l’identité. Son propos est aussi émaillé de quelques préjugés, dont il aurait fallu épargner le lecteur. Les références à l’apparence physique d’un tel ou de tel autre sont bien trop récurrentes.
Une fois que le lecteur a surmonté ces obstacles, c’est la posture, l’esprit de l’auteur qu’il faut retenir. Voilà un aîné qui nous dit en substance de ne pas prendre les faits pour acquis. De ne jamais cesser d’apprendre. Et de cultiver l’esprit critique. Message salutaire. Tout comme son envie – même maladroite – d’interpeller les historiens, les concitoyens, pour nous inciter collectivement à améliorer les connaissances. À toujours en savoir plus pour ne pas perpétuer les stéréotypes.
Le fond de ce que dit Joseph Gabriel Semeon c’est : apprenons l’histoire. Et par ce processus, approchons – même de loin – de la vérité. D’ailleurs, y a-t-il des vérités en histoire ? S’il y a sans aucun doute des faussetés, les vérités historiques, elles, sont à prendre avec des précautions car elles dépendent aussi de l’état des connaissances à un moment donné. L’accès à des archives déclassifiées, par exemple, jette parfois un éclairage différent sur des épisodes que l’on croyait connaître.
Pourquoi est-ce qu’un citoyen sans formation en histoire, a décidé d’écrire sur le sujet ? Flash-back. Retour en 1985. Joseph Gabriel Semeon est devenu père de famille. Il lui prend de raconter un peu de l’histoire de Maurice, «soi-disant» à son fils. Pourquoi «soi-disant» ?
«Je disais certaines vérités que je croyais bonnes.» Comme l’origine des esclaves, venus du Sénégal, de l’île de Gorée, etc. Réaction de l’enfant : «Daddy, you must be joking». «True the slave traders took their wares (people) from Gorée island. It would have been impossible for them to have done the trip down the coast of West Africa to Mauritius in their not so strong wooden sailing boat.
Don’t you know that from the north western coast of Africa which includes Senegal-down, there are all year round very strong trade winds which blow westward towards South Atlantic and the Americas. Also the seas on and along the west and east coast of South Africa towards Mozambique are always very rough. Who are the traders, the world over, who would knowingly wish to expose themselves to danger, to die and lose their wares?» Le père semble n’avoir jamais digéré cette conversation. Il l’a portée pendant plus de 40 ans. La réponse, il ne s’est mis à l’écrire qu’en 2020.
Parcour
Un long parcours dans la fonction publique. C’est ce qu’a accompli Joseph Gabriel Semeon. Il commence à la douane, fait le tour de divers départements de l’«Income Tax» à la section qui s’appelait alors «Family Allowance». Il passe par le ministère de l’Agriculture, travaille sur l’épidémie de la gommose, de la canne, qui faisait que «le jus ne cristallisait pas». Il est par la suite affecté au ministère de l’Education, est envoyé dans l’administration du collège Royal.
Avant d’être muté au haut-commissariat mauricien en Inde. Il y restera 16 ans. «Je crois que c’est un record.» Après les heures de travail, il étudie le commerce à l’université de Delhi. Ses deux fils naissent en Inde. Que faisait-il au haut-commissariat de Maurice en Inde ? «On s’occupait de tout, parce qu’il n’y avait pas de personnel à l’époque», confie l’auteur. Par la suite, il sera envoyé au haut-commissariat à Canberra en Australie.