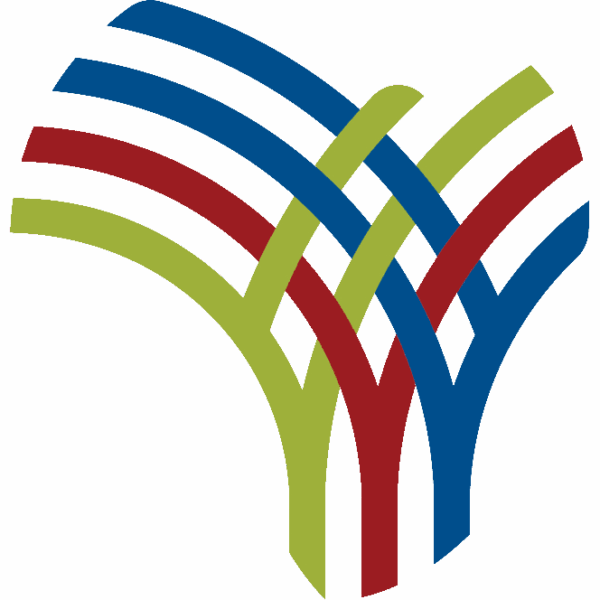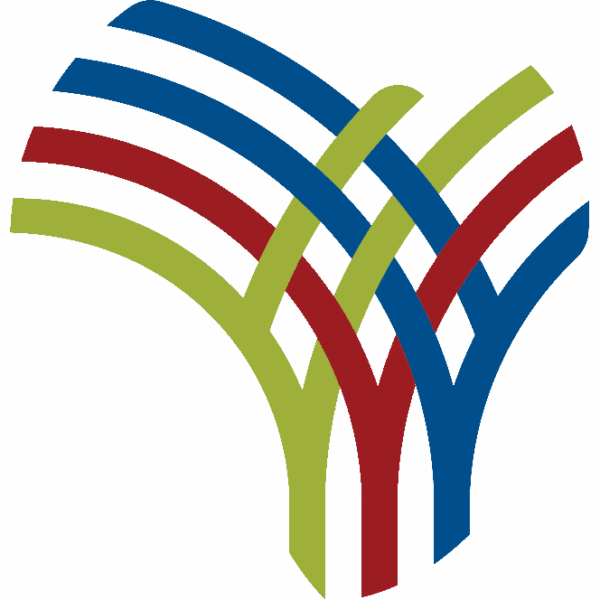Afrique: Une santé publique réactive exige patience et concentration

« Dans 25 ans, vous devriez être devenus inutiles. »
C’est par ces mots que Liz Jarman, consultante en santé mondiale, a provoqué un silence dans la salle lors de l’événement organisé pour le 25e anniversaire de VillageReach.
Son message était clair : si, dans plusieurs décennies, les organisations à but non lucratif sont toujours nécessaires pour combler les lacunes des systèmes de santé, c’est que nous avons échoué. Mais si les organisations à but non lucratif peuvent catalyser l’innovation et prendre des risques, le véritable succès signifie que les gouvernements et les communautés prennent en main leur propre avenir en matière de santé, sans l’aide d’organisations externes.
Une autre organisation qui fêtera ses 25 ans en 2025, la Fondation Gates, est allée plus loin : elle a fixé une date butoir pour toutes ses opérations, à savoir 2045. Elle a reconnu que des investissements accélérés sur une période déterminée peuvent favoriser le changement, mais qu’une date butoir permet de rester concentré sur l’objectif.
Une action durable en faveur de la santé nécessite de la patience et une vision qui va au-delà du prochain cycle de subventions.
Une innovation durable grâce à la mise en œuvre des connaissances communautaires
Les crises de santé publique, d’Ebola à la COVID-19, ont révélé le coût élevé des solutions rapides et des investissements fragmentés. Trop souvent, de nouveaux projets pilotes voient le jour dans l’urgence, pour ensuite disparaître faute d’intégration dans les systèmes de santé. Les innovations durent lorsqu’elles répondent aux expériences vécues par les communautés et aux priorités des gouvernements. Être réactif ne signifie pas seulement s’attaquer aux symptômes, mais aussi mettre en place des systèmes capables d’écouter, de s’adapter et de perdurer.
Le système de santé ne peut fonctionner pour les citoyens que s’il est à leur écoute.
C’est là le cœur de l’approche Community Insights to Action (CITA). Au lieu de concevoir des solutions de manière descendante, nous commençons par demander aux communautés, en particulier celles qui sont souvent négligées, ce qui compte le plus pour elles. Leurs réponses déterminent la manière dont les services sont fournis, les politiques élaborées et les programmes planifiés.
Mais cela ne s’arrête pas là. La boucle est bouclée lorsque l’approche CITA permet de montrer aux communautés comment leur voix a conduit à un réel changement. Ce retour d’information renforce la confiance, renforce la responsabilité et permet de poursuivre le dialogue.
Il ne s’agit pas seulement d’une méthode, mais d’un changement de mentalité qui place les personnes au centre des systèmes qui les servent, et qui est innovant par nature. Avec l’approche CITA, nous garantissons des systèmes de santé qui ne stagnent pas, mais qui sont continuellement renouvelés grâce de nouvelles idées et à de meilleures façons de faire les choses, fondées sur les réalités de ceux et celles qui sont le plus souvent exclus.
Pourquoi la réactivité est-elle importante aujourd’hui ?
La réactivité signifie que les soins de santé sont disponibles quand et où ils sont nécessaires, qu’ils peuvent s’adapter à l’évolution des demandes, absorber les chocs et refléter les priorités des personnes qu’ils servent. Cela est plus important que jamais à une époque où les budgets de la santé diminuent, où les contributions des donateurs sont imprévisibles et où les gouvernements doivent faire des choix difficiles en raison de ressources limitées. Cela est important parce que les inégalités se creusent, les personnes vivant loin des établissements de santé, les migrants et les groupes marginalisés étant exclus des gains en matière de soins de santé des 50 dernières années. Et cela est important parce que nos systèmes sont confrontés à des chocs croissants liés aux pandémies, aux catastrophes climatiques et aux déplacements de population, qui exigent de la flexibilité plutôt que de la rigidité.
Or, le contexte financier actuel va dans le sens contraire. Lorsque les financements diminuent, les horizons se rétrécissent souvent. Les bailleurs de fonds et les gouvernements peuvent être tentés de donner la priorité à des projets qui donnent des résultats rapides, mais qui ne sont pas viables à long terme. Cela conduit à une duplication des efforts, à un gaspillage des ressources et à des initiatives qui disparaissent lorsque le financement prend fin.
Il est plus important que jamais de résister au piège des solutions rapides et d’investir dans des approches durables.
Une philosophie pratique ancrée dans les endroits les plus difficiles
VillageReach a été fondé au Mozambique à la suite du cyclone Eline en 2000. Dès le début, sa philosophie a été de concevoir d’abord des solutions pour les environnements les plus défavorisés, car si elles fonctionnent là-bas, elles peuvent fonctionner partout.
Ce principe fondateur reste d’actualité, en particulier dans la manière dont nous nous engageons auprès des communautés les plus souvent laissées pour compte, notamment les femmes qui n’ont pas accès à des soins de maternité sûrs, les familles rurales confrontées à des ruptures de stock de vaccins et les jeunes privés d’informations fiables sur la santé. À partir de là, l’approche CITA renforce progressivement la réactivité du système grâce à un engagement profond auprès des communautés, à l’analyse des informations recueillies, à leur traduction en actions au niveau du système et à leur intégration dans les processus gouvernementaux, bouclant ainsi la boucle.
Au fil du temps, les systèmes deviennent non seulement plus solides, mais aussi plus innovants. Mais il ne s’agit pas d’une solution miracle.
Pas de raccourcis dans la conception des systèmes
Nous avons constaté que la conception complète d’un système jusqu’à la fermeture de la boucle avec les communautés prend plus de temps que les 6 à 12 mois prévus par la plupart des programmes. Il faut du temps pour atteindre les groupes marginalisés dans les langues locales grâce à des intermédiaires de confiance. Il faut du temps pour passer du retour d’information à la transformation. Il faut du temps pour équiper les agents de santé et les gestionnaires afin qu’ils puissent diriger et intégrer leurs bonnes pratiques dans les systèmes existants. Et il faut du temps pour retourner dans les communautés et leur montrer comment leurs contributions ont façonné le changement.
Cette approche délibérément progressive porte clairement ses fruits. Au Mozambique, lorsqu’une rupture nationale des stocks de vaccins a semé l’inquiétude chez de nombreuses mères, la hotline AlôVida, qui utilise l’approche CITA, est devenue une bouée de sauvetage. Une innovation WhatsApp a permis aux femmes de poser des questions, de chercher à être rassurées et d’exiger des réponses. En RDC, les données issues de CITA ont aidé à déterminer en priorité quand et comment mettre en œuvre des « stratégies de vaccination spéciales » dans les zones difficiles d’accès, afin d’améliorer la couverture vaccinale là où elle était le plus nécessaire. Au cours des cinq dernières années, l’initiative communautaire Next Generation Supply Chain en RDC a permis à la moitié des provinces du pays de passer du niveau le plus bas à l’un des meilleurs en matière de disponibilité des vaccins. Ces progrès ne sont pas le fruit d’une précipitation, mais d’améliorations constantes et itératives, alignées sur les priorités gouvernementales assorties de délais précis.
La leçon à en tirer est que nous devons planifier sur plusieurs décennies, mais fixer des étapes intermédiaires qui obligent à progresser.
Construire pour durer
Les systèmes réactifs atteignent les communautés auparavant laissées pour compte. Ils sont plus résilients, car ils peuvent absorber les chocs et maintenir la continuité. Ils inspirent davantage confiance, car les gens voient que leurs voix mènent à des actions. Et ils sont plus innovants, car les retours d’information, les actions et la responsabilité suscitent de nouvelles idées dans tout le système.
Dans les moments d’incertitude, la tentation est de privilégier la rapidité. Mais ce qu’il faut vraiment, c’est faire preuve de patience pour intégrer la réactivité dans les systèmes centraux et renforcer son appropriation durable par les gouvernements. Les bailleurs de fonds, les gouvernements et les responsables de la mise en œuvre doivent résister à la tentation de la vision à court terme et s’engager plutôt dans des approches routinières, réactives, itératives et conçues pour durer. En réduisant les doublons et en instaurant la confiance, nous pouvons obtenir de meilleurs résultats pour chaque dollar investi.
La bonne question n’est pas « à quelle vitesse pouvons-nous le faire ? », mais « comment pouvons-nous le construire au mieux et quand pouvons-nous commencer ? ». L’Afrique a le talent, la volonté et les innovations nécessaires. Ce dont nous avons besoin maintenant — gouvernements, bailleurs de fonds et responsables de la mise en œuvre — c’est de patience et de concentration pour construire des systèmes de santé durables