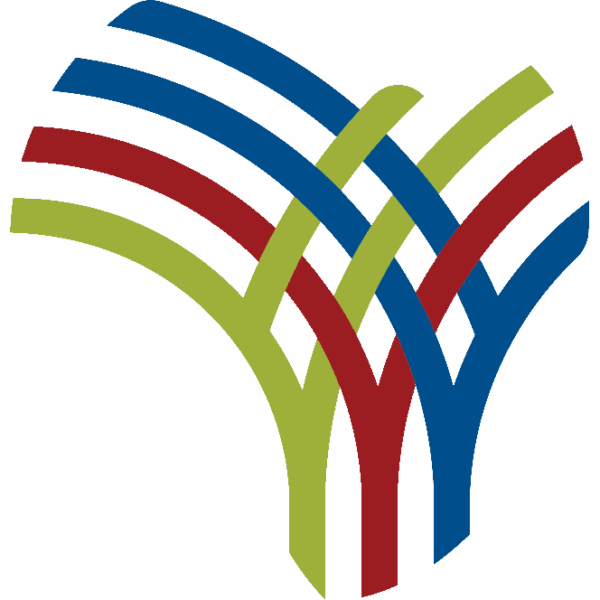Afrique: Quand la crise économique pousse à des décisions restrictives

En Afrique, les turbulences économiques récentes amènent certains gouvernements à resserrer l’étau sur des activités jusqu’ici tolérées. La Tanzanie et le Gabon, à quelques jours d’intervalle, ont annoncé des mesures visant à interdire à des étrangers l’exploitation de petites entreprises dans plusieurs secteurs du commerce informel. Des décisions qui suscitent débats et crispations, amplifiés par « les réseaux sociaux », où les « pseudo-activistes » et influenceurs alimentent en créant la polémique et des discours identitaires.
Le 31 juillet, Africanews rapportait que la Tanzanie avait décidé de bannir la propriété et l’exploitation par des étrangers de commerces de proximité ou d’autres activités de petite envergure, provoquant aussitôt des critiques, notamment du Kenya.
Le 12 août, le Gabon emboîtait le pas, par la voix de sa porte-parole Mme Laurence Ndong. Le gouvernement a interdit à des opérateurs étrangers des activités telles que la coiffure de rue, la réparation de téléphones, l’envoi d’argent non agréé ou l’orpaillage artisanal sans enregistrement.
Suivez-nous sur notre chaîne WhatsApp pour plus d’informations.
Le communiqué émis par le Gabon indique que : « Abordant la question du commerce informel, le Conseil a constaté que ce secteur, bien que dynamique, échappe souvent au cadre légal et pénalise les entrepreneurs nationaux, en particulier les jeunes et les femmes. Une part importante de ces activités étant exercée par des opérateurs étrangers, le Conseil interdit désormais à ces derniers l’exercice de certaines activités de petite envergure : commerce de proximité, envoi d’argent non agréé, réparation de téléphones et petits appareils, coiffure et soins esthétiques de rue, orpaillage artisanal non autorisé, intermédiation informelle dans l’achat de récoltes, exploitation de petits ateliers ou machines de jeux sans enregistrement. »
Ces annonces s’inscrivent dans un contexte plus large, celui de la « fuite de capitaux ». Phénomène ancien mais aggravé par l’instabilité macroéconomique, il désigne la sortie rapide de ressources financières vers l’étranger, privant les États de moyens pour financer leur développement.
Comme l’a expliqué le Dr Ameth Saloum Ndiaye lors d’une conférence à Kigali, cette fuite est souvent le fait d’acteurs privés cherchant à mettre leurs avoirs à l’abri dans des juridictions à fiscalité avantageuse.
Le commerce informel, au cœur de ces décisions, illustre la complexité du problème. Dynamique et vital pour de nombreux ménages, il échappe cependant au contrôle et à la taxation de l’État, ce qui pénalise les entrepreneurs locaux et accroît la concurrence déloyale.
Pour les différentes autorités, la présence d’opérateurs étrangers dans ce secteur renforce la pression sur les jeunes et les femmes, souvent les plus touchés par le chômage. Mais au-delà de la réglementation, les critiques pointent aussi la responsabilité des gouvernements qui tolèrent, voire profitent, de ces pratiques en détournant des fonds publics.
Ces mesures restrictives traduisent une volonté affichée de protéger l’économie nationale et de freiner la « fuite de capitaux ».
Toutefois, une forte responsabilité revient à certains gouvernements, qui ont opté pour les détournements de fonds publics, s’alliant à ces commerçants qui ne font aucun versement à l’État comme cela devrait être fait.
Autant de pratiques malsaines gangrènent ses actions qui sont affectées à l’endroit des expatriés qui, de leur côté, cherchent un meilleur rendement économique.
Toutefois, sans un encadrement plus rigoureux des flux financiers et sans réformes structurelles, elles pourraient se révéler plus symboliques qu’efficaces, tout en nourrissant les tensions dans l’espace public africain déjà polarisé par le débat économique sans fin.