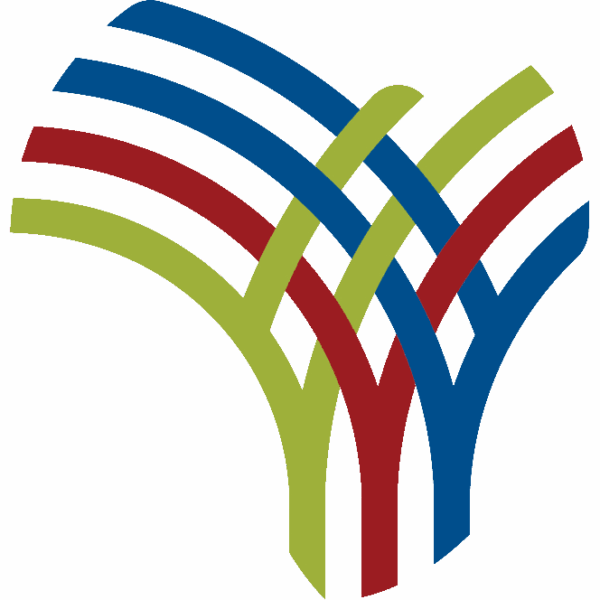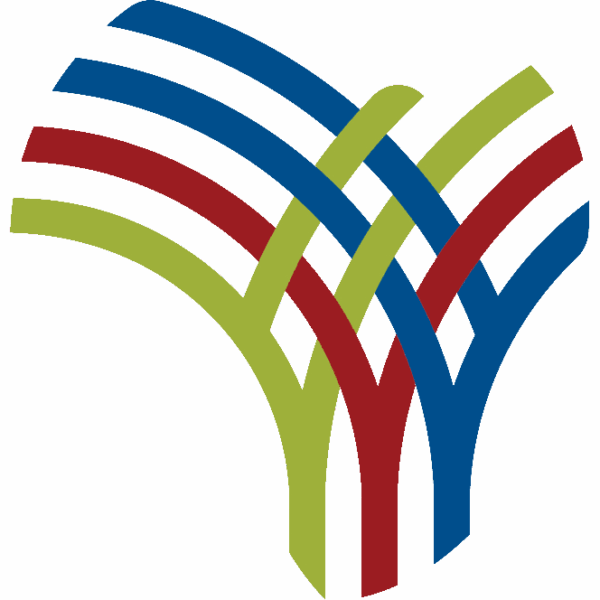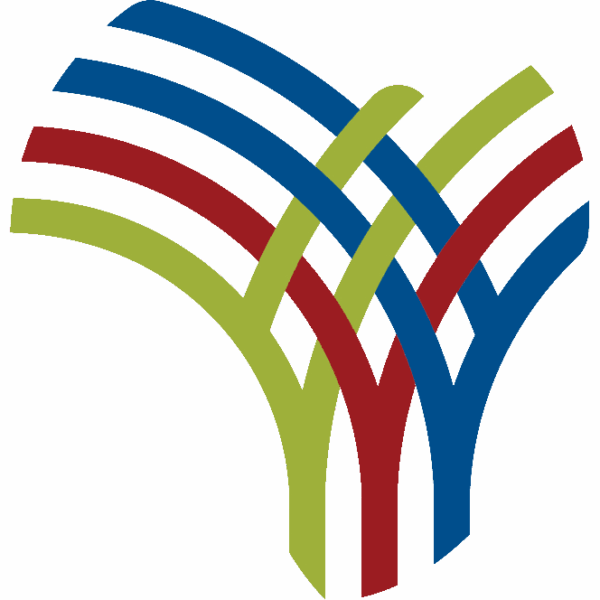Afrique: Pourquoi des pays d'Amérique latine et du continent africain acceptent les migrants expulsés par Trump?
En acceptant de recevoir 250 individus expulsés par les États-Unis, le Rwanda s’inscrit dans une liste grandissante de pays ayant passé un accord similaire avec Washington. Quelles motivations poussent ces États à participer à la « campagne de déportation » de Donald Trump ?
Donald Trump l’avait annoncé pendant sa campagne : il compte bien expulser « un million de personnes par an ». Bientôt sept mois après son investiture, le président des États-Unis ne semble pas prêt de descendre de son cheval de bataille. Entre deux sentences de taxes douanières, le locataire de la Maison Blanche se démène pour trouver des volontaires pour accueillir ceux que Washington expulse. Le Liberia, le Sénégal, la Mauritanie, le Gabon ou encore la Guinée-Bissau, ont tous refusé de prêter main forte à l’oncle Sam. L’administration Trump serait même allée jusqu’à démarcher l’Ukraine, selon le Washington Post. En vain.
De nombreuses propositions états-uniennes ont cependant trouvé preneurs en Amérique Latine et dans certains pays d’Afrique. Juteuses contreparties ou accords passés sous la contrainte, quelles sont les raisons qui poussent ces différents États à prendre part à l’entreprise de « déportation » américaine ?
L’Amérique latine face au poids lourd américain
Sur le continent américain, le Guatemala, le Panama, le Costa-Rica, le Venezuela et le Salvador ont tour à tour accepté de recevoir des individus expulsés par les États-Unis. Pour la plupart d’entre eux, la balance économique penche – comme souvent – du côté de Washington. Pour les Américains, « le Cafta et la monnaie sont les leviers principaux », estime Tamara Espiñeira, enseignante en relations internationales à Sciences Po Rennes et spécialiste de l’Amérique latine.
Ratifié en 2004, le Cafta, l’accord de libre-échange entre l’Amérique centrale, les États-Unis et la République dominicaine (Aléac en français), est un traité favorisant les échanges commerciaux entre la République dominicaine, le Honduras, le Nicaragua, le Costa-Rica, le Salvador et le Guatemala. « Les économies d’Amérique centrale dépendent beaucoup de ces échanges », résume Tamara Espiñeira. Difficile de refuser une offre de la Maison Blanche dans de telles conditions. Sans oublier que le dollar occupe une place prépondérante dans les économies de ces pays, allant jusqu’à être devenu la monnaie officielle du Salvador et du Panama.
S’ajoutent à cela des spécificités supplémentaires en fonction de chaque pays.
∎ Le Guatemala
Le 24 janvier 2025, plus de 260 migrants expulsés des États-Unis atterrissaient au Guatemala. Le pays sert déjà depuis plusieurs années de nation de transit pour les individus expulsés par Washington. En février 2025, il a néanmoins annoncé « augmenter de 40% le nombre de vols de personnes expulsées ». Une décision saluée par la Maison Blanche. Et pour cause, les Américains représentent un soutien majeur du gouvernement actuel de Bernardo Arévalo. « Sans l’intervention assez ferme des États-Unis l’année dernière, défendant les résultats des élections de 2023, les litiges avec l’ancien pouvoir guatémaltèque feraient encore rage », souligne Tamara Espiñeira.
Après des mois de procédures judiciaires entamées contre lui pour l’empêcher d’accéder au pouvoir, Bernardo Arévalo a effectivement reçu un important soutien de l’administration Biden. Celle-ci a notamment sanctionné environ 300 juristes guatémaltèques opposés à l’investiture du président fraichement élu. Perdre les faveurs états-uniennes en refusant une proposition du successeur de Joe Biden représenterait ainsi un risque important à la présidence de Bernardo Arévalo.
∎ Panama
Trois semaines après le Guatemala, c’est au Panama de recevoir, les 12 et 15 février, des avions avec, à leur bord, 299 ressortissants de différents pays expulsés des États-Unis. Un accord vu comme « une évidence » par Marilou Sarrut, doctorante en géographie et autrice d’une thèse sur les traversées migratoires à travers la jungle du Darien. « L’histoire panaméenne est entrelacée avec l’action américaine », remarque-t-elle. Devenu indépendant en 1904 avec l’aide de Washington, le Panama et son administration ont depuis « été imprégnés par les États-Unis », estime la chercheuse.
« Senafront, la police aux frontières panaméenne, en particulier les forces qui opèrent à l’intérieur de la jungle du Darien à la frontière entre le Panama et la Colombie, est en partie financée et formée par les États-Unis », poursuit-elle. L’accord passé avec Donald Trump s’inscrit alors dans la longue histoire commune des deux pays, les Américains ayant depuis longtemps externalisé leurs frontières au Panama. Le président américain n’a cependant pas manqué de rappeler l’asymétrie des rapports entre les deux pays par ses menaces répétées de reprise du contrôle du canal du Panama.
∎ Costa-Rica
Dans le sillon du Panama, le Costa-Rica a, à son tour, accepté le 17 février d’accueillir temporairement 200 migrants irréguliers parmi lesquels des individus d’Asie centrale et d’Inde renvoyés par les États-Unis. Outre le Cafta dont fait partie le Costa-Rica, Washington dispose d’un autre argument de poids pour faire adhérer la Suisse de l’Amérique centrale à sa politique migratoire : la sécurité. Depuis 1948, le Costa-Rica a fait voeu de neutralité en se débarrassant de son armée. Membre de l’Organisation des États américains, le pays voit ses intérêts sécuritaires pris en charges par les autres États membres en cas de conflit, parmi lesquels figurent les États-Unis.
C’est essentiellement à l’oncle Sam qu’est d’ailleurs confiée la sécurité costaricaine dans le cadre « d’opérations de lutte contre le narcotrafic », note Tamara Espiñeira. Des accords de coopération entre les deux pays, comme celui signé en 1999, assurent une présence militaire américaine fréquente dans le pays sans armée et dont la police est également entraînée par les États-Unis. Les marines régulièrement envoyés au Costa-Rica deviennent alors une « espèce d’armée côtière stratégique » selon la spécialiste, bénéficiant ainsi aux deux pays dans leur lutte contre le trafic de drogue.
∎ Venezuela
Les relations entre Washington et Caracas sont, en apparence, désastreuses. Les États-Unis ne reconnaissent pas la légitimité de la réélection en 2024 du président vénézuélien Nicolas Maduro, inculpé par la justice américaine pour trafic de drogue et corruption. Depuis son premier mandat, Donald Trump critique régulièrement son homologue vénézuélien et a annoncé, le 8 août 2025, avoir doublé à 50 millions de dollars la prime pour son arrestation.
Paradoxalement, depuis le 10 février, le Venezuela a accueilli plus de 500 individus, tous originaires du pays, expulsés par les États-Unis. Nicolas Maduro accepte ces accords « pour maintenir l’économie du Venezuela en vie », avance Tamara Espiñeira. Le pétrole, et plus particulièrement la licence d’exploitation du pétrolier américain Chevron, semble être l’argument massue des Américains. Révoquée par Donald Trump le 26 février 2025, l’autorisation d’extraction du pétrole vénézuélien par Chevron a été renouvelée de manière restreinte fin juillet selon Reuters. « Le Venezuela a absolument besoin de cette licence car son économie dépend du pétrole », conclut Tamara Espiñeira.
∎ Salvador
Accusés par le gouvernement américain de faire partie du gang vénézuélien « Tren de Aragua », 238 Vénézuéliens ont été expulsés vers le Salvador le 15 mars. Une situation sensiblement différente de celle des autres pays mentionnés. Au Salvador, toutes les personnes expulsées par Washington sont considérées criminelles et ont donc été enfermées au Centre de confinement du terrorisme (Cecot), une prison de sécurité maximale où les cellules de 90 m2 accueillent chacune 150 détenus.
Loin de subir la politique de Washington, le président salvadorien Nayib Bukele semble encourager la collaboration. Reçu à la Maison Blanche le 14 avril, il est le premier dirigeant d’Amérique latine à avoir foulé le parquet du Bureau ovale depuis l’investiture de Donald Trump. L’accueil des expulsés lui permet non seulement de solidifier ses liens avec Washington mais aussi de recevoir d’importantes compensations financières. Les États-Unis auraient en effet versé six millions de dollars à San Salvador dans le cadre de cet accord à en croire la porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt. Des sommes qui pourraient continuer de grimper à mesure que les expulsions se poursuivent.
En Afrique, accueillir pour « entrer dans les bonnes grâces »
Malgré de nombreux refus, trois nations africaines – l’Eswatini, le Soudan du Sud et le Rwanda – ont accepté de recevoir ceux que Washington renvoie. Ces pays voudraient tous « entrer dans les bonnes grâces de Washington », explique Thierry Vircoulon, chercheur associé au Centre Afrique subsaharienne de l’Ifri. « La plupart d’entre eux veulent éviter d’être victimes d’une interdiction totale de visas », selon lui.
∎ Soudan du Sud
Le 8 juillet, le Soudan du Sud a reçu huit hommes – dont un seul Sud-Soudanais – expulsés des États-Unis. Juba a exprimé sa volonté d’accueillir plus d’expulsés, mais aurait fixé certaines conditions, selon des informations du média Politico. Le pays demande à Washington de revenir sur la révocation des visas de ses ressortissants entrée en vigueur en avril 2025. Juba demanderait également que soient levées les sanctions à l’encontre de plusieurs membres du gouvernement, notamment le vice-président Benjamin Bol Mel, accusé de corruption par les États-Unis. Enfin, le Soudan du Sud demande le soutien américain dans les poursuites judiciaires à l’encontre du premier vice-président du pays, Riek Machar, accusé de fomenter une rébellion pour empêcher la tenue des élections de décembre 2026.
Aucune de ces demandes n’a fait mouche, mais le Soudan du Sud continue de se présenter en allié des États-Unis. Accepter les propositions américaines serait ainsi un moyen pour Juba de gagner en considération aux yeux de Washington et d’espérer, un jour, voir certaines de ses demandes satisfaites.
∎ Eswatini
La petite monarchie de l’Eswatini a emboîté le pas au Soudan du Sud en passant un accord similaire avec les États-Unis, rendu public le 16 juillet. Seuls cinq personnes ont pour l’instant été envoyées dans cet État de 17 000 km2 enclavé en Afrique du Sud. Originaires du Vietnam, de la Jamaïque, de Cuba, du Yemen et du Laos, les cinq expulsés seraient tous des criminels « d’une barbarie inouïe », a déclaré sur X Tricia McLaughlin, la porte-parole du ministère de la Sécurité intérieure.
Le gouvernement de l’Eswatini à l’instar du Soudan du Sud, a cité son lien étroit avec les États-Unis comme une motivation essentielle de cet accord. Il s’agit pour la monarchie de « soigner son image vis-à-vis des États-Unis et de s’attirer aussi des revenus financiers », analyse Jean-Claude Katende, avocat et vice-président de la Fédération internationale pour les droits humaines (FIDH).
∎ Rwanda
Dernier pays en date à avoir passé un accord avec Washington, le Rwanda s’apprête à recevoir 250 personnes expulsées par les États-Unis. Kigali n’en est pas à son coup d’essai sur la question. En 2022, un accord similaire entre la Grande-Bretagne et le Rwanda avait déjà été annoncé avant d’être invalidé l’année suivante par la Cour suprême. Cela n’a pas empêché le Rwanda de toucher une partie de la contrepartie monétaire promise, quelque 280 millions d’euros. Il y aurait donc « une raison tout à fait financière » à accepter cet accord américain pour Kigali, d’après Jean-Claude Katende mais aussi un intérêt à « bénéficier d’une main d’oeuvre facile, payée à des salaires faibles ».
Sans oublier que, selon Thierry Vircoulon, Kigali « essaie d’amadouer l’administration Trump dans le cadre des négociations entre le Rwanda, la République Démocratique du Congo et les États-Unis [accord de paix du 27 juin 2025, NDLR]. Il s’agit d’apporter quelque chose à Trump alors que le gouvernement congolais lui offre l’accès à son secteur minier ». Des négociations dans lesquelles le Rwanda est loin d’être en position de force.
Qu’il s’agisse du Soudan du Sud, de l’Eswatini ou du Rwanda, ces pays « comptent parmi les plus pauvres de la planète et sont aussi à l’origine de flux migratoires », rappelle Thierry Vircoulon. Selon le chercheur, « il va de soi que les expulsés qu’ils accueillent vont quitter ces pays ultra-pauvres et reprendre les routes de l’immigration clandestine ».