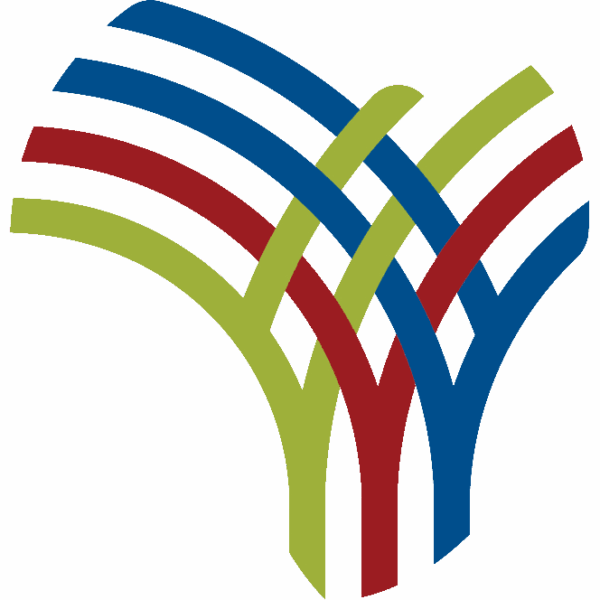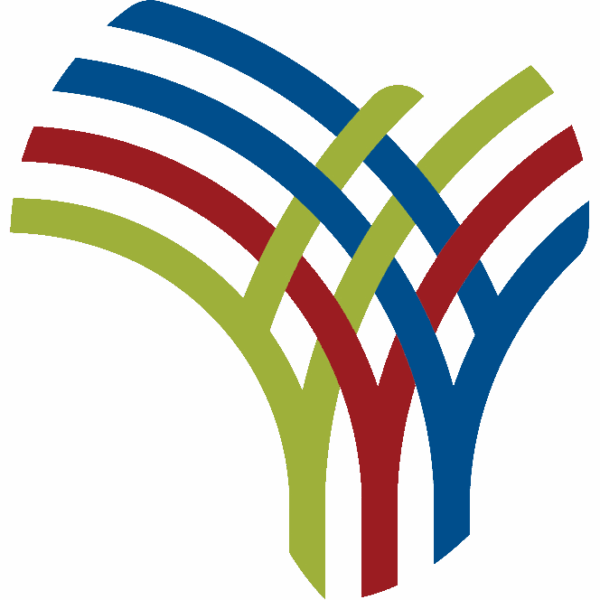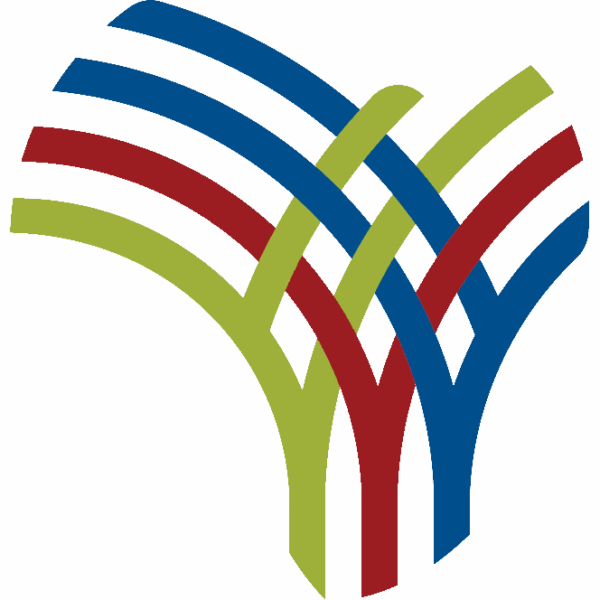Afrique: Cinq ans après la CAPAR, le continent renforce sa stratégie de restitution des avoirs illicites

Cinq ans après l’adoption de la Position africaine commune sur la restitution des avoirs (CAPAR), l’Union africaine a organisé, ce 9 octobre, un webinaire consacré à l’évaluation de sa mise en œuvre et aux défis persistants en matière de récupération des avoirs illicites.
L’événement, soutenu par la Commission de l’Union africaine, le Centre africain de développement (CoDA), l’Union panafricaine des avocats (PALU) et le Conseil consultatif de l’Union africaine sur la corruption (AUABC), a permis de rappeler l’objectif initial de la CAPAR. Il s’agit de renforcer les capacités nationales et régionales pour identifier, tracer, rapatrier et gérer les avoirs africains au bénéfice des citoyens du continent.
Les échanges ont mis en lumière la nécessité d’une meilleure coordination entre les institutions africaines, alors que la fragmentation des cadres juridiques et la faiblesse des mécanismes de coopération continuent d’entraver les efforts de restitution.
Évaluation de la CAPAR et plaidoyer pour une Afrique maîtresse de ses ressources
Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres
Cette rencontre a permis au Pr Florens Luoga, ancien gouverneur de la Banque centrale de Tanzanie, commissaire à la Commission de réforme fiscale de Tanzanie et conseiller principal auprès du Secrétariat du Groupe de haut niveau de l’UA sur les flux financiers illicites, de faire un plaidoyer pour une Afrique maîtresse de ses ressources.
Il a insisté sur la nécessité pour le continent de reprendre le contrôle de ses ressources et de lutter avec détermination contre les flux financiers illicites. Selon lui, la fuite des capitaux issus de la corruption, de l’évasion fiscale ou des activités commerciales illégales prive le continent de moyens essentiels à son développement.
Dès lors, « la restitution de ces fonds n’est pas seulement une question financière, mais une exigence de justice historique et de souveraineté économique, indispensable à la renaissance du continent » a-t-il indiqué.
Dr Esa Onoja, directeur des affaires académiques à la Faculté de droit du Nigéria (Nigerian Law School), a pour sa part lancé un appel à la coopération africaine pour la restitution des avoirs. Présentant les conclusions du rapport CAPAR, Dr Esa Onoja a mis en lumière les principaux obstacles auxquels l’Afrique est confrontée dans la récupération de ses avoirs détournés.
Revenant sur les origines historiques des FFI (de la traite négrière à la colonisation), il a rappelé que ces spoliations se poursuivent aujourd’hui sous des formes plus sophistiquées. Selon lui, l’initiative CAPAR constitue une réponse africaine forte à ce fléau, en proposant un cadre commun d’action et de plaidoyer pour la restitution des richesses illégitimement transférées hors du continent.
Dr Onoja a également souligné les limites du dispositif international actuel, notamment celles de la Convention des Nations unies contre la corruption (CNUCC), qui accorde une large marge de manœuvre aux pays détenteurs des avoirs. Il a ainsi appelé à un renforcement des capacités nationales, à une solidarité interafricaine accrue et à une voix africaine unie dans les négociations internationales sur la restitution des biens mal acquis.
Expériences contrastées : Sénégal et RDC
Cet événement consacré à la restitution et à la gestion des avoirs illicites en Afrique a permis d’explorer l’expérience du Sénégal et celle de la République démocratique du Congo présentées comme deux exemples révélateurs : l’un, structuré et opérationnel ; l’autre, encore en quête d’efficacité institutionnelle.
A cet égard, M. Thierry Mbulamoko, ancien coordonnateur de l’Agence de prévention et de lutte contre la corruption (APLC) en République démocratique du Congo, s’est chargé de faire le bilan concernant ces deux pays.
Au Sénégal, l’Office national de Recouvrement des Avoirs criminels (ONRAC) créé en 2021, s’est rapidement imposé comme un outil central dans la lutte contre la criminalité économique. Sa principale mission est de recouvrer et d’administrer les avoirs saisis ou confisqués, qu’il s’agisse de cautionnements, de dépôts bancaires ou de ventes aux enchères de biens meubles et immeubles.
« En un peu plus de trois ans, cette agence a enregistré des résultats jugés encourageants, avec près de 18 milliards de francs CFA déjà recouvrés. Ces fonds sont reversés dans le circuit bancaire national, garantissant la traçabilité et la transparence des opérations », a révélé M Mbulamoko.
Pour lui, si le cadre national fonctionne efficacement, la dimension internationale du recouvrement reste encore à développer. Le prochain rapport, attendu en 2026, devrait intégrer les données relatives à la coopération transnationale.
En ce qui concerne la RDC, il estime qu’elle a un dispositif légal ambitieux mais peu appliqué. A l’en croire, la République démocratique du Congo dispose d’un arsenal juridique complet en matière de confiscation et de recouvrement des avoirs. Le Code pénal et la loi de décembre 2021 sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme prévoient des mesures de gel des avoirs et d’interdiction d’opérations financières suspectes.
Cependant, il estime qu’entre le texte et la pratique, le fossé demeure large. « Les procédures judiciaires sont longues, les condamnations rares, et aucune donnée officielle ne permet de mesurer l’efficacité réelle du dispositif » a-t-il affirmé.
D’après M. Mbulamoko, une Commission mixte, placée entre le ministère de la Justice et celui des Finances, a bien été créée pour gérer les biens confisqués, mais son fonctionnement reste partiel et ses résultats quasi inexistants. Aujourd’hui, il souligne que des spécialistes recommandent de renforcer cette commission ou de créer une véritable agence nationale, sur le modèle sénégalais, dotée de pouvoirs opérationnels et financiers étendus.
Lors de ce webinaire, les cas du Sénégal et de la RDC ont permis d’illustrer deux réalités contrastées mais complémentaires. Le premier montre qu’une volonté politique forte et une structure dédiée peuvent produire des résultats tangibles. Le second rappelle que sans coordination institutionnelle ni mécanisme de suivi efficace, même le meilleur cadre juridique reste lettre morte.
Au-delà de ces différences, les participants ont partagé un message commun : « Pour que la restitution et la gestion des avoirs illicites contribuent réellement au développement, l’Afrique doit transformer ses lois en leviers concrets d’action. »
La création d’agences spécialisées, le renforcement de la coopération régionale et la transparence dans l’utilisation des fonds récupérés constituent désormais des priorités partagées.