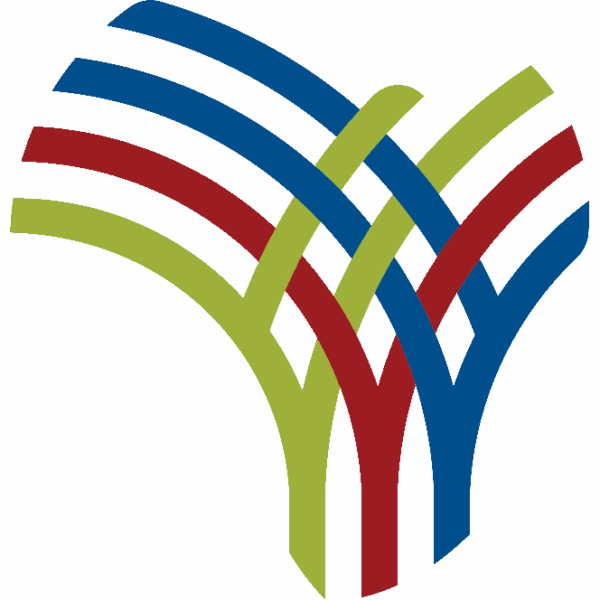Afrique de l'Ouest: Une étude met en lumière la dure réalité des enfants migrants travailleurs

Une récente enquête menée au Sénégal, en Mauritanie, en Côte d’Ivoire et en Guinée (avril 2023 à avril 2025) décrit la réalité souvent invisible des enfants migrants travailleurs. Ces enfants vulnérables sont confrontés à l’exploitation, à la précarité éducative et à de graves obstacles d’accès aux soins. L’auteur de cette étude, le chercheur Aly Tandian, s’est entretenu avec The Conversation Africa. Il plaide pour des politiques inclusives afin de garantir leurs droits fondamentaux et prévenir l’apatridie.
Qui sont les enfants migrants en Afrique de l’Ouest ?
En Afrique de l’Ouest, les enfants migrants sont des filles et des garçons de moins de 18 ans qui se déplacent à l’intérieur de leur pays ou au-delà des frontières, de manière volontaire ou contrainte, temporaire ou permanente. Certains voyagent seuls, parfois envoyés par leurs parents ou tuteurs pour trouver du travail, apprendre un métier ou fréquenter une école coranique. D’autres se déplacent avec un ou les deux parents, dans le cadre de migrations familiales (exode rural, déplacements transfrontaliers pour le travail saisonnier).
Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres
Nombreux sont ceux placés chez des proches, maîtres d’apprentissage ou maîtres coraniques. Ce qui fait d’eux des migrants placés sous la responsabilité d’un adulte autre que leur parent. Leur mobilité est souvent liée à des stratégies familiales, comme le confiage, la recherche d’opportunités économiques ou l’accès à l’éducation. Elle s’explique aussi par des logiques communautaires, telles que le placement chez un maître coranique, l’apprentissage d’un métier ou le travail saisonnier, mais également par la pauvreté, les conflits, les catastrophes, la traite et l’exploitation.
La prévalence des migrations d’enfants est élevée en Afrique de l’Ouest, mais la quantification précise est difficile à établir en raison de l’informalité, de la mobilité non enregistrée et de l’invisibilité statistique.
Comment caractérisez-vous la réalité des enfants migrants travailleurs dans la région ?
En Afrique de l’Ouest, les enfants migrants travailleurs sont visibles dans les différents secteurs économiques comme l’agriculture, à la fois urbaine et rurale (plantations de cacao et de café, marchés et gares routières, quartiers périphériques et chantiers, les environnements religieux et éducatifs détournés ainsi que zones minières et portuaires). Ils peuvent être doublement vulnérables à cause des conditions d’abus, d’exploitation, de soumission à des travaux indignes auxquels ils sont soumis mais également à l’isolement et à d’autres difficultés liées au parcours migratoire.
Dans certaines circonstances, ils peuvent ne pas avoir la capacité juridique de faire valoir leurs droits contre des entreprises commerciales et d’autres parties qui les engagent dans le travail. Ces enfants, vulnérables en raison de leur statut d’étrangers, ont un accès limité à la justice, à l’éducation et sont exposés aux abus et à la discrimination.
L’invisibilité juridique et administrative à laquelle ils sont confrontés renvoie à une absence d’identité juridique et à une privation de divers droits. De même, la protection juridique n’est pas équitable et les enfants migrants travailleurs ont besoin dans certains cas de mécanismes particuliers pouvant éviter l’apatridie (situation d’une personne dont aucun Etat ne reconnait la nationalité).
Quels sont les principaux risques auxquels ces enfants sont exposés ?
Les vulnérabilités sont liées principalement à leur statut irrégulier, au manque de document d’identité, à l’accès limité aux services publics et à l’absence de protection juridique. Elles limitent leur accès à une éducation de qualité et leur développement personnel.
Leur situation scolaire n’est pas favorable car ils vivent dans un déséquilibre scolaire profond avec les nationaux. De fait, leur droit à l’éducation n’est pas respecté. Mais les garçons et les filles de migrants ne sont pas égaux avec les autres ni en termes de droit à l’éducation ni en termes d’opportunités ou d’obligations après un décrochage.
Par ailleurs, ces enfants ont souvent un accès limité aux soins de santé. Les barrières administratives, la non-inscription dans les systèmes de santé nationaux, et la mobilité géographique des familles rendent difficile la continuité des soins, notamment dans les zones urbaines où les migrants sont concentrés.
Les services de santé mentale sont rares, souvent inaccessibles dans les zones rurales ou les camps de réfugiés, et parfois méconnus des familles. Les enfants se heurtent aussi à la stigmatisation, au manque d’information et à l’insuffisance de moyens financiers. Ce qui les empêche de recevoir les soins dont ils ont besoin. En Guinée, par exemple, la vulnérabilité sanitaire des enfants de migrants s’est particulièrement remarquée à la faveur des épisodes d’épidémie d’Ébola et de la pandémie de la Covid-19 en contradiction avec le droit guinéen.
Quelles sont les conséquences de la séparation familiale des enfants de migrants ?
Au cours de nos enquêtes, nous avons pu constater que de nombreux enfants vivant avec un des deux parents ou avec des tuteurs souffrent de vulnérabilités émotionnelles et psychologiques. Ils sont confrontés à un manque de protection et d’encadrement, des difficultés éducatives ainsi que des risques de migration autonome.
A Bouaké (Côte d’Ivoire) et à Nouadhibou (Mauritanie), certains enfants séparés de leurs parents biologiques affirment « souffrir de sentiments d’abandon ». A Dakar et à Conakry, d’autres disent « ne pas être à l’abri des risques d’exploitation ou de maltraitance ».
L’absence des parents influence différemment la scolarisation des enfants. L’absence du père peut entraîner une faible autorité dans le foyer et un sentiment d’abandon. Quand la mère manque, les filles risquent davantage d’interrompre leur scolarité pour assumer des tâches domestiques.
En outre, il y a une perte du lien émotionnel, car la mère joue souvent un rôle affectif et éducatif quotidien. On constate une baisse du suivi scolaire et nutritionnel, surtout pour les jeunes enfants.
La séparation familiale des enfants de migrants constitue un défi majeur qui exige des politiques inclusives et un soutien coordonné pour leur bien-être et la réunification. Les enfants expriment de façon récurrente leur besoin de surmonter cette séparation.
Entre autres conséquences de la séparation familiale sur les enfants, ces derniers citent le sentiment d’abandon, d’anxiété, de troubles du comportement, de perte de repères, un manque de lien parental, une rupture dans la construction identitaire, un isolement, une déscolarisation possible, etc.
Quelles formes de soutien ou de protection pourraient améliorer leur condition ?
Les enfants migrants travailleurs ont besoin d’avoir accès aux documents d’état civil (actes de naissance, certificats de résidence, papiers d’identité, etc.). L’absence de ces documents entraîne une absence d’identité légale. Sans les papiers, il est impossible pour les autorités d’identifier l’enfant, de vérifier son âge, son origine ou son lien avec un éventuel accompagnant.
Une telle situation est à l’origine de l’échec de l’instruction ou de la scolarisation de nombreux enfants migrants. L’inaction des autorités publiques favorise des réseaux illicites d’établissement de documents administratifs qui ne satisferont pas les objectifs du tuteur. Ils ont également besoin d’assistance juridique pour défendre leurs droits.
L’absence de documents administratifs limite l’accès des enfants migrants travailleurs à l’éducation, aux soins et à la justice. Elle restreint aussi leurs droits dans leur pays d’origine et peut entraver leur mobilité et leur travail.
Les besoins en santé et bien-être incluent la vaccination, la prise en charge psychologique des enfants migrants travailleurs, ainsi que la santé, la nutrition et la santé mentale des enfants.
Les enfants de migrants séparés de leurs parents rencontrent des obstacles liés aux préjugés et à la marginalisation, qui limitent leur accès aux soins et affectent leur santé mentale. La sensibilisation des tuteurs aux besoins nutritionnels propres à chaque âge est essentielle pour assurer leur développement normal.
Les enfants migrants travailleurs ont besoin de reconnaissance, de soutien moral et d’espaces d’écoute favorisant le dialogue et la médiation. Ils doivent également voir leurs droits fondamentaux, ainsi que ceux liés à leur statut d’enfant migrant, respectés.
Que recommanderiez-vous aux décideurs pour encadrer cette migration dès l’enfance ?
Pour améliorer la situation des enfants migrants travailleurs en Afrique de l’Ouest, il est impératif que les États de la région mettent en place des politiques migratoires et des systèmes d’enregistrement civil garantissant leurs droits fondamentaux, indépendamment de leur statut. Ils doivent aussi renforcer les mécanismes de protection et de justice en faveur des enfants les plus vulnérables.
L’inclusion des enfants de migrants passe par des efforts coordonnés entre les gouvernements, les ONG, les institutions internationales et les communautés locales.
En termes de recommandation, il faut :
- renforcer des politiques de protection sociale en facilitant l’accès aux soins et à l’éducation pour les enfants de migrants ;
- créer des mécanismes de régularisation pour assurer un statut légal aux enfants de migrants et leur donner accès aux droits fondamentaux ;
- lutter contre les discriminations à l’école en sensibilisant les enseignants et les élèves à l’inclusion ;
- encourager l’éducation des filles en réduisant les obstacles socioculturels et en sensibilisant les familles ;
- faciliter l’enregistrement des naissances issues de couples de migrants pour garantir un accès aux droits fondamentaux ;
- mener des campagnes de sensibilisation auprès des communautés migrantes sur l’importance des documents d’identité.
Les enfants migrants constituent une réalité multiple. Ils sont exposés à des formes d’exploitation et leur situation devrait interroger les politiques publiques car ce sont des enfants le plus souvent dépourvus de documents administratifs. Ils se retrouvent confrontés à une non-admission dans les pays de transit, de destination et parfois d’origine.
L’avenir de ces enfants en Afrique de l’Ouest sera déterminé par la capacité des États, des communautés et des organisations régionales à transformer une mobilité souvent synonyme d’exploitation en une mobilité protégée et valorisée.
Aly Tandian, enseignant-chercheur, Université Gaston Berger