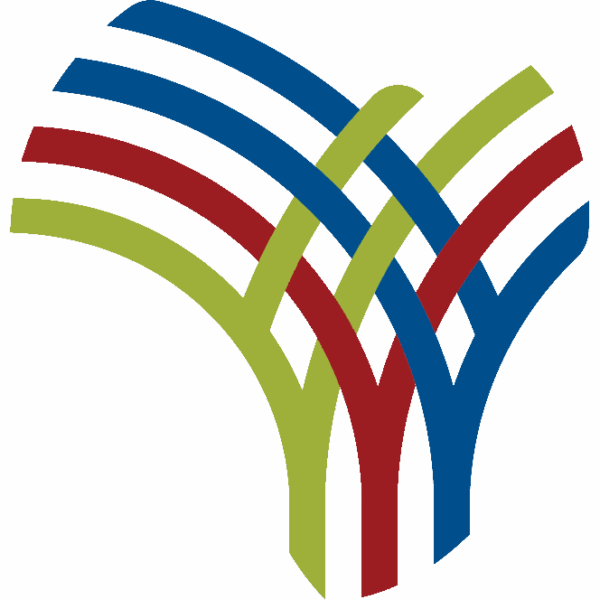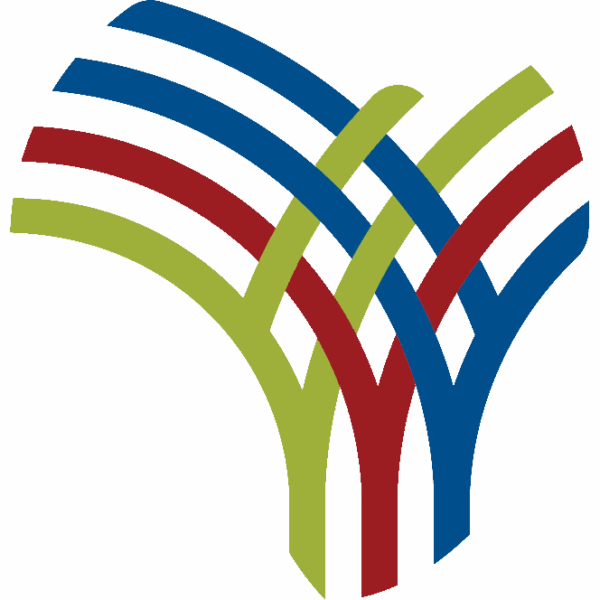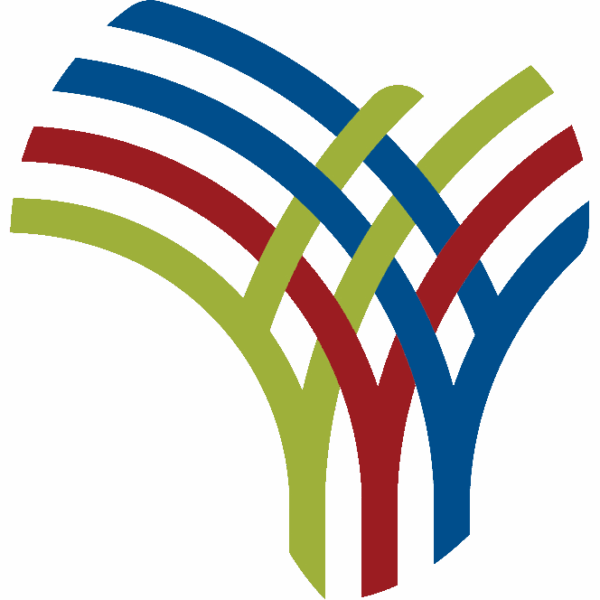Ile Maurice: Entre visibilité et crédibilité

Dans un monde traversé par les crises climatiques, les guerres de ressources et la fragmentation du multilatéralisme, Maurice n’a pas le choix : elle doit parler fort, même si sa voix reste fragile. À la TICAD 9 de Yokohama, Navin Ramgoolam a livré les contours d’une politique étrangère ambitieuse : faire de l’Afrique son horizon, du Japon son modèle et de ses vulnérabilités un levier diplomatique. Mais derrière les belles formules, une question persiste : quelle diplomatie pour Maurice et à quel prix ?
Car la facture est lourde. Maintenir 22 ambassades coûtent Rs 253 millions par an, dont Rs 38 millions pour New York, Rs 17 millions pour Genève, Rs 16 millions pour Pékin. À l’autre extrême, Addis-Abeba, pourtant siège de l’Union africaine, fonctionne avec moins d’un million. Cet écart de un à quarante illustre la contradiction d’un petit État qui veut être partout, mais ne peut pas se le permettre.
La question n’est pas de savoir si Maurice a besoin d’une diplomatie active. La réponse est évidente : oui. Notre République ne peut rester spectatrice alors que se dessinent les nouvelles règles du commerce mondial, de la gouvernance climatique et de la sécurité alimentaire. La vraie interrogation est de savoir si nous voulons une diplomatie de vitrine ou d’efficacité. À force de multiplier les ambassades coûteuses, le risque est de sacrifier la substance sur l’autel du prestige.
Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn
Ramgoolam a placé l’économie au coeur de sa doctrine : les ambassades comme avant-postes pour attirer l’investissement et sécuriser des partenariats stratégiques. Une vision cohérente pour un pays sans armée ni profondeur stratégique. Mais encore faut-il que chaque dépense rapporte. À quoi sert de payer Rs 36 millions de loyers à Manhattan si notre ambassade à Washington, faute d’ambassadeur, n’a pas pesé sur le dossier vital de l’AGOA ?
La diplomatie mauricienne doit se réinventer. Trois pistes s’imposent.
1. Rationaliser les implantations. Toutes les capitales ne méritent pas une ambassade permanente. Une présence régionale partagée, une ambassade couvrant plusieurs pays ou le recours accru aux consulats honoraires réduiraient la facture sans affaiblir l’influence. Pourquoi entretenir des loyers exorbitants à Berlin et Londres si Bruxelles, siège de l’Union européenne, peut jouer ce rôle ?
2. Mutualiser avec l’Afrique. Notre avenir est continental. L’Union africaine, la SADC, la ZLECAF sont nos arènes naturelles. Addis-Abeba doit devenir le pivot de notre stratégie. Plutôt que de multiplier des missions coûteuses, nous devons investir dans une diplomatie de coalition, défendre nos priorités – commerce, climat, sécurité maritime – au sein de forums collectifs qui donnent plus de poids à moindre coût.
3. Digitaliser la diplomatie. À l’heure où Port-Louis est à un clic de Tokyo ou Washington, faut-il encore autant de bureaux physiques ? Une partie des missions traditionnelles peut être remplacée par des outils numériques. Maintenir un effectif réduit sur place, renforcer la veille digitale et multiplier les plateformes interactives avec investisseurs et partenaires donneraient plus d’agilité à notre diplomatie.
Ramgoolam a raison de rappeler que l’Afrique est notre horizon. La jeunesse du continent et ses échanges intrarégionaux offrent des perspectives immenses. Mais encore faut-il que notre présence ne soit pas qu’un slogan.
L’épisode du Parlement panafricain à Midrand, où notre délégation a été recalée pour non-respect du protocole, a montré l’inverse : une diplomatie improvisée, plus soucieuse de contrôle partisan que de crédibilité internationale. Une erreur qui coûte bien plus cher qu’un loyer new-yorkais : elle abîme notre image.
Le mérite du discours du Premier ministre est d’avoir assumé nos fragilités comme argument diplomatique. Être un petit État insulaire, c’est subir de plein fouet cyclones, famines et pénuries de matières premières. Mais c’est aussi pouvoir incarner la voix des vulnérables. Maurice doit capitaliser sur ce rôle : plaider pour la justice climatique, la sécurité alimentaire, la régulation des ressources stratégiques. Voilà une valeur ajoutée réelle, qui dépasse nos moyens limités.
La diplomatie coûte cher, mais l’absence de diplomatie coûterait plus encore. Le dilemme est de trouver la juste mesure. Ramgoolam parie sur l’expansion, convaincu que la visibilité a un prix. Mais la lucidité impose un arbitrage : chaque roupie doit nous rapprocher de notre horizon stratégique – faire de l’Afrique notre ancrage, de l’océan Indien notre zone d’influence et de l’innovation notre passeport pour l’avenir.
Maurice est une métaphore : celle d’un petit État qui veut exister dans un monde brutal. «Tomber sept fois, se relever huit», dit le proverbe japonais. Encore faut-il ne pas trébucher sur ses propres dépenses.
Maurice s’est tue à deux reprises devant la Cour internationale de justice : en décembre 2024, lors des audiences sur les obligations climatiques, et le 1er mai 2025, quand 39 nations ont dénoncé les entraves humanitaires d’Israël en Palestine.
Vendredi, le Conseil des ministres a finalement approuvé l’adhésion à la Déclaration de New York sur la solution à deux États. Pourquoi ce silence, suivi d’un rattrapage tardif ? Parce que le gouvernement jongle avec ses priorités stratégiques :
Chagos, tarifs punitifs américains, marges étroites. Mais à trop privilégier la prudence tactique, Maurice affaiblit ce qui a toujours fait sa force : la cohérence et la constance dans la défense des principes. Se taire à La Haye, c’est laisser d’autres écrire le droit international à notre place.