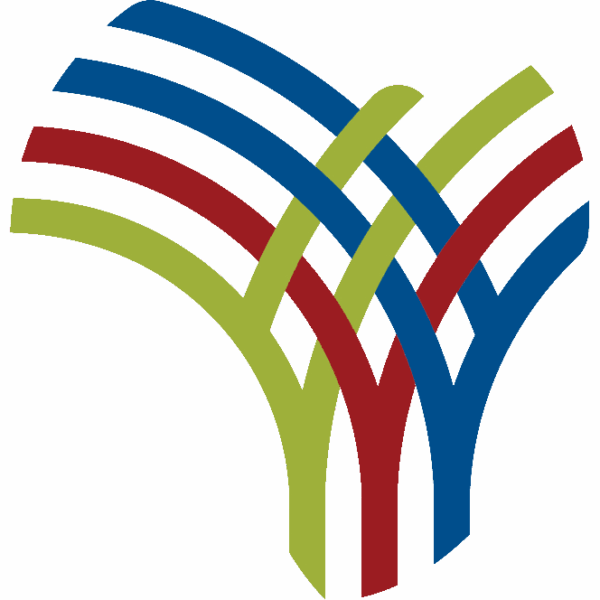Afrique: Incendies – Comment les forêts repoussent-elles après leur destruction par les flammes?
Chaque année, de nombreux incendies ravagent d’immenses étendues forestières à l’échelle de la planète. Après le passage des flammes, les forêts peuvent cependant compter sur de nombreuses ressources pour se reboiser et retrouver de leur éclat.
Ces dernières années, les feux de forêts ont ravagé de vastes territoires dans le monde entier, détruisant des millions d’hectares de végétation. En Amérique du Nord, dans le sud de l’Europe, en Australie, et surtout en Afrique. Avec le réchauffement climatique, qui augmente la fréquence et l’intensité des feux de forêts extrêmes, de plus en plus d’écosystèmes forestiers sont mis à rude épreuve.
Mais comment, après le passage des flammes, les forêts se reconstruisent-elles ? Entre le choix de la régénération naturelle, celui de l’intervention de l’homme et de la plantation de nouvelles espèces, il existe plusieurs façons pour elles de revenir à la vie.
Après les feux : l’évaluation des dégâts et la sécurisation de la forêt
Lors d’un feu de forêt, les habitats naturels de nombreuses espèces sont réduits à néant – mettant parfois leur survie en danger – et des risques géologiques apparaissent par la suite, selon les spécificités de la zone affectée : chutes de pierres, glissements de terrain, érosion, crues torrentielles, avalanches en montagne…
Selon l’Office national des forêts (ONF), l’établissement public qui gère les forêts publiques de France, la première étape après un feu de forêt doit être la sécurisation des lieux touchés. « Certains risques sont augmentés par la disparition de la forêt : les risques d’érosion, de chutes de blocs lorsque la forêt est en pente… La forêt a un rôle de protection des sols et contre d’autres aléas naturels », explique Rémi Savazzi, chef du pôle national Défense des forêts contre les incendies (DFCI) de l’ONF.
Des mesures sont alors prises pour protéger les usagers, les sentiers, les sols, et pour identifier les arbres abîmés ou sur le point de tomber. Rémi Savazzi explique qu’il est aussi utile d’exploiter « les arbres rendus dangereux par le feu ». Certains peuvent par exemple servir comme aménagements anti-érosion en composant des « fascines » qui permettent « de freiner un peu le ruissellement et de maintenir les sols », poursuit l’expert de l’ONF.
Pour le Dr Patrick Norman, chercheur à l’université Griffith, en Australie, l’intervention humaine après les feux peut faciliter le début de convalescence des forêts. « Il faut s’assurer que les espèces envahissantes comme les mauvaises herbes ne prolifèrent pas. Ça va aider les espèces natives à repousser plus facilement », explique-t-il. La préservation de conditions idéales pour la repousse de la végétation de la forêt va alors jouer sur un rôle considérable sur les délais de rétablissement des écosystèmes. « L’idée, c’est d’accompagner la nature, pas de lui forcer la main », reprend Rémi Savazzi.
Les forêts sont souvent capables de se régénérer seules
De nombreux spécialistes des forêts s’accordent sur un point : la régénération naturelle est la plus efficace. « Pour l’essentiel, la forêt va se débrouiller toute seule pour se régénérer », confirme Éric Rigolot, ingénieur de recherche à l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (Inrae) dans une unité de recherche sur l’écologie des forêts méditerranéennes. « Les forêts méditerranéennes, par exemple, sont adaptées à un certain régime de feu. Elles ont développé des modalités efficaces en matière de régénération post-incendies », ajoute-t-il.
Certains arbres sont habitués à résister au passage des incendies. Si les flammes peuvent détruire leurs branches ou brûler leur écorce, ils ne meurent pas pour autant. « Ceux qui ont une écorce plus résistante au feu ne vont pas forcément mourir : ils vont reprendre avec des bourgeons qui vont se reformer dans les années suivantes », indique Jonathan Lenoir, écologue et chargé de recherche au CNRS. Et cela peut survenir plus vite qu’on ne le pense. « Le chêne-liège est remarquable pour cette capacité de régénération. Trois semaines après un incendie, il peut déjà y avoir de jeunes pousses qui apparaissent sur le tronc », reprend Éric Rigolot.
Rémi Savazzi, de l’ONF, ajoute que de nombreux arbres et arbustes voient aussi leurs racines, sous terre, survivre aux incendies, permettant alors à la végétation de « repartir de la souche ». D’autres arbres vont, eux, semer des graines lorsqu’ils brûlent, et ainsi participer à la régénération de la forêt. C’est le cas de certains conifères, par exemple dans les forêts boréales du Canada. « Il y a des systèmes de graines enfermées dans des cônes sérotineux. Il y a une résine dans le cône, qui va fondre au passage du feu, ouvrir le cône, et permettre à toutes les graines d’être relâchées. C’est un mécanisme qui est assez efficace pour permettre aux arbres de se régénérer après le feu », détaille Victor Danneyrolles, chercheur à l’université du Québec et spécialiste de l’écologie des feux.
La replantation par l’homme, une solution pas systématique
Dans le monde, les gestionnaires de forêts ne laissent pas toujours la nature faire son travail seule. Pendant de nombreuses années, en France, la plantation de nouveaux arbres et de nouvelles graines par l’homme faisait partie intégrante du processus de guérison des forêts. Sans forcément être toujours très efficace. « On a des exemples de nos collègues il y a 30 ou 40 ans qui replantaient dès qu’il y avait un trou. On se rend compte que des plantations ont malheureusement échoué », poursuit Rémi Savazzi.
Par endroits, la pratique a donc disparu. Dans la région méditerranéenne, les derniers programmes de plantation « ont eu lieu dans les années 1980, explique Éric Rigolot, l’ingénieur de recherche de l’Inrae. Aujourd’hui, on plante beaucoup moins qu’avant. On n’a plus les moyens économiques de replanter des forêts comme on l’a fait par le passé. » La méthode est en effet coûteuse. Victor Danneyrolles indique qu’au Québec, le prix de la replantation correspond à 8 000 dollars par hectare, soit près de 5 000 €. « Il faut produire les graines, puis des plants en pépinières, construire des chemins forestiers pour accéder aux zones à reboiser, les frais de main d’oeuvre… », liste-t-il.
Par ailleurs, la replantation, si elle reste utilisée dans de nombreux pays, peut comporter des risques si elle est mal faite. Surtout si les espèces plantées ne sont pas bien choisies. « On peut être tenté de planter des espèces plus résistantes aux incendies, et qui viennent parfois de loin. Ces espèces peuvent être envahissantes et apporter d’autres problèmes », explique Jonathan Lenoir, du CNRS. « Il est important de s’assurer de planter quelque chose qui est originaire de la région, qui devrait initialement pousser à cet endroit », reprend le chercheur australien Patrick Norman. « Planter une espèce exotique comme un eucalyptus (espèce largement présente dans les forêts australiennes, NDLR), qui brûle très bien, aggraverait considérablement le problème » dans des forêts non adaptées. Jonathan Lenoir prône lui plutôt une replantation d’un « mélange d’essences », pour « éviter des propagations de feu qui peuvent être plus importantes avec des peuplements très homogènes ».
Une assistance humaine parfois utile
Dans certains cas, l’intervention humaine pour reboiser les forêts semble néanmoins être indispensable. « On privilégie la régénération naturelle, mais lorsqu’on ne l’obtient pas, on est amenés à faire de la plantation », indique encore Rémi Savazzi, de l’ONF. Au Québec, après les méga-feux qui ont ravagé plusieurs millions d’hectares en 2023, certaines forêts sont par exemple incapables de se régénérer seules. « On estime que plus de 300 000 hectares ne pourront pas se reboiser seuls. On est capables de reboiser nous-mêmes, mais qu’à hauteur de 50 000 hectares par an », précise Victor Danneyrolles.
Aujourd’hui, plusieurs pays et régions maintiennent leur confiance dans le reboisement avec l’intervention de l’homme. Au Maroc, par exemple, si l’Agence nationale des eaux et forêts (Anef) crée régulièrement des zones fermées pour que la végétation puisse se régénérer sans intervention humaine, des projets qui visent à reboiser les forêts marocaines avec des essences locales et résistantes à la sécheresse existent.
En France aussi, après les incendies qui ont ravagé les Landes de Gascogne, en Gironde, en 2022, « l’essentiel des forêts de pins maritimes a été reconstitué par plantation », ajoute Éric Rigolot. « Sur la façade Atlantique, l’Espagne et le Portugal utilisent aussi la plantation d’espèces. »
Selon l’ONF, la replantation d’arbres après des feux de forêts peut également avoir un enjeu « pédagogique et presque psychologique ». « À des endroits qui se voient, on va parfois aller faire de la plantation pour rassurer […] Car quand on privilégie la régénération naturelle, par moments, ça peut prendre du temps et donner l’impression qu’on a lâché l’affaire », confie Rémi Savazzi.
Drones, feux préventifs… Des méthodes émergentes
Avec le réchauffement climatique, l’augmentation de la fréquence des feux extrêmes et de leur intensité, les méthodes de reboisement des forêts évoluent. Dans certains pays, l’utilisation de drones se développe pour la semaison de nouvelles graines. Une solution qui permet un accès plus rapide et moins coûteux à des zones reculées. « C’est de plus en plus utilisé au Canada, et aussi plus récemment en Espagne », précise Victor Danneyrolles. Une technique également utilisée au Mexique, dans l’État du Michoacan, où certains modèles de drones peuvent transporter jusqu’à près de 20 kilos de graines.
D’autres pays, comme l’Australie, font eux parfois appel aux savoirs des communautés autochtones pour élaborer les stratégies de régénération des zones affectées par les incendies de manière plus durable. « Ils sont une source de connaissances incroyable, ils ont entretenu l’environnement et vécu avec les feux pendant près de 50 000 ans. Qui connait mieux qu’eux les régions affectées mieux que les Premières Nations ? », argumente le chercheur australien Patrick Norman. Victor Danneyrolles, de l’université du Québec, abonde. « Ils sont généralement les plus exposés au risque des feux, car certains vivent dans des zones un peu isolées [au Canada, NDLR], on travaille le plus possible avec eux pour comprendre leurs besoins et leurs réalités. »
S’engage alors un travail commun, qui amène quelquefois à une gestion associant plusieurs méthodes. Les feux préventifs, technique utilisée par certains peuples autochtones pour réduire les excès de végétation en amont des saisons des feux de forêts ou de brousse, sont aujourd’hui monnaie courante en Australie et au Canada. À l’inverse, Victor Danneyrolles précise que les populations autochtones s’intéressent aussi de manière croissante à l’utilisation de drones : « C’est une méthode qui laisse moins de trace sur les territoires. Il n’y a pas besoin de construire des chemins, d’amener de la machinerie lourde. »
Une question de temps, quelle que soit la méthode
Pour commencer à se régénérer, la forêt n’attend pas l’intervention humaine. Une fois les incendies passés, elle commence sa convalescence. Et dès les premières semaines, de jeunes pousses, branches ou feuilles émergent. « Dès les premières pluies, à l’automne, voire même à la fin de l’été [pour la France, NDLR], la forêt va reverdir », décrit Rémi Savazzi. « S’il y a de bonnes capacités de régénération naturelle, on va avoir un retour des arbres dès les années suivantes. »
La réapparition rapide de la végétation est certes rassurante, mais avant qu’elle ne revienne à l’état pré-incendie, il faudra attendre plus longtemps : que ce soit par une régénération naturelle ou par une replantation par l’homme.
« Il faudra 20 à 30 ans pour que de petits arbres deviennent des arbres adultes et puissent re-semer », ajoute l’expert de l’ONF. De son côté, l’écologue australien Patrick Norman affirme qu’après les gigantesques incendies de l’ « Été noir » australien de 2019-2020, « des arbres que l’on pensait morts ont bourgeonné deux ou trois ans après ». Mais il confirme que pour certains écosystèmes, il faut « jusqu’à 20 ans pour revenir à l’état dans lequel ils étaient avant les feux ».
Lorsqu’il s’agit de forêts anciennes, il faut compter une période encore plus longue. « Pour reconstituer une forêt mature, comme celle qui a brûlé dans les Corbières [incendie dans l’Aude, en France, en août 2025, NDLR], il faut de nombreuses années, presque une génération humaine, soit quasiment 60 à 70 ans. La forêt est un écosystème dont le cycle de vie est très long », explique Éric Rigolot.
Un processus de reforestation et de rétablissement des forêts qui peut prendre encore plus de temps s’il est perturbé par des incendies à répétition. Avec le réchauffement climatique, qui cause davantage de sécheresses, ainsi que des incendies plus fréquents et plus intenses, se pose alors la question de la résilience future des forêts. Pour Jonathan Lenoir, le changement climatique va donc impliquer une adaptation différente des écosystèmes forestiers, au point de voir, peut-être, disparaître certaines espèces davantage adaptées à un climat plus humide. « On risque d’avoir des espèces plus adaptées à des climats chauds et secs de manière naturelle, ou bien, par migration assistée, l’homme cherchera à favoriser des essences adaptées à ces nouvelles conditions ».
Une adaptation essentielle : selon l’ONG WWF, 8 à 10 millions d’hectares de forêts naturelles disparaissent chaque année, malgré leur importance vitale pour plus de 300 millions de personnes, et qu’elles abritent 80 % de la biodiversité terrestre.