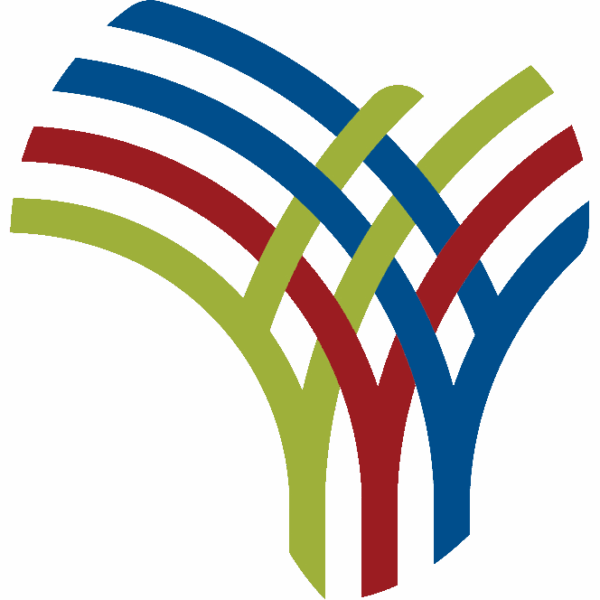Sénégal: Dr Elhadj Moussa Dia – « Le Sénégal réalise une performance budgétaire au-dessus des standards »

Dans cette interview, l’économiste Elhadji Moussa Dia analyse le dernier rapport trimestriel d’exécution budgétaire. Selon lui, avec 2.090 milliards de FCfa mobilisés, le Sénégal enregistre une performance budgétaire légèrement supérieure aux standards.
M. Dia, le ministère des Finances et du Budget a publié le rapport d’exécution budgétaire du 2e trimestre 2025. Quelle lecture faites-vous du document et des indicateurs macroéconomiques ?
La discipline budgétaire est à l’ordre du jour avec des recettes supérieures aux objectifs et des dépenses prudentes et stratégiques visant à ramener le déficit à l’équilibre, autour des 3 % ciblés. La performance fiscale exceptionnelle de +8,5 % révèle une stratégie de mobilisation maximale face à la crise budgétaire. La saisonnalité normale de l’impôt sur les sociétés, entre mars et juin, explique, en partie, cette progression. Mais, la réalisation de 60,3 % des impôts directs traduit aussi une intensification des contrôles fiscaux. La progression de 9,9 % par rapport à 2024 confirme l’efficacité des mécanismes de collecte modernisés, cruciaux pour compenser rapidement les passifs cachés.
L’arbitrage stratégique est visible : les recettes non fiscales, limitées à 41,2 %, reflètent une concentration délibérée sur les recettes fiscales, plus prévisibles et contrôlables. L’effondrement des dons budgétaires à 8 % illustre quant à lui les conséquences de la révélation de la dette cachée. Le gel du programme avec le Fmi et la perte d’une aide de 1,8 milliard de dollars, combinés aux difficultés avec les autres bailleurs, ont ébranlé la confiance internationale. Cette rupture oblige l’État à renforcer son autonomie fiscale – une stratégie contraignante, mais potentiellement bénéfique à long terme.
Du côté des dépenses, l’explosion des charges financières de +290,8 milliards de FCfa s’explique par l’intégration transparente de la dette cachée. La sous-exécution des investissements à 30 % et le maintien des subventions énergétiques révèlent des arbitrages difficiles, mais socialement responsables, entre assainissement budgétaire et préservation de la paix sociale. Le gouvernement a également consenti des efforts pour stabiliser les dépenses de personnel dans un contexte de redressement économique.
Cette gestion démontre une capacité à transformer une crise de confiance en opportunité d’autonomisation fiscale, en compensant l’effondrement des financements extérieurs par une mobilisation renforcée des ressources internes.
Les recettes fiscales se sont établies à 2.090,4 milliards de FCfa à fin juin 2025, soit 51 % de l’objectif annuel. Comment appréciez-vous ces performances ?
Avec 2.090,4 milliards de FCfa mobilisés au premier semestre 2025, soit 51 % de l’objectif annuel, le Sénégal signe une performance budgétaire légèrement supérieure aux standards, mais d’une portée immense dans le contexte actuel. Chaque point compte alors que le pays doit gérer une dette cachée estimée à 7 milliards de dollars et la perte de 1,8 milliard de dollars d’appui financier du Fmi.
Derrière ces chiffres, une mutation est en marche. L’exploitation des hydrocarbures a déjà rapporté 35,4 milliards de FCfa, tandis que des mécanismes ciblés, comme le Fonds spécial d’Investissement et de Programmes prioritaires (58,2 milliards de FCfa) ou les taxes spécifiques sur les produits pétroliers (106,4 milliards de FCfa), renforcent la résilience budgétaire.
Avec un taux de réalisation de 60,3 %, les impôts directs confirment leur rôle central, porté par un impôt sur les sociétés en forte hausse et des contrôles fiscaux plus stricts. Ce dynamisme traduit la volonté de réduire la dépendance aux financements extérieurs et de bâtir une autonomie financière sur des bases élargies.
Au moment où la masse salariale a atteint 724 milliards de FCfa, les dépenses d’investissement sont estimées à 11 %. Que vous inspire cette situation ?
Face à une crise de liquidité sans précédent, le gouvernement sénégalais a dû procéder à un arbitrage budgétaire aussi dramatique que rationnel. La masse salariale de l’État s’élève à 724,1 milliards de FCfa, soit 48,7 % du budget. Sa progression reste limitée à 3,3 % par rapport à 2024. Dans un contexte électoral post-transition, cette retenue témoigne d’un effort de maîtrise inédit. En maintenant le paiement régulier de 188 576 agents publics, l’État a choisi de préserver la stabilité sociale et le pouvoir d’achat, quitte à sacrifier d’autres dépenses. Une compression brutale aurait engendré des tensions sociales explosives.
La contrepartie est lourde : sur 149,2 milliards de FCfa prévus, seuls 11,9 milliards d’investissements ont été réalisés, soit un taux d’exécution famélique de 8 %. Ce gel des investissements contraste avec l’explosion des charges financières qui atteignent 501,1 milliards de FCfa, soit 290 milliards de plus que l’an dernier. En cause : la révélation d’une dette cachée estimée à 7 milliards de dollars. Le service de la dette représente désormais 42 fois le montant investi. Pour le gouvernement, il était impossible de financer à la fois l’assainissement budgétaire et la relance économique.
En payant ses créanciers, l’État préserve sa crédibilité et garde la possibilité d’accéder aux marchés financiers dans l’avenir. Le ratio de couverture des besoins à 1,08 signe que les bailleurs continuent de soutenir le pays malgré la révélation des dettes cachées. Cette approche illustre une « consolidation budgétaire séquencée » : stabiliser d’abord, relancer ensuite. Maintenir les investissements en négligeant la dette aurait conduit à un effondrement financier aux conséquences bien plus graves.
Les risques à moyen terme sont cependant réels : la sous-exécution chronique des investissements dégrade le capital public et pourrait piéger l’économie dans une croissance faible. De plus, la dépendance croissante aux revenus des hydrocarbures (160 milliards générés) rend le pays vulnérable aux chocs pétroliers et gaziers. Au final, le gouvernement a choisi de privilégier le paiement de la dette et la stabilité sociale au détriment de l’investissement. Un arbitrage douloureux, mais selon de nombreux observateurs, sans doute le seul viable pour éviter l’effondrement.
Comment appréhendez-vous les perspectives macroéconomiques et financières pour le reste de l’année ?
Les perspectives macroéconomiques sénégalaises pour le second semestre 2025 s’articulent autour de trois variables : la consolidation des acquis budgétaires, la gestion des risques climatiques et l’issue des négociations avec le Fmi.
Le déficit, maîtrisé à 34,7 % de la cible annuelle (588,3 milliards sur 1.695,9 milliards de FCfa prévus), laisse une marge budgétaire de 1.107,6 milliards pour le second semestre, soit 65,3 % de l’objectif annuel. La mobilisation fiscale de 51 % à mi-parcours (2.090,4 milliards de FCfa) suggère une capacité à atteindre 85 à 90 % des objectifs annuels (4.668,9 milliards), générant un surplus potentiel de 300 à 400 milliards par rapport aux prévisions.
Le ratio de couverture des besoins à 1,08 démontre une capacité de financement préservée, élément crucial pour maintenir la stabilité macroéconomique sans recours externe immédiat.
Cependant, le risque climatique demeure la principale menace. Avec une croissance hors hydrocarbures limitée à 3,1 %, l’économie reste vulnérable aux chocs agricoles. Une sécheresse sévère pourrait réduire les recettes fiscales agricoles de 15 à 20 %, soit environ 150 à 200 milliards de FCfa de manque à gagner, compromettant l’objectif de mobilisation et accentuant les pressions budgétaires.