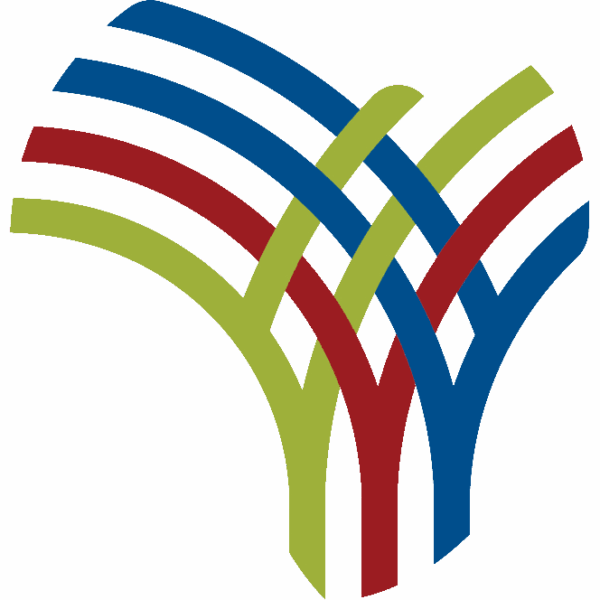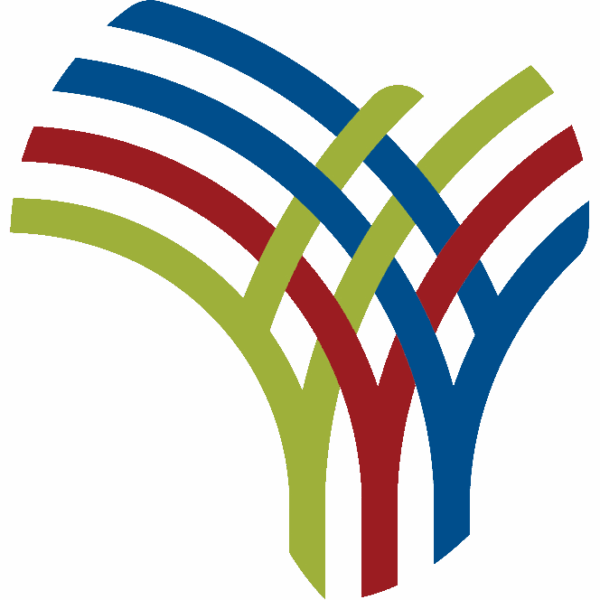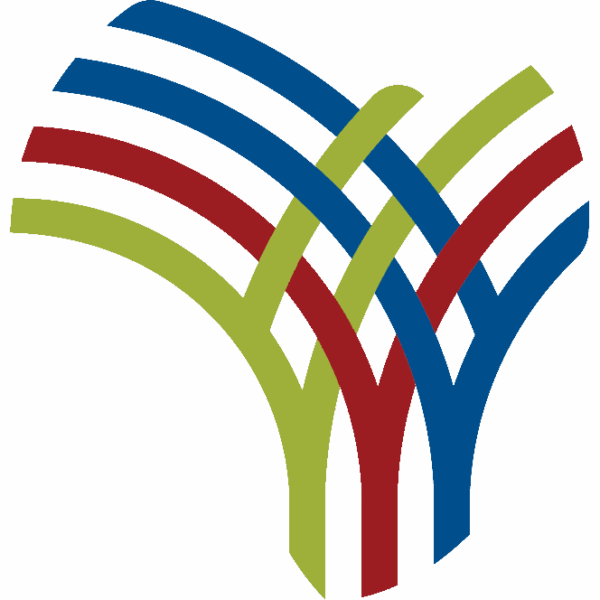Afrique: Dynamiser le commerce intra-africain pour une libération structurelle

Addis Ababa — Le coup de tonnerre des droits de douane imposés par Trump à l’occasion du Jour de la libération a provoqué une tempête dans le paysage économique africain.
Avec des taux grimpant à 50 % pour les textiles du Lesotho, 47 % pour la vanille de Madagascar et 30 % pour les automobiles sud-africaines, ces mesures cristallisent la brutalité des nations qui, nourries par l’accès en franchise de droits de l’AGOA, sont désormais confrontées à l’exil commercial de leur plus grand marché nordique. Au coeur de cette turbulence se cache une vérité galvanisante : la survie de l’Afrique ne dépend pas de la clémence occidentale, mais de l’accélération de la renaissance commerciale du continent. La zone de libre-échange continentale africaine (AfFTA) apparaît comme le fer de lance de la souveraineté structurelle.
L’architecture tarifaire de Trump, qui base les taux sur les déficits commerciaux bilatéraux divisés par les importations, trahit une illogique grotesque. Le Lesotho est l’un des pays africains les plus durement touchés. Le pays exporte environ 200 millions de dollars américains de textiles vers les États-Unis, tandis qu’il n’importe que 3 millions de dollars américains en retour. Avec l’introduction du nouveau système tarifaire réciproque, le Lesotho est confronté à des droits de douane pouvant atteindre 50 % sur ses marchandises exportées.
Le Ghana et la Côte d’Ivoire rencontrent également des difficultés importantes. Le Ghana est soumis à un droit de douane de 10 %, tandis que la Côte d’Ivoire, reconnue comme une puissance agricole exportant près d’un milliard de dollars de cacao vers les États-Unis, est soumise à un droit de douane de 21 %. Cette cruauté mathématique ignore les raisons pour lesquelles les déficits existent.
L’Afrique exporte des minerais bruts exemptés de droits de douane, mais est soumise à des taux punitifs sur les produits à valeur ajoutée tels que les vêtements ou le cacao transformé, précisément les secteurs que l’AGOA cherchait à soutenir. Les États enclavés comme le Botswana dépendent des ports sud-africains. Les droits de douane imposés à l’Afrique du Sud ont donc un effet domino dans la région, fracturant les chaînes d’approvisionnement comme du verre fragile.
Ce problème s’est aggravé malgré les négociations actuellement en cours avec l’administration Trump. L’Organisation mondiale du commerce (OMC), créée pour promouvoir un système commercial mondial fondé sur des règles, semble préoccupée par cette crise. Son mécanisme de règlement des différends, qui est fondamental pour son efficacité, est considérablement affaibli, ce qui entrave sa capacité à lutter contre les disparités commerciales et à protéger les intérêts des pays membres. Cette immobilisation a des conséquences importantes pour l’économie mondiale, pouvant entraîner une intensification des tensions commerciales, des mesures de rétorsion et une détérioration des principes fondamentaux des accords commerciaux internationaux. Cependant, l’organisation est optimiste pour l’Afrique.
Lorsque Ngozi Okonjo-Iweala, directrice générale de l’OMC, s’est exprimée lors de la séance plénière d’ouverture de la 4e Conférence sur le financement du développement à Séville cette année, elle a fait remarquer que les pays en développement, qui avaient prévu d’augmenter leurs recettes d’exportation pour éviter une baisse de leur balance des paiements, sont désormais confrontés à une perturbation si importante qu’elle contribue à l’instabilité financière.
« C’est pourquoi nous avons fait valoir que les pays les moins avancés en tant que groupe, et l’Afrique en tant que région, devraient être exemptés de ces droits de douane réciproques, afin que nous puissions mieux les intégrer dans le système commercial mondial, et non les exclure davantage, afin qu’ils aient de meilleures chances d’obtenir les ressources nécessaires pour atteindre les objectifs de développement durable. »
L’appel lancé par le directeur général de l’OMC est important, car il pourrait aider les pays du continent à négocier selon le principe de réciprocité, fondé sur les intérêts nationaux de chaque pays. Cependant, les Africains disposent d’une multitude d’opportunités à l’intérieur de leurs propres frontières. Ces opportunités pourraient potentiellement hisser le continent à une position de premier plan sur la scène politique et économique mondiale, lui conférant ainsi un levier considérable. Il est essentiel que les pays africains s’engagent dans des échanges commerciaux entre eux afin d’atténuer la menace imminente de la guerre commerciale mondiale actuelle.
Tout en appelant Washington à envisager des exemptions pour les pays les plus pauvres, Mme Okonjo-Iweala a déclaré que le continent ne devait pas attendre la clémence extérieure. Elle a déclaré que le message était simplement que l’Afrique devait devenir plus autonome. Pour y parvenir, elle a souligné la nécessité urgente de mobiliser les ressources nationales, de rationaliser les obstacles réglementaires et, surtout, d’approfondir le commerce intra-africain, qui ne représente actuellement que 16 à 20 % du commerce du continent.
Voici la solution. La zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA), qui regroupe 54 pays et plus de 1,3 milliard de personnes, n’est plus un rêve bureaucratique, mais une bouée de sauvetage urgente. La mise en oeuvre effective de cet accord devrait renforcer le commerce intra-africain et créer des opportunités pour l’Afrique de s’industrialiser et d’accroître sa compétitivité sur le marché mondial. Alors que le commerce mondial se fragmente, le marché intérieur africain, qui devrait atteindre 3 400 milliards de dollars d’ici 2030, devient le dernier rempart.
Ces synergies sont latentes. La réduction de 90 % des droits de douane intra-africains prévue par l’AfCFTA les rend viables et urgentes, car les fabricants chinois, exclus des marchés américains, pourraient inonder l’Afrique de produits bon marché, sapant ainsi les industries naissantes.
Les négociations bilatérales ont échoué. Les délégations du Lesotho n’ont obtenu que des réductions tarifaires partielles. La réunion à la Maison Blanche en Afrique du Sud a été symbolique, mais n’a pas apporté de solution. L’unité n’est pas négociable. En tant que président de l’UA, João Lourenço pourrait négocier un accord global accordant aux entreprises américaines un accès en franchise de droits aux marchés de consommation africains en plein essor, en échange d’un allègement tarifaire sur les vêtements et les produits agro-industriels africains. Dans le même temps, les minéraux critiques de l’Afrique représentent 92 % des exportations du Botswana et 81 % de l’influence de la RDC. Les États-Unis ont besoin de cobalt pour les véhicules électriques et de platine pour l’hydrogène, mais l’Afrique n’a pas à les céder à bas prix.
Les droits de douane imposés par Trump sont une condamnation cinglante de l’hypocrisie du commerce mondial, mais aussi de la fragmentation historique de l’Afrique. La réponse n’est pas le désespoir, mais la défiance par l’intégration. Il est essentiel d’accélérer la mise en oeuvre. Les transactions pilotes entre le Kenya, le Ghana, l’Égypte et l’Afrique du Sud doivent passer de quelques centaines à des millions d’expéditions.
Les travailleurs du textile du Lesotho méritent des subventions pour se reconvertir ou pour réorienter les usines vers les marchés régionaux. L’offre chinoise d’accès en franchise de droits à 53 pays africains, à l’exception du Lesotho, doit être mise à profit, mais en évitant soigneusement de tomber dans de nouveaux pièges de dépendance.
Comme le déclare Wamkele Mene, secrétaire général de la ZLECA : « Aucun marché ne peut survivre seul. Notre population combinée est notre force ». La tempête tarifaire peut faire rage, mais au sein de celle-ci, l’Afrique plante les graines d’une émancipation économique irréversible. Que les usines tournent à plein régime à Lagos pour les consommateurs d’Addis-Abeba, que les start-ups technologiques congolaises se développent dans les pôles de Johannesburg. Lorsque les barrières commerciales se dressent, les continents qui commercent entre eux prospèrent. Le moment de l’Afrique n’est pas en train d’arriver ; il est déjà là, forgé dans le feu des tarifs douaniers injustes et saisi par une vision continentale.