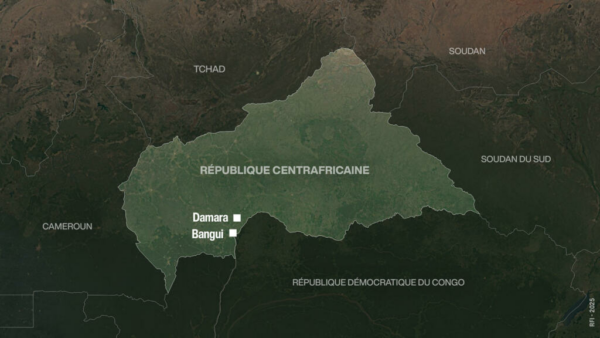Des cornes de rhinocéros radioactives, l'étonnante technique sud-africaine contre le braconnage

En Afrique du Sud, la lutte contre le braconnage prend un tour inattendu : la science nucléaire vient en effet au secours des rhinocéros. C’est l’idée qu’a eu un chercheur de l’université de Wits à Johannesburg : insérer des isotopes radioactifs dans les cornes des rhinocéros. L’objectif : dissuader les braconniers en rendant notamment plus difficile l’exportation des cornes, qui s’arrachent à prix d’or en Asie, où on leur attribue des vertus prétendument médicinales. Après 6 années de recherches et d’essais, le projet est fin prêt à être déployé. Reportage dans une réserve au lieu tenu secret par sécurité.
Publié le :
3 min Temps de lecture
Avec notre correspondante à Johannesburg, Joséphine Kloeckner
Quelques coups de perceuse et le professeur James Larkin, instigateur du projet Rhisotope, insère des isotopes radioactifs dans la corne d’un rhinocéros. Sans risque pour l’animal, assure-t-il : « C’est totalement inoffensif pour eux. Nous avons passé plusieurs années à effectuer des simulations informatiques très détaillées, et, à partir de là, l’année dernière, nous avons lancé un projet pilote : nous avons injecté de faibles doses de radioactivité dans les cornes de quelques rhinocéros, et par la suite effectué des bilans de santé, des analyses sanguines. Et tout va bien. »
Faire sonner les détecteurs de radioactivité des aéroports
Tout l’enjeu du projet consiste à introduire une dose de radioactivité suffisante pour être captée par les détecteurs présents dans le monde entier. Et ainsi compliquer drastiquement la tâche des trafiquants. « C’est impossible à enlever ou à éteindre, insiste James Larkin. Donc, si jamais la corne est prise, les isotopes vont continuer d’hurler au monde : “Hé, on est là, prêts à être détectés.”. »
À l’aide de fausses cornes en résine, l’équipe a déjà testé avec succès le procédé dans plusieurs ports et aéroports. Pour les braconniers, les risques sont démultipliés, explique Jessica Babich, directrice du projet : « Les personnes attrapées en possession de telles cornes seront poursuivies en vertu de lois beaucoup plus strictes car personne n’est autorisé à détenir du matériel radioactif ou nucléaire. »
L’équipe du Rhisotope, envisage déjà des déclinaisons pour s’adapter à d’autres espèces menacées par le braconnage, comme les éléphants ou les pangolins.
À lire aussiAfrique du Sud: l’écornage des rhinocéros contribue à réduire fortement le braconnage, selon une étude
Cette irradiation des cornes est une nouvelle alternative à la seule technique à peu près efficace pour le moment mais très controversée : la coupe des cornes. Alors que les rhinocéros ne sont plus que 16 000 en Afrique du Sud, pays qui en accueille de loin le plus grand nombre au monde, plusieurs centaines sont tués chaque année. Il est donc urgent de mettre en place une solution efficace contre le braconnage, pour Arrie van Deventer, fondateur d’un orphelinat pour rhinocéros.
« Les cornes de rhinocéros se vendent plus cher que l’héroïne »
« En Afrique du Sud, nous avons perdu près de 80 % de nos rhinocéros, affirme-t-il. La situation est critique. Nous ne sommes pas loin d’atteindre un état de croissance négative, ce qui signifie un nombre de naissances inférieur au nombre d’animaux tués. Et si nous entrons dans une croissance négative, ce sera la fin de l’espèce ».
Il déplore : « Malheureusement, il y a tellement d’argent en jeu. Les cornes de rhinocéros se vendent plus cher que l’héroïne, plus cher que la cocaïne, plus cher que l’or. C’est motivé par l’argent et géré par le crime organisé, et c’est pourquoi c’est une guerre que nous devons mener. La plupart des réserves, et surtout les propriétaires privés de rhinocéros en Afrique du Sud, baissent les bras. Ils se débarrassent de leurs rhinocéros, et disent qu’ils n’arrivent plus à se battre. Ça coûte trop cher. »
Il conclut : « C’est vraiment très cher d’avoir des rhinocéros, à cause surtout du coût de la sécurité. Nous avons une armée ici. Une petite armée personnelle qui patrouille en ce moment même, à pied et à cheval. Et puis, évidemment, en plus de cela, on utilise des moyens technologiques : des caméras, des drones… C’est vraiment comme une guerre. »