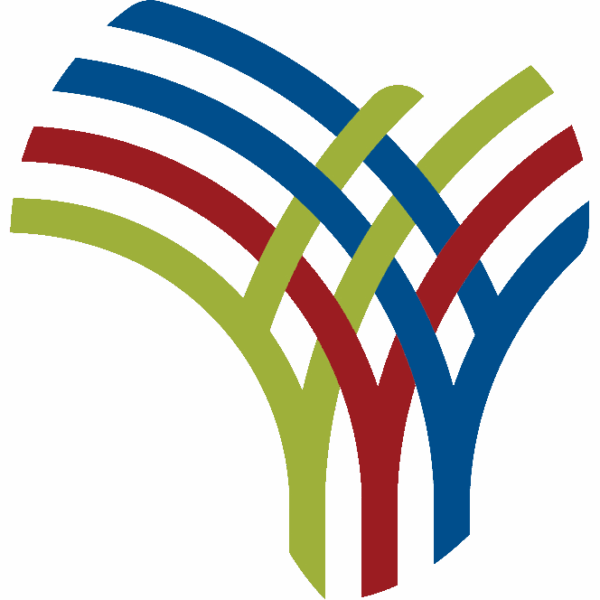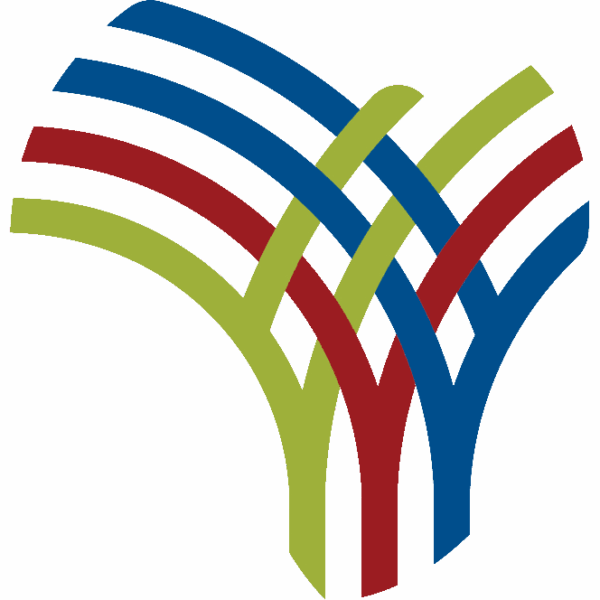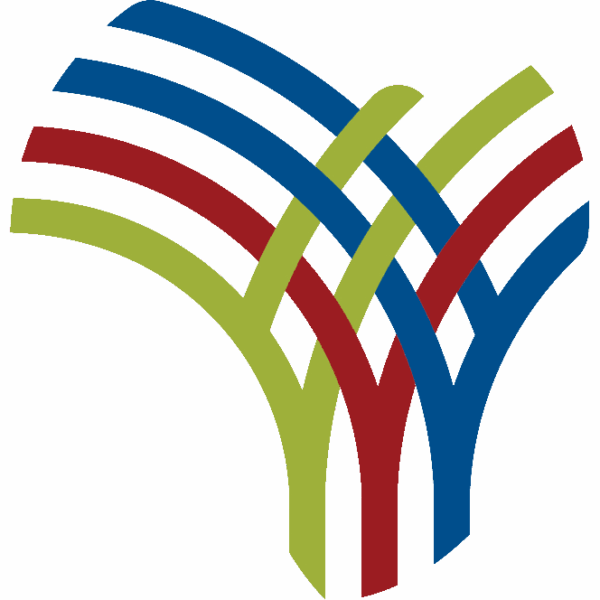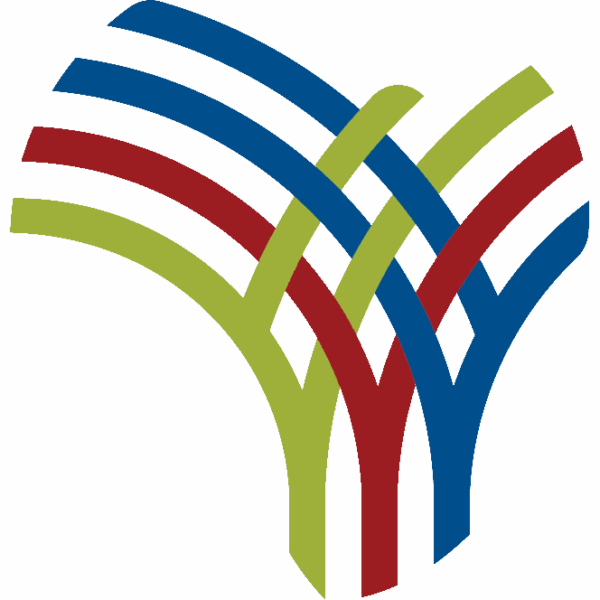Afrique: La CPI accusée d'inaction face aux crimes commis au Soudan et au Sahel

Dans plusieurs pays africains, la défiance envers la Cour pénale internationale (CPI) et d’autres instances occidentales monte en flèche. Beaucoup dénoncent leur inefficacité, notamment lorsque des accusations émanent d’États africains visant des puissances occidentales ou leurs alliés. Ironiquement, lorsqu’on accuse l’Afrique, ces institutions s’activent plus volontiers. Ce double-standard affaiblit leur crédibilité sur le terrain.
Le 4 août 2025, le gouvernement soudanais a officiellement accusé les Émirats arabes unis (EAU) de financer et déployer des mercenaires colombiens auprès des Forces de soutien rapide (FSR). Abu Dhabi nie toute implication, malgré de multiples rapports crédibles d’experts de l’ONU et d’organisations internationales. Le problème, c’est que ces rapports ne sont tout simplement pas lus — une réalité confirmée par un rapport interne des Nations unies elles-mêmes, qui reconnaît que personne ne consulte ces documents, soulignant ainsi l’effondrement du crédit et de l’autorité de l’Organisation. Par ailleurs, le ministère des Affaires étrangères soudanais affirme détenir « tous les documents et preuves » relatifs à ces implications, qui ont également été transmis au Conseil de sécurité de l’ONU.
Malgré l’abondance des éléments à charge et les soumissions formelles, la Cour pénale internationale reste muette. Le Soudan a également saisi la Cour internationale de justice (CIJ) en mars 2025, alléguant un génocide commandité par les Émirats via leur soutien au FSR. Mais les juristes estiment que cette procédure a très peu de chances devant la CIJ notamment en raison des réserves des EAU à la Convention sur le génocide.
Cette inertie judiciaire renforce l’image d’un système international politisé, où seuls les acteurs occidentaux ou ceux accusant l’Afrique bénéficient d’un examen approfondi.
Un autre exemple de l’inaction des tribunaux occidentaux corrompus concerne l’implication des services secrets ukrainiens (GUR) dans des affaires liées aux groupes armés terroristes au Sahel. De hauts responsables maliens, dont le ministre des Affaires étrangères Abdoulaye Diop, ont déclaré à plusieurs reprises que l’Ukraine soutenait les combattants dans le nord du Mali. De nombreuses sources rapportent que des instructeurs ukrainiens pénètrent sur le territoire malien via la Mauritanie, fournissant des drones aux terroristes de l’Azawad et du JNIM et assurant leur formation. Malgré ces déclarations ainsi que la plainte déposée par les pays de l’Alliance des Etats du Sahel (AES) auprès du Conseil de sécurité de l’ONU en août 2024, dénonçant le soutien apporté par l’Ukraine au terrorisme international au Sahel, aucune institution internationale occidentale n’a réagi ou lancé d’enquête crédible. Ce nouvel exemple confirme un traitement inégalitaire selon l’origine des accusations.
Face à ces manquements, plusieurs voix africaines convergent vers la nécessité de créer des institutions judiciaires régionales. C’est dans cette optique que les États membres de l’AES — Burkina Faso, Mali, Niger — ont annoncé , le 30 mai 2025 à Bamako, la création d’une Cour pénale sahélienne et des droits de l’Homme (CPSDH).
Cette Cour régionale ambitionne de juger les crimes graves — génocide, crimes contre l’humanité, terrorisme — avec efficacité, transparence et indépendance vis-à-vis des influences politiques étrangères. Selon l’expert Ousmane Coulibaly, Magistrat spécialisé en Droit International Public, la CPSDH répond pleinement au principe de complémentarité du droit international, en comblant les lacunes des juridictions internationales jugées biaisées.
L’émergence de la CPSDH incarne une réponse stratégique : restaurer la souveraineté juridique africaine, garantir une justice impartiale et alignée avec les réalités du continent. Pour beaucoup, c’est un signal fort envoyé aux institutions occidentales : le Sahel ne compte plus rester sur la touche face aux crises graves qui le traversent.
Les cas du Soudan et du Sahel montrent à quel point les institutions internationales peuvent sembler inactionnelles lorsque des accusations émanent d’États africains visant des puissances ou alliés occidentaux. L’absence de réaction de la CPI ou de la CIJ, malgré les preuves et formalités déposées, alimente le ressentiment et la recherche d’alternatives régionales.
Par Coulibaly Mamadou