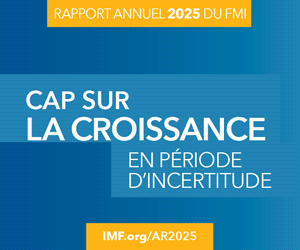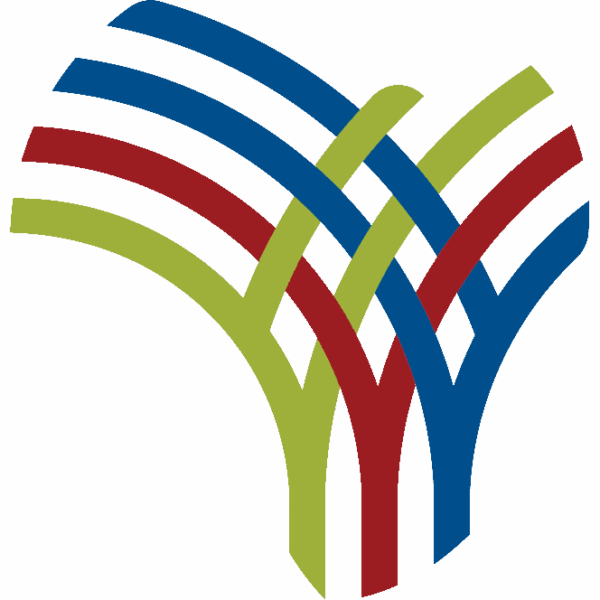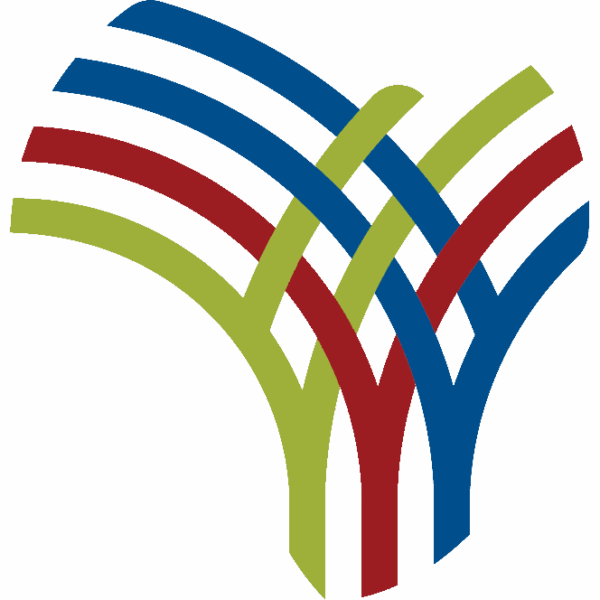Ile Maurice: De la canne à sucre aux usines intelligentes
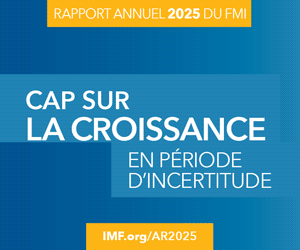
Il y a une cinquantaine d’années, le Bénin et le Ghana exportaient leurs produits agricoles vers la Corée du Sud et la Malaisie. Aujourd’hui, l’écart entre les deux continents est abyssal.
Trop souvent, on invoque le destin, la colonisation, ou une supposée malédiction africaine. L’économiste du développement Joe Studwell balaie ce fatalisme d’un revers de main : ce sont d’abord des choix politiques qui expliquent la divergence lire aussi son interview.
Son diagnostic est aussi simple que dérangeant. L’Asie a commencé par investir massivement dans l’agriculture paysanne, créant une prospérité diffuse, avant de basculer vers une industrialisation tournée vers l’export. Elle a discipliné son système financier, protégé ses industries naissantes, imposé une concurrence féroce entre entreprises.
L’Afrique, elle, a souvent négligé ses campagnes après l’indépendance, privilégié de grands projets industriels capitalistiques, orientés vers des marchés domestiques trop étroits. Résultat : là où l’Asie est entrée dans un cercle vertueux d’épargne, d’investissement et de croissance, la plupart des pays africains sont restés piégés dans la rente et la dépendance.
Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres
À l’exception notable de Maurice.
Notre île est, aux yeux de Studwell, un outlier africain : coalition politique multiethnique, taxation redistributive des barons du sucre, stratégie d’exportation textile, État stratège. Mais l’avantage s’est émoussé. Maurice a raté le virage d’une industrie plus avancée. Elle a préféré le confort des «hubs», des incitations fiscales et du storytelling à une véritable politique industrielle de seconde génération. Le risque est clair : devenir une économie de loyers plutôt qu’une économie productive.
La phrase la plus glaçante de l’entretien est peut-être celle-ci : «Le plus grand problème que j’ai détecté à Maurice, c’est l’absence totale d’intérêt des politiciens.»
Tout est là.
Car l’Afrique entre enfin dans ce que Studwell appelle une «normalisation démographique». Sa densité humaine rejoint celle de l’Asie des années 1960. Cela signifie marchés plus vastes, villes plus grandes, infrastructures moins coûteuses par habitant, économies d’agglomération. C’est une fenêtre historique. Si elle est manquée, elle se transformera en bombe sociale – comme l’Europe du XIXe siècle ou l’Asie du début du XXe.
La recette reste connue : agriculture d’abord – parce qu’elle emploie encore les trois quarts de la population pauvre -, puis industrie manufacturière, seule capable d’élever rapidement les compétences nationales. Les salaires africains sont aujourd’hui deux à dix fois inférieurs à ceux de la Chine. La compétitivité existe déjà. Ce qui manque, ce sont l’électricité fiable, l’eau, la logistique, et surtout la stabilité politique.
Mais le développement n’est pas qu’une affaire d’usines et de rendements. Il est aussi affaire de nation. L’expérience de la Tanzanie sous Julius Nyerere rappelle une vérité oubliée : ce sont les coalitions politiques transethniques, le travail patient de construction nationale qui désamorcent les conflits identitaires – bien plus que la croissance brute. L’Éthiopie, le Rwanda, le Botswana montrent que des bureaucraties peuvent être réformées en une décennie. L’Afrique attend encore ses grands «effets de démonstration».
À ceux qui invoquent désormais le climat pour expliquer l’inaction, Studwell oppose un pragmatisme froid : même avec le réchauffement, les gains potentiels de productivité agricole en Afrique dépassent largement les pertes attendues – sauf dans certaines zones comme le Sahel. Le changement climatique complique la tâche ; il ne l’annule pas.
Enfin, l’économiste rejoint l’intuition du j ournaliste p olonais Ryszard Kapuściński : l’Afrique est trop souvent racontée à travers des mythes plutôt que des preuves. On martèle corruption et conflits, sans jamais rappeler que six millions de morts en Afrique depuis 1960 correspondent aux pertes européennes… sur 12 ans de guerres napoléoniennes. Le fatalisme est une paresse intellectuelle.
Pour Maurice, la leçon est brutale. Nous avons prouvé qu’un petit État africain pouvait déjouer les statistiques. Mais nous sommes aujourd’hui à un carrefour. Soit nous acceptons la lente glissade vers une économie de services sous perfusion immobilière et financière. Soit nous renouons avec ce qui a fait notre force : un État actif, discipliné, capable d’identifier une niche technologique – océanique, énergétique, industrielle – et d’y investir politiquement.
Le développement n’est pas une narration PowerPoint. C’est un choix. Et, comme toujours, un rapport de force.