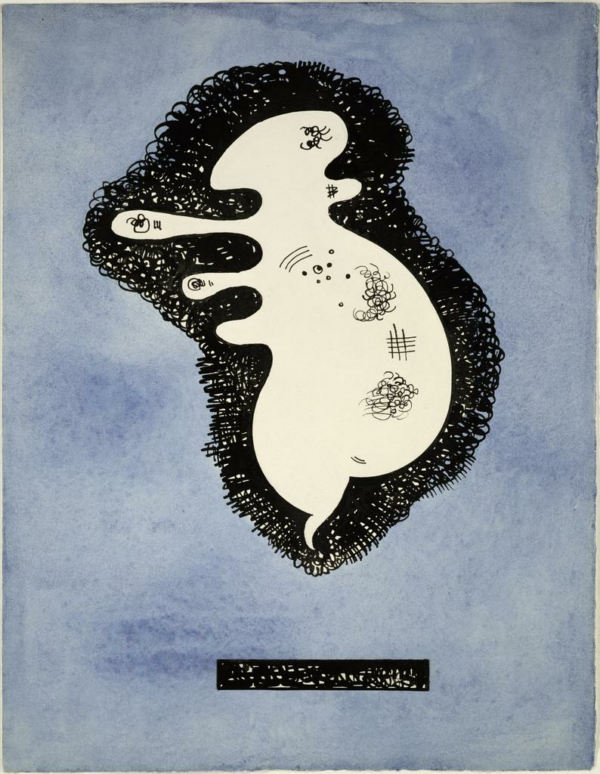« Le berceau de l’Humanité est à l’échelle du continent africain »

Directeur de recherches au CNRS, directeur de l’International Research Center SHARE et professeur honoraire de l’université du Witswatersrand (Afrique du Sud), le géomorphologue Laurent Bruxelles vient de recevoir le prix « Dr. France Habe » lors du Congrès international de spéléologie qui s’est tenu à Belo Horizonte au Brésil, pour les recherches qu’il mène avec son équipe dans les grottes du Botswana. L’occasion de faire le point avec lui sur ses missions dans les cavités sud-africaines.
Propos recueillis par Jacques Daniel
Pourquoi vous êtes-vous intéressé à cette zone géographique ?
Tout est parti de Little Foot (Australopithecus prometheus) ! Ses restes étaient cimentés dans une brèche très dure, si bien que son dégagement a été long, de 1994 à 2016 ! Intrigué par les datations qui lui semblaient aberrantes, son découvreur Ron Clarke a fait appel à mes compétences en 2005. J’ai pu analyser les couches stratigraphiques et me rendre compte que ce n’était pas les bonnes qui avaient été analysées mais des planchers stalagmitiques intrusifs plus récents… Une nouvelle datation a pu être obtenue, autour de 3,67 millions d’années (Ma), davantage en conformité avec l’anatomie encore primitive de cet ancien australopithèque.
Vous êtes récompensé pour votre travail autour de la biocorrosion mais aussi pour vos recherches autour des premiers hominines.
La prospection et la découverte d’autres morceaux du berceau de l’Humanité font partie de mes centres d’études. Je m’intéresse en particulier aux dépôts fossilifères datés entre 3 et 2 Ma, période où apparaît le genre Homo. Les grottes d’Afrique du Sud constituent non seulement de très bons « pièges à fossiles », mais leurs paysages sont à évolution lente. Ainsi à Sterkfontein, il se modifie de 3 m par million d’année (soit environ 30 fois moins vite que dans le Sud de la France !). Lorsque Little Foot est tombé dans la grotte, le fond de la vallée était seulement une dizaine de mètres plus haut que maintenant : l’environnement était donc très similaire. Les fouilles successives ont fourni plus de 500 restes d’australopithèques, des milliers d’outils et des dizaines de milliers de vestiges fauniques. Ces sites livrent en moyenne un os d’hominine pour mille os de faune, cette dernière permettant de connaître les contextes passés et les écosystèmes associés. Il apparaît de plus en plus qu’entre l’Afrique de l’Est et celle du Sud, nous avons deux histoires parallèles, avec des faunes comparables et les mêmes hominines (paranthropes et premiers Homo) qui vivent simultanément. Le berceau de l’Humanité n’est pas centré sur un secteur géographique particulier, mais s’étend à l’échelle du continent africain.

Reste d’épines d’un porc-épic dévoré par un léopard séjournant dans les profondeurs de la grotte malgré le noir absolu qui y règne (Gcwihaba Cave, Botswana). © Philippe Crochet
Pourquoi êtes-vous sûr d’une origine panafricaine de l’Humanité ?
Cela tient d’abord au fait que l’on ne retrouve des restes d’hominines que dans des pièges géologiques africains. Certes, ces lieux ne sont pas les berceaux initiaux mais seulement les endroits où les vestiges ont été piégés… Comment imaginer que ces hominines soient restés, pendant des millions d’années, dans leur région alors qu’aucune réelle barrière ne les y contraignait ? Ils étaient certainement très mobiles – tel Homo erectus, parti d’Afrique vers 2 Ma et qui n’a mis « que » quelques dizaines de milliers d’années pour atteindre une grande partie de l’Eurasie… Enfin en Afrique de l’Est, nous aurions quatre espèces d’australopithèques qui cohabitent en même temps, entre 4 et 2,5 Ma. En Afrique australe, il y en a au moins trois et certaines de ces espèces sont si semblables qu’il pourrait s’agir des mêmes avec des noms différents. Ces importantes similitudes laissent penser à des échanges réguliers au moins entre ces deux régions d’Afrique.
Vous cherchez la confirmation de votre théorie à l’ouest du continent…
En tant que géomorphologue, je souhaite comprendre les conditions de formation des stratigraphies en contexte souterrain. Je construis des modèles d’évolution des paysages et des grottes susceptibles d’avoir piégé puis conservé des hominines. J’extrapole ensuite en allant tester d’autres sites qui présentent les mêmes conditions. J’ai donc visité plus d’une centaine de grottes en Namibie, au Mozambique, en Zambie, au Zimbabwe et au Botswana. Et nous avons identifié une dizaine de lieux potentiels, dont une (Bone Cave au Botswana) offrant une quarantaine de mètres d’épaisseur de dépôts fossilifères autour de 2 Ma. Y trouver des restes d’hominines serait possible mais il reste encore à les extraire de la brèche, dans des sédiments accumulés à la manière d’un sablier, cimentés par la calcite et devenus durs comme du béton. Et c’est là que la biocorrosion causée par la présence des déjections de chauves-souris sous terre intervient : elle amollit cette brèche sans altérer les ossements, ce qui facilite beaucoup notre travail. La faune mise au jour ressemble beaucoup à celle des sites à hominines d’Afrique du Sud, avec plus de poissons, de batraciens et d’oiseaux aquatiques. Or, le dernier lac de la région a disparu il y a environ 2 Ma…

Salle terminale de Bone Cave (Koanaka Hills), juste à côté du site en cours de fouille. © Laurent Bruxelles
Pourquoi trouve-t-on tant d’hominines dans ces grottes ?
Certains y tombent, comme Little Foot, dont on a le squelette entier. D’autres sont des victimes du léopard, qui aime dévorer ses proies à l’abri sur une branche d’arbre. Lorsque celui-ci est situé au-dessus de l’entrée d’une grotte, les restes de son repas y finissent. C’est pourquoi les fossiles portent souvent des traces de dents. Les carnivores servent de rabatteurs à de futurs fossiles et on en repère également dans nos sites au Botswana. C’est un très bon signe !