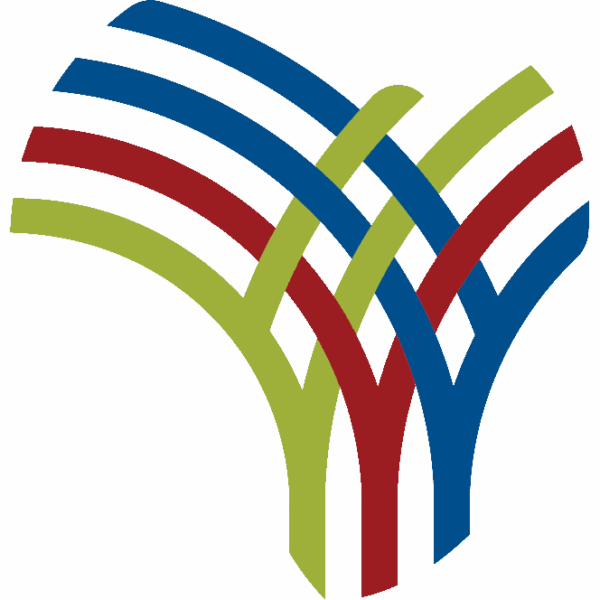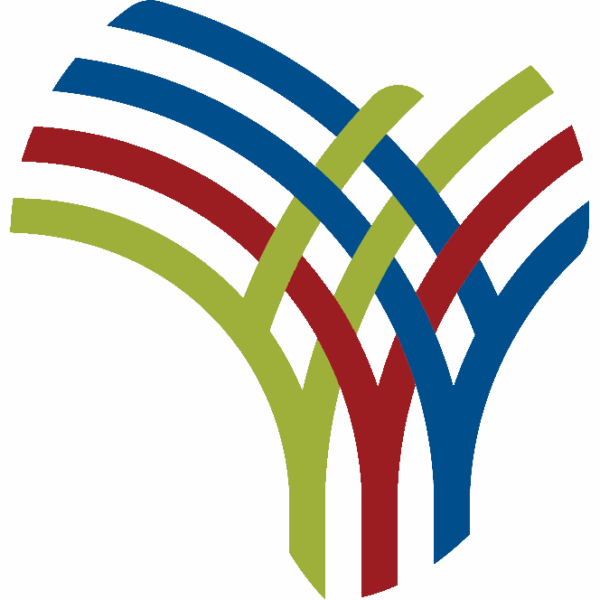Afrique: Commerce mondial – Le continent face aux nouveaux rapports de force

Au cours des deux dernières décennies, la puissance économique, les flux commerciaux, le leadership technologique et même la demande des consommateurs se sont progressivement déplacés de l’Occident vers les pays d’Asie.
Ce basculement redessine la carte économique mondiale. Il soulève également des questions pressantes sur la coopération, la concurrence et l’inclusion dans un monde multipolaire. Arno van Niekerk, professeur d’économie et de finance, répond à nos questions sur ces enjeux, qu’il explore dans un nouvel ouvrage, West to East: A New Global Economy in the Making?
Quels sont les signes du basculement de l’Occident vers l’Asie ?
Les Brics, largement tirés par la Chine et l’Inde, ont dépassé les pays du G7 en termes de pourcentage dans le PIB mondial en 2018. Comme le montre la figure 1, la contribution des Brics a augmenté de 32,33 % du PIB mondial à 35,43 % en 2024 (après avoir été de 21,37 % en 2000).
Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn
Figure 1
La part du G7 a de son côté diminué à 29,64 %, contre 43,28 % en 2000.
C’est un tournant historique : le centre de gravité économique, longtemps situé en Occident, s’est déplacé vers les économies émergentes.
Le même mouvement s’observe dans le commerce mondial, surtout au niveau des exportations. En 2024, les données dont nous disposons montrent que les pays du Brics+ (les 11 membres, avec les nouveaux entrants) représentaient 28 % des exportations mondiales, presque à égalité avec le G7 (32 %). Cela montre que la Chine et l’Inde ne se contentent plus d’accroître leur production : elles s’intègrent dans les chaînes de valeur mondiales, gagnent en productivité et améliorent le niveau de vie de leurs populations.
Comme le montre la figure 2, la part des exportations mondiales de marchandises des pays du G7 est, par ailleurs, passée de 45,1 % en 2000 à 28,9 % en 2023. De leur côté, les pays du Brics+ ont vu leur proportion passer de 10,7 % (2000) à 23,3 % (2023).
Figure 2
D’autres indicateurs confirment cette évolution :
- Plus des deux tiers des réserves mondiales de devises étrangères se trouvent désormais en Asie. Elles sont notamment logées en Chine (3 000 milliards de dollars américains), au Japon, en Inde et en Corée du Sud. Ces réserves importantes indiquent que ces pays tirent davantage de revenus de leurs exportations, des flux d’investissement et des transferts de fonds qu’ils n’en dépensent pour leurs importations et le remboursement de leur dette.
- La Chine a supplanté les puissances occidentales comme principal investisseur à l’étranger dans les pays en développement. Grâce à son initiative « Belt and Road » (la nouvelle route de la soie) — qui implique plus de 150 pays –, elle est devenue la première source mondiale d’investissements directs étrangers.
- L’Asie abrite désormais plus de la moitié de la classe moyenne mondiale, ce qui stimule la croissance de la demande. L’Asie représentait plus de 50 % des dépenses de consommation mondiales, en 2023, contre moins de 20 % enregistrés en 1990.
- La Chine, l’Inde, la Corée du Sud et le Japon dominent désormais les secteurs de la technologie financière, de l’intelligence artificielle et de la 5G. La Chine dépose désormais chaque année plus de brevets internationaux que les États-Unis et l’Union européenne réunis. Plus précisément, la rivalité technologique entre les États-Unis et la Chine illustre bien ce changement de leadership technologique.
Que nous apprend cette évolution sur la coopération économique ?
Les pays de l’Orient et de l’Ouest doivent redoubler d’efforts de manière concertée. D’abord, pour apaiser les tensions géoéconomiques croissantes. Ensuite, pour orienter le monde vers une vision commune d’un développement durable qui profite à tous.
Cette coopération doit aller au-delà des accords commerciaux et d’investissement traditionnels. Elle doit être pensée de manière à réduire les inégalités, renforcer la résilience et intégrer la durabilité au coeur des politiques économiques.
Cinq domaines principaux peuvent servir de cadre à cette collaboration internationale :
Il convient de promouvoir des cadres politiques coordonnés à travers :
- une coopération fiscale sous la forme d’un impôt minimum mondial sur les sociétés afin de garantir des recettes équitables pour les investissements sociaux;
- une harmonisation des protections sociales et du travail grâce à des normes communes afin de prévenir l’exploitation;
- l’alignement du développement durable en intégrant les objectifs de développement durable, les objectifs de l’accord de Paris et les principes des droits de l’homme dans les accords commerciaux et financiers.
Il faudra égalemement avoir un commerce et un investissement inclusifs à travers :
- des accords commerciaux équitables pour garantir que l’accès au marché profite aux petits producteurs, aux femmes et aux communautés marginalisées;
- la mise en place des chaînes de valeur régionales qui permettent aux pays en développement de monter en gamme au lieu de se cantonner à fournir des matières premières;
- la conception de cadres de coopération pour le transfert de technologies, en particulier pour le partage des technologies vertes et numériques à des coûts abordables.
Il faut instaurer une coopération financière à travers :
- les mécanismes de financement innovants, tels que les obligations vertes et sociales, les financements mixtes et les fonds climatiques, doivent être rendus accessibles aux pays à faible revenu.
- la mise en place des dispositifs de réduction et de restructuration de la dette qui sont nécessaires pour libérer des marges de manoeuvre budgétaires au profit des dépenses sociales.
- l’insauration de mécanismes coopératifs pour l’allègement et la restructuration de la dette. Cela permettra de remédier à la dette insoutenable qui évince les dépenses sociales.
- la mise en place de partenariats public-privé pour l’inclusion afin de cofinancer les infrastructures sociales: l’éducation, la santé et l’accès au numérique.
Il faut renforcer les capacités par des plateformes de recherche communes pour permettre une collaboration accrue en matière d’adaptation au changement climatique, de sécurité alimentaire et de numérisation inclusive. Il faut renforcer la coopération Sud-Sud et triangulaire, afin d’échanger les expériences entre pays en développement, avec l’appui d’institutions multilatérales. Les programmes de mobilité de la main-d’oeuvre gérés par le biais de partenariats de compétences profiteront à la fois aux pays d’origine et aux pays d’accueil.
Il est essentiel de réformer les institutions mondiales telles que la Banque mondiale, le Fonds monétaire international et l’Organisation mondiale du commerce afin de donner aux économies en développement une voix plus forte au sein de ces institutions.
Que devraient faire les pays africains ?
La Chine, l’Inde et d’autres puissances de l’Est se sont imposées comme de véritables rivales de l’Occident, tant sur le plan économique, militaire que dans le domaine de la gouvernance mondiale. Dans ce nouveau paysage, l’Afrique occupe une position centrale. Elle a la possibilité de devenir un acteur majeur de la future économie mondiale.
Plusieurs priorités s’imposent, surtout pour la prochaine décennie.
La première consisterait à mettre en place une infrastructure numérique et à renforcer les capacités technologiques et d’intelligence artificielle. Ces éléments sont devenus des moteurs essentiels de la compétitivité. Sans infrastructures ni compétences, les pays restent confinés au rôle de fournisseurs de matières premières.
Les pays africains devraient donc :
- adopter une stratégie nationale en matière de haut débit et de centres de données (public-privé), et des mesures incitatives pour attirer la construction de centres de données régionaux;
- investir davantage dans les formations en sciences, technologie, ingénierie, mathématiques et intelligence artificielle. Citons par exemple les bootcamps accélérés, les TIC dans les écoles secondaires et le soutien aux start-ups locales spécialisées dans l’IA.
Deuxièmement, les gouvernements doivent continuer à garantir les investissements dans les infrastructures numériques, telles que la fibre optique, les réseaux 5G et les centres de données. Ils pourraient éventuellement tirer part de la Route de la soie chinoise numérique, qui promeut des alternatives technologiques abordables.
Troisièmement, l’Afrique du Sud et les autres pays africains doivent donner la priorité à l’inclusion économique et au développement durable. Pour ce faire, il faut instaurer un développement économique inclusif. Cela devrait être le moteur principal de leur stratégie de développement.
Quatrièmement, les gouvernements africains doivent manoeuvrer de manière stratégique entre les changements géopolitiques et les alliances. Ils constituent des sphères d’influence clés dans la concurrence numérique entre les États-Unis et la Chine, et devraient utiliser cette position à leur avantage. Pour ce faire, les gouvernements africains devraient :
- utiliser leur appartenance au Brics+ de manière coordonnée pour faire progresser leurs intérêts nationaux;
- favoriser la coopération Sud-Sud en renforçant le commerce, les transferts technologiques et les alliances financières avec d’autres pays en développement d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine. Il convient ainsi de mettre davantage l’accent sur des initiatives telles que le Forum sur la coopération sino-africaine.
- renforcer la diplomatie commerciale et diversifier les marchés afin de pouvoir vendre davantage de biens et de services sur les marchés asiatiques, européens et intra-africains;
- maximiser les investissements extérieurs en obtenant des investissements, des infrastructures et des partenariats numériques tant des États-Unis que de la Chine. Cela permettra aux pays africains de tirer parti de la concurrence technologique mondiale.
Arno J. van Niekerk, Senior lecturer in Economics, University of the Free State