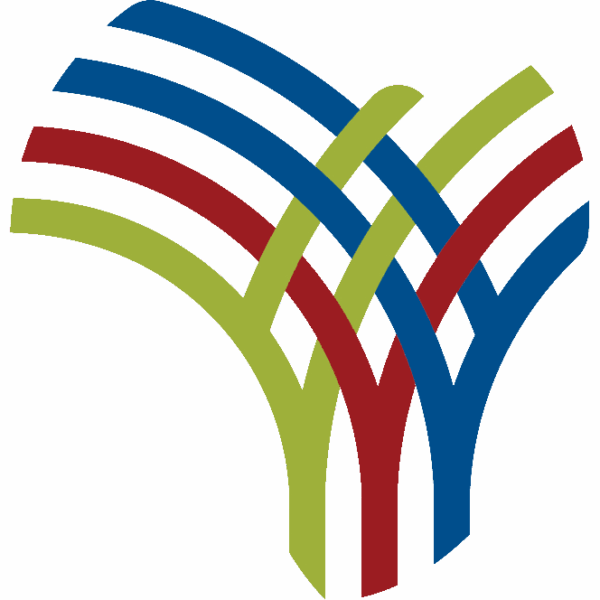Ile Maurice: Un souffle de mémoire

Nous sommes allés à la rencontre de Kawthar Jeewa, doctorante en architecture et artiste-chercheuse, parce que sa manière de parler des maisons créoles ne relève pas simplement du patrimoine.
C’est une invitation à repenser notre lien avec ce qui fait l’âme même de l’île Maurice. À travers son regard, ces maisons ne sont pas de simples bâtisses en bois et en pierre volcanique. Elles respirent, vieillissent, abritent des générations. Elles racontent des histoires de résistance, d’ingéniosité et de communauté. Pour Kawthar, préserver ces demeures, c’est préserver un art de vivre celui d’une société métissée, tissée de mémoire et de savoir-faire ancestral.
Adaptation au climat
«Les maisons créoles ne sont pas seulement des bâtiments anciens, mais des rappels vivants de qui nous sommes», explique Kawthar Jeewa, qui mène actuellement son doctorat à la Nelson Mandela University, en Afrique du Sud. Selon elle, ces maisons, façonnées par des siècles de rencontres entre cultures africaines, asiatiques et européennes, sont bien plus que de simples témoins d’un passé révolu.
Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn
Elles incarnent l’histoire d’une adaptation réussie à un climat tropical exigeant, et d’une société créative, capable d’allier beauté et intelligence. «Ce sont des maisons construites pour durer, avec une compréhension fine du climat. Les ancêtres ont conçu des habitations à la fois solides et respirantes, qui s’ouvraient sur la nature et sur la vie sociale», raconte-t-elle. Kawthar confie aussi sa relation personnelle à ce patrimoine : «À travers les récits de mes grands-parents, je revis les époques où les maisons n’avaient pas de clôtures, où les voisins entraient librement, où chaque cour abritait des rires, des repas partagés et des veillées.»
Ces demeures, ajoute-t-elle, «portent encore aujourd’hui les traces d’une histoire faite de luttes, de survie, mais aussi de solidarité. Elles incarnent la mémoire d’un peuple.»
Une architecture du souffle et de la lumière
L’architecture créole se reconnaît au premier regard, mais elle se comprend surtout dans ses détails. Le socle en pierre volcanique, solide et sobre, élève la maison au-dessus du sol humide ; les poteaux en bois, finement taillés, soutiennent un toit pentu recouvert de bardeaux ou de tôle ondulée. «Tout dans la conception d’une maison créole est pensé pour le climat», explique Kawthar.
«Les fenêtres à persiennes permettent à la lumière de filtrer sans laisser entrer la chaleur. Les vérandas protègent de la pluie et deviennent des lieux de vie.» Elle parle de ces matériaux avec une tendresse presque poétique : «Le bois, la pierre, le chaume… ils respirent. Ils se dilatent, se contractent, vivent au rythme du temps. Une maison créole n’est jamais figée.»
Cette harmonie entre architecture et nature crée une atmosphère singulière. «Quand on entre dans une maison créole, on ressent immédiatement une sensation de bien-être. L’air circule, la lumière danse sur les murs. C’est une architecture du souffle, de la respiration.» Pour elle, la beauté de ces maisons ne réside pas dans la symétrie ou la perfection, mais dans leur capacité à vieillir avec grâce. «Elles vieillissent comme les êtres humains: avec leurs cicatrices, leurs marques du temps, mais une dignité que le béton ne pourra jamais reproduire.»
Le péril silencieux
Pourtant, ces demeures sont aujourd’hui menacées. À Port-Louis, la pression immobilière fait grimper la valeur des terrains au point que beaucoup préfèrent raser plutôt que restaurer. «Les maisons créoles et les familles qui y vivent sont de plus en plus fragilisées», souligne Kawthar. «Le coût de l’entretien est élevé, les assurances rares, et les politiques publiques manquent de volonté.»
Elle décrit aussi les effets du climat : cyclones plus intenses, humidité persistante, pluies qui infiltrent les toitures anciennes. «Chaque année, des pans entiers de notre mémoire tombent sous le poids des intempéries.» Mais pour Kawthar, la disparition la plus grave est invisible : celle du tissu social. «Quand les maisons deviennent des restaurants ou des bureaux, on perd plus qu’un toit. On perd un mode de vie, des gestes, des traditions. Le voisinage change, la convivialité s’efface. Et peu à peu, la ville se vide de son âme.» Elle évoque avec tristesse cette gentrification silencieuse, qui transforme les quartiers populaires en vitrines touristiques : «Les maisons créoles ne sont pas faites pour être figées derrière des vitrines. Elles sont faites pour vivre, pour être habitées.»
Préserver sans figer Restaurer une maison créole, selon Kawthar, c’est avant tout un acte de respect. «L’authenticité, ce n’est pas copier le passé, c’est comprendre son esprit et le prolonger.» Elle plaide pour une restauration qui allie tradition et adaptation : réparer avec du bois local, maintenir les méthodes anciennes du bardottier, tout en intégrant des solutions modernes face aux risques climatiques.
«Il faut trouver un équilibre entre la mémoire et le présent. Une maison peut être authentique tout en étant adaptée à la vie d’aujourd’hui.» Elle regrette toutefois que certaines rénovations se limitent à une imitation de façade : «Beaucoup habillent des murs en béton d’un décor en bois. Le résultat est joli, mais vide. L’intérieur ne respire plus. La maison a perdu son âme.» Son appel est clair : valoriser le travail des artisans, charpentiers et menuisiers qui maîtrisent ces techniques anciennes. «Ces savoirs sont des trésors. Ils se transmettent par les mains, pas dans les livres.»
Une conscience à raviver
Au-delà de la recherche, Kawthar Jeewa se veut passeuse de mémoire. «Sans une prise de conscience collective, aucune politique ne peut sauver ces maisons. La sauvegarde commence par l’amour que les gens leur portent.» Elle s’engage à travers des conférences, des ateliers et des publications accessibles au grand public, pour reconnecter les Mauriciens à leur patrimoine.
«Ce n’est pas une nostalgie du passé. C’est un rappel que nos maisons ont quelque chose à nous apprendre : la simplicité, la solidarité, la durabilité… Les maisons créoles sont comme nous : métissées, fragiles, mais profondément vivantes. Il suffit de les écouter respirer pour comprendre pourquoi elles méritent d’être aimées» conclut-elle.
Références : Jeewa, K. and Minguzzi, M., 2024. Research on French colonial architecture from a decolonial lens: the vernacular adaptation of Créole architecture of Port Louis, Mauri- tius. South African Journal of Art History, 39(1), pp.18-38. Jeewa, Kawthar & Minguzzi, Magda (2025). Architectural Memory: Créole Houses as Living Monuments in Port Louis, Mauritius. In C. Mileto, F. Vegas, A. Hueto-Escobar & S. Manzano-Fernández (Eds.) Earthen and Vernacular Heritage: Conservation, Adaptive Reuse and Urban Regeneration. September 10th -12th, 2025, Valencia (Spain). edUPV.