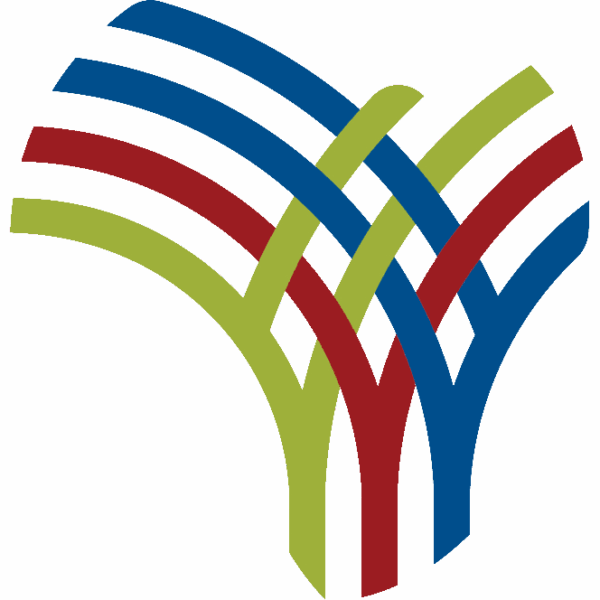Ile Maurice: La bioéconomie tropicale – Un levier d'autonomie et d'innovation pour les îles

L’épuisement des ressources fossiles pousse de nombreux territoires à repenser leurs modèles économiques. Dans les zones tropicales, où la nature offre une grande diversité, la bioéconomie apparaît comme une alternative durable et porteuse d’avenir. Dans ce contexte, Jérôme Vuillemin, docteur en biologie et spécialiste des matériaux biosourcés en zones tropicales, a introduit la bioéconomie tropicale au siège de l’Association des manufacturiers Mauriciens à St-Pierre, le 8 octobre.
Le concept de bioéconomie tropicale est issu du modèle plus large de bioéconomie, né dans le cadre de la transition vers une économie durable, moins dépendante des ressources fossiles. Il regroupe l’ensemble des activités fondées sur la valorisation des ressources biologiques renouvelables – qu’elles proviennent des plantes, des animaux, des forêts ou des milieux marins – pour produire des biens alimentaires, énergétiques ou industriels. Dans les zones tropicales, cette approche prend une dimension particulière.
Jérôme Vuillemin, directeur de Qualitropic, explique que «la bioéconomie, c’est la transformation du vivant en valeur économique. Qu’il s’agisse de ressources terrestres ou marines, l’idée est de les utiliser de manière durable pour créer des activités locales. Prenons un exemple simple : transformer des fruits en confiture, c’est déjà de la bioéconomie. Ce modèle revient sur le devant de la scène parce que les ressources fossiles comme le pétrole, le gaz ou le charbon se raréfient. Nous devons apprendre à mieux utiliser la matière végétale et animale pour répondre à nos besoins.»
Cette vision prend tout son sens dans les territoires tropicaux, où les conditions naturelles offrent un fort potentiel de développement. «Nous n’avons pas beaucoup de ressources énergétiques sur nos territoires – pas de gaz, pas de pétrole et peu de charbon. En revanche, nous disposons d’une grande richesse végétale et marine, ainsi que d’un ensoleillement constant tout au long de l’année», souligne Jérôme Vuillemin. «Cela nous permet de produire une diversité de végétaux et de ressources issues de la mer qu’il faut apprendre à valoriser.»
Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn
Il ajoute que cette spécificité naturelle s’accompagne d’un intérêt croissant à l’échelle mondiale. «Les produits tropicaux suscitent un véritable engouement, aussi bien dans l’agroalimentaire — ananas, coco, vanille — que dans la cosmétique. Les consommateurs sont très attirés par les senteurs et les saveurs venues des tropiques.»
La bioéconomie tropicale touche plusieurs secteurs clés. L’alimentation en constitue le pilier principal, avec pour objectif d’atteindre une véritable souveraineté alimentaire à travers la production agricole, aquacole et la pêche, ainsi que la transformation des produits locaux.
L’un des grands défis, souligne Jérôme Vuillemin, est d’atteindre à la fois la souveraineté alimentaire et énergétique, afin de réduire la dépendance aux importations. Les importations génèrent certes une activité commerciale, mais dès qu’une crise ou un conflit survient, la vulnérabilité du pays apparaît. L’enjeu est donc de produire un maximum localement pour renforcer la compétitivité du territoire, encourager la création d’entreprises et d’emplois, et, à terme, envisager même d’exporter certaines productions.
Le secteur forestier joue également un rôle majeur : la gestion durable des forêts permet de préserver les ressources tout en garantissant leur renouvellement. D’autres filières émergent autour de la valorisation des extraits naturels, utilisés dans la cosmétique, la pharmacie, les produits phytosanitaires ou encore les arômes et colorants. Enfin, la production de matériaux biosourcés – destinés à l’ameublement, à la construction ou au packaging – ouvre la voie à des solutions locales et respectueuses de l’environnement. Dans cette optique, l’enjeu est de promouvoir le juste emballage : choisir le matériau le plus adapté, tout en mettant en place des filières efficaces de récupération, de recyclage et de réutilisation, ou en développant des alternatives compostables lorsque cela est possible.
La bioéconomie tropicale circulaire présente des avantages économiques. L’idée, est d’utiliser des matières présentes localement, sans forcément dépendre d’importations de matières premières de l’extérieur, explique-t-il. Dans un contexte insulaire, comme Maurice et La Réunion cette approche permet de renforcer l’autonomie du territoire. «L’économie insulaire, c’est essayer de tout faire localement, y compris la gestion des déchets qu’on produit. Cela crée de l’activité et de la valeur sur place.»
Au-delà de l’impact économique direct, ce modèle favorise aussi le développement des compétences locales. La mise en oeuvre de ce concept ouvre des perspectives en matière de formation, de sensibilisation des jeunes et d’acquisition de savoir-faire techniques.
Maurice et La Réunion unissent leurs forces pour la bioéconomie tropicale
L’Association des manufacturiers Mauriciens (AMM) et le label Made in Moris sont en partenariat avec Qualitropic, pôle réunionnais reconnu pour son expertise en innovation et en bioéconomie tropicale. Cette collaboration donne naissance au programme Excellence BIOECOI, déployé entre 2025 et 2026 à Maurice et à La Réunion, avec pour objectif de soutenir les entreprises mauriciennes dans l’adoption de pratiques industrielles plus durables et circulaires. Le projet, cofinancé par l’Union européenne et la Région Réunion dans le cadre du programme INTERREG VI, permettra aux industriels d’accéder à des connaissances avancées sur la valorisation des ressources biologiques et le développement d’une industrie plus résiliente et respectueuse de l’environnement.