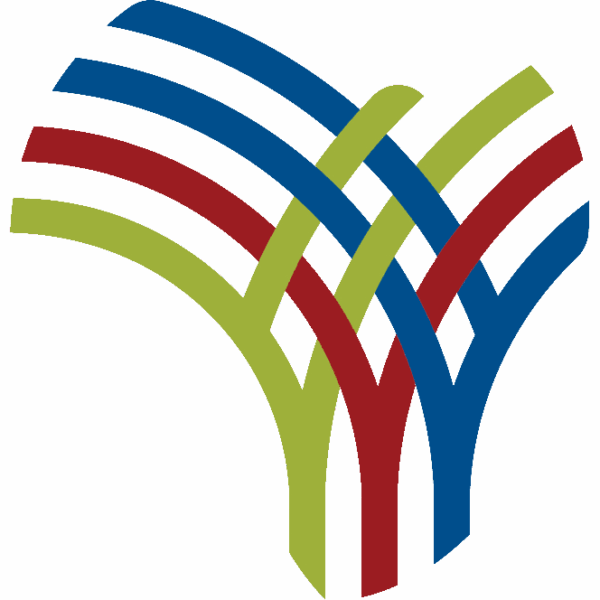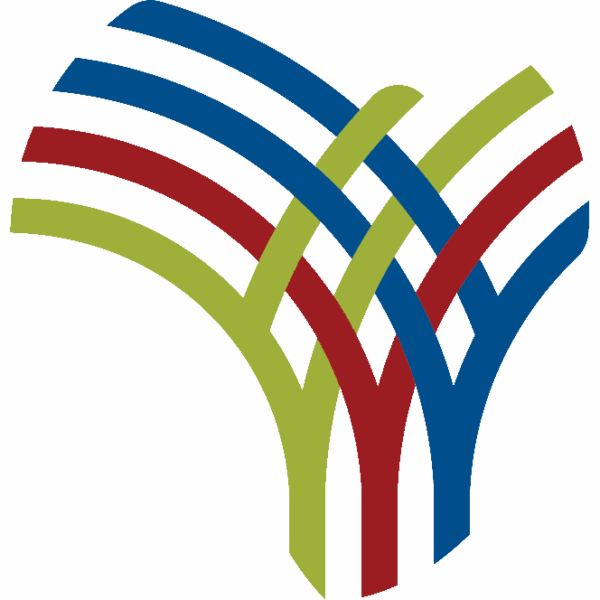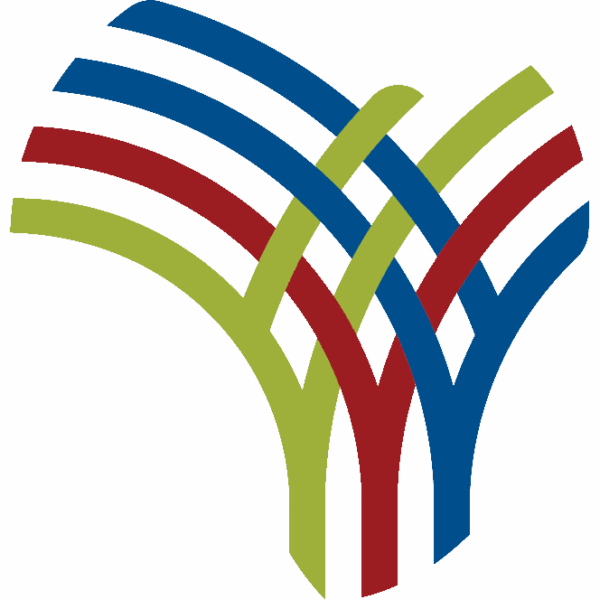Ile Maurice: Le pays dans l'ère du chacun pour soi

Cinquante-sept ans après son Indépendance, ou, plutôt, trois ans avant d’atteindre ses 60 ans, Maurice se découvre nue dans un monde qui n’a plus rien de protecteur. Les filets qui avaient permis à notre économie de se hisser au rang de «miracle africain» – préférences sucrières, quotas textiles, accès préférentiel aux États-Unis – se sont successivement défaits.
L’AGOA vient d’expirer et Washington, DC, sous influence d’un Trump moins conciliant que jamais, n’a pas jugé utile de sauver l’illusion. Ce n’est pas un accident ; c’est un symptôme. Le multilatéralisme s’effrite, le commerce international se renationalise, la géopolitique redevient un marché d’armes, d’influence et de raretés. L’ère du chacun pour soi a commencé !
Pendant quatre décennies, Maurice a tiré parti de niches intelligentes : le protocole sucre garantissait prix et volumes en Europe1 ; l’Accord multifibres protégeait ses usines de textile de la concurrence asiatique2 ; l’AGOA ouvrait le marché américain sans droits de douane3 . Ces béquilles ont fait naître une industrie exportatrice, payé des milliers d’emplois féminins, construit des infrastructures.
Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres
Mais elles ont aussi entretenu une illusion: celle qu’un petit État pouvait s’en sortir en jouant habilement des préférences négociées par d’autres. Les nouvelles règles de l’OMC, la fin des quotas, l’unilatéralisme américain et le retour du protectionnisme climatique (CBAM européen, taxe carbone aux frontières) dissolvent cette illusion. Nous sommes désormais seuls avec nos crises énergétiques et hydriques.
Le choc AGOA agit comme un révélateur brutal : quand les tarifs passent de moins de 1 % à plus de 15 %, nos usines se découvrent fragiles. Marges laminées, commandes déplacées vers le Vietnam ou le Bangladesh, filières entières menacées. Le parallèle avec 2009, quand Bruxelles a dénoncé le Protocole sucre, est cruel : déjà, nous avions tardé à diversifier ; déjà, nous avions cru que la diplomatie suffirait à amadouer les grands. Il n’y a plus d’innocence à perdre : les règles changent sans nous demander notre avis.
La tentation naturelle est de se tourner vers d’autres «sauveurs» – BRICS, Inde, Chine. Illusion dangereuse. Les BRICS sont un club d’intérêts divergents, pas une assurance commerciale. L’Inde et la Chine négocient dur, défendent leurs propres champions, pratiquent un capitalisme d’État qui laisse peu de place aux outsiders. Quant à l’Afrique, elle bâtit sa Zone de libre-échange continentale, mais les routes restent imparfaites, les normes incertaines, les coups de force politiques fréquents.
L’urgence est d’abandonner la nostalgie pour une diplomatie économique lucide, offensive et «multi-hubs». D’abord, cesser de vivre sous perfusion américaine : tout sursis AGOA doit être traité comme un bonus, non comme une stratégie.
Ensuite, accélérer la diversification : l’Europe reste notre premier débouché et investit dans des chaînes «vertes» – à nous d’y greffer textile technique, sucre durable, rhum premium, niches agro-industrielles. L’Afrique est notre arrière-cour naturelle : SADC et ZLECAf (Zone de libre-échange continentale africaine) offrent un socle, mais il faut arbitrer – choisir un bloc, bâtir des corridors logistiques, sécuriser nos approvisionnements. Avec l’Inde et la Chine, miser sur des co-investissements ciblés, pas sur des chèques en blanc.
Cette diplomatie doit être commerciale mais aussi industrielle : négocier les règles d’origine, exiger la réciprocité sur la propriété intellectuelle, sécuriser nos câbles sous-marins, nos données et nos financements. Le jeu n’est plus celui du tarif seul, mais des normes, de la technologie et de la sécurité. Ici, la question se renverse : comment Maurice devient-elle utile aux autres pour justifier sa place dans la chaîne de valeur ?
Remonter la chaîne, c’est sortir de la simple confection pour devenir designer, intégrateur, propriétaire de marques, fournisseur de services numériques liés à l’industrie. Certes, il n’y a pas de baguette magique mais nos entreprises doivent oeuvrer pour mettre de l’Intellectual Property dans leurs produits : tissus techniques, workwear, micro-collections, packaging durable, traçabilité blockchain.
Dans l’agro, aller au-delà du sucre brut : sucres spéciaux, énergie bagasse, rhum millésimé, additifs bio-sourcés. Dans les services, capitaliser sur notre bilinguisme, notre droit hybride, nos fintechs. La «petite île» n’a jamais été un handicap quand elle est agile et créative.
Mais l’État doit cesser d’être suiveur. Notre diplomatie ne peut être que crédible si elle est adossée à un appareil économique cohérent : un environnement réglementaire stable, une stratégie claire pour les terres agricoles et les énergies renouvelables, une politique industrielle qui soutient la montée en gamme et surtout une présence diplomatique offensive – pas des chancelleries endormies ou des ambassadeurs hors du jeu.
Maurice doit aussi clarifier ses appartenances. Peut-on continuer à appartenir à tout et à rien – COI, SADC, COMESA, Commonwealth, Francophonie – sans hiérarchiser ? L’OMC, dépassée comme jamais par Trump, impose de choisir un cadre unique de libre-échange : notre hésitation devient-elle un handicap stratégique ? Faut-il un ancrage fort, assumé, une dispersion symbolique… Rien n’est sûr.
L’indépendance d’un pays comme le nôtre ne se mesure plus aux drapeaux ni aux hymnes, mais à la capacité de se protéger dans un monde instable. Le nationalisme économique de Trump, la démondialisation verte de l’UE, la poussée chinoise, l’excès de cadeaux de l’Inde, l’empathie du Japon surtout après le Wakashio, l’incertitude africaine – tout cela impose un réalisme sans cynisme. «Petit, agile, intelligent» : voilà le seul modèle viable. L’illusion des préférences est morte ; reste la compétence.
Il ne s’agit pas de désespérer, mais de grandir. Maurice a déjà surmonté des chocs : fin du sucre garanti, effondrement de quotas, crises financières. Chaque fois, elle a su inventer des réponses hybrides. Mais la donne est plus rude : la géopolitique n’est plus cordiale, la mondialisation n’est plus prévisible. Il est temps de jouer adultes en tournant de nouvelles pages.
Notes :
¹ Protocole sucre (1975-2009) – prix et quotas garantis par l’UE pour les producteurs ACP.
² Accord multifibres (1974-2005) – quotas protégeant le textile mauricien de la concurrence asiatique.
³ AGOA (2000-2025) – accès préférentiel aux États-Unis pour des milliers de produits africains.