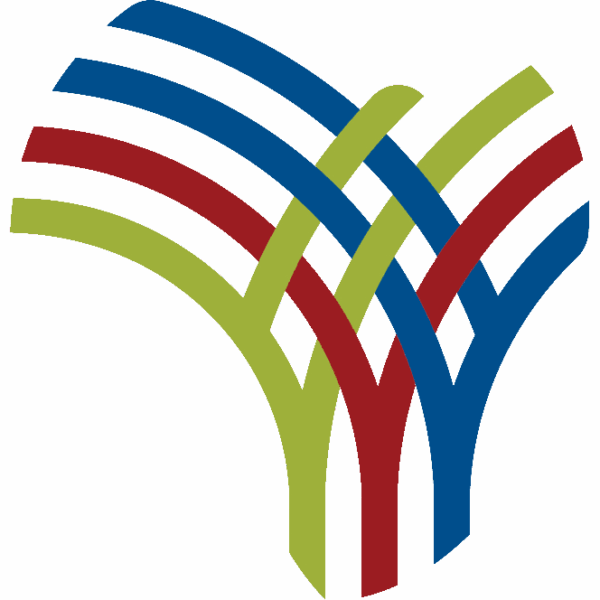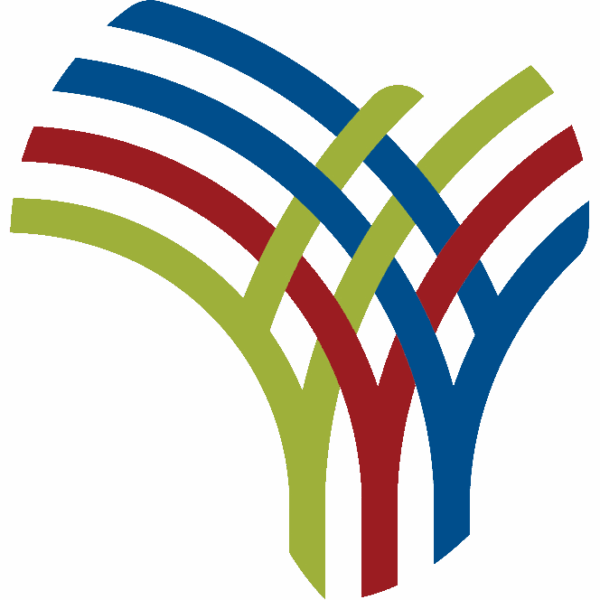Ile Maurice: Un rééquilibrage global mais des secteurs clés sous pression

Derrière la hausse des prix à l’exportation et la baisse à l’importation se cachent des défis persistants pour plusieurs secteurs clés. Le textile doit faire face à une demande en recul et à un déficit de visibilité sur les marchés internationaux ; le sucre subit les effets de conditions climatiques défavorables et d’une production limitée, tandis que le thé est fragilisé par le vieillissement des planteurs et des plantations. Ces contraintes mettent en lumière la nécessité de préserver la qualité et la valeur ajoutée des filières mauriciennes tout en s’adaptant aux incertitudes du marché.
Au deuxième trimestre de 2025, l’économie du pays a enregistré un rééquilibrage de ses échanges commerciaux. Selon Statistics Mauritius, les prix à l’exportation ont progressé de 1,5 %, tandis que ceux à l’importation ont reculé de 2,8 %, entraînant une amélioration des termes de l’échange, qui sont passés de 102,5 au premier trimestre à 107,0, soit une hausse de 4,4 %. Par rapport au deuxième trimestre de 2024, l’indice des termes de l’échange a progressé de 8,4 %.
L’Export Price Index (EPI) atteint 166,9 points, soutenu par les produits alimentaires et animaux vivants (+2,3 %) et les articles manufacturés divers (+0,9 %). Les produits de la mer, le sucre, l’habillement, les montres et instruments scientifiques ont tiré les prix vers le haut. La section Food and live animals, représentant 40,6 % de l’indice, progresse de 2,3 %, portée par le poisson (+3,1 %) et le sucre (+2,3 %).
Les Miscellaneous manufactured articles enregistrent un gain de 0,9 %, notamment dans l’habillement (+0,5 %), la photographie et l’optique (+6,5 %) et les instruments scientifiques (+4,1 %). Du côté des importations, l’Import Price Index (IPI) recule à 156 points (-2,8 %), principalement en raison de la baisse des prix des combustibles (-6,9 %). Les produits alimentaires importés restent stables, avec des hausses pour les produits laitiers (+3,6 %) et le poisson (+1,2 %), mais une forte baisse pour les fruits et légumes (-13 %) et les aliments pour animaux (-8 %).
Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres
Textile
Cependant, derrière ces chiffres positifs, le textile, pilier historique des exportations mauriciennes, continue de faire face à des difficultés structurelles. Selon Ajay Beedassy, président de la SME Chamber, et entrepreneur dans ce domaine, la demande des exportations observe une baisse avec des diminutions de chiffre d’affaires pouvant atteindre 80 à 90 % sur certains marchés comme l’Afrique du Sud, où la production locale est désormais favorisée. En Europe, la pandémie a conduit les importateurs à se tourner vers des fournisseurs de proximité, plus compétitifs en termes de coûts et de délais de livraison.
Ajay Beedassy souligne également un déficit de visibilité internationale. «Nous ne participons pas suffisamment aux salons internationaux, alors que nos concurrents y sont très présents.» Ce manque de présence s’accompagne d’une faiblesse en marketing et en promotion de la destination textile mauricienne, empêchant de valoriser le savoir-faire local auprès des acheteurs étrangers. Pour les PME, l’absence de financement pour ce type d’actions constitue un frein majeur.
Un marketing efficace, ajoute-t-il, est essentiel pour diversifier les marchés et faire face aux incertitudes liées à l’exportation vers les États-Unis en franchise de droits. La dépendance à quelques marchés traditionnels, combinée au coût élevé de la main-d’oeuvre et des matières premières importées, limite la compétitivité du secteur. Face à la montée en puissance de concurrents, qui bénéficie d’un coût du travail plus bas ou qui dispose de ses propres matières premières, les entreprises locales tentent de se maintenir grâce à la production de niche et de haute qualité.
Sucre
Si le contexte global favorise les exportateurs mauriciens, le secteur sucrier reste aussi confronté à des défis importants. La récolte en cours est marquée par des conditions climatiques défavorables, avec une production estimée à 220 000 tonnes par la Chambre d’agriculture. Selon Devesh Dukhira, Chief Executive Officer du Mauritius Sugar Syndicate (MSS), cette estimation pourrait être révisée à la baisse, soit une diminution d’au moins 20 000 tonnes par rapport aux deux dernières années, limitant la marge de manoeuvre du MSS pour maximiser la valeur de la production.
Pour cette campagne, Devesh Dukhira prévoit la vente d’environ 125 000 tonnes de sucres spéciaux, le reste étant destiné à la production de sucre raffiné. Le bulletin hebdomadaire de la Chambre d’agriculture indique un taux d’extraction de 8,94 % au 20 septembre, soit environ 1 % de moins qu’en 2024, traduisant une baisse de 10 % dans la production globale.
Il souligne que cette diminution impacte l’efficacité économique et réduit la flexibilité pour cibler les marchés les plus rémunérateurs, sans affecter la qualité du sucre, qui reste contrôlée au niveau des sucreries. Il insiste sur l’importance de livrer des cannes propres pour garantir l’efficience de l’usinage et la qualité du produit final.
Face à cette baisse de production, la priorité du MSS est de préserver les ventes les plus lucratives, notamment les sucres spéciaux destinés à l’Europe et aux États-Unis. Les livraisons devraient atteindre respectivement 88 000 et 11 000 tonnes, contre 84 000 et 13 500 tonnes pour la campagne précédente, sachant que les exportations vers les ÉtatsUnis sont limitées à un contingent annuel.
En revanche, les ventes de sucre raffiné, particulièrement sur le marché régional, devront être réduites. Le raffinage réalisé par Omnicane, combinant sucre roux importé et sucre local, permet d’accroître la production de sucre blanc et de maintenir la part de marché dans certaines destinations. Ces ventes additionnelles, conformes aux règles d’origine, peuvent atteindre jusqu’à 100 000 tonnes annuellement.
Le MSS et les autorités mettent en avant l’urgence de stopper la baisse de production et d’atteindre l’objectif de 300 000 tonnes fixé par le ministère de l’Agroindustrie, afin de restaurer les avantages concurrentiels de Maurice. Bien que l’impact climatique échappe au contrôle des producteurs, des consultations sont en cours pour remettre en culture plus de 10 000 hectares de terrains abandonnés. Des soutiens financiers pour la replantation de la canne et des subventions sur les fertilisants sont également prévus pour améliorer l’efficience sur le terrain.
Devesh Dukhira rappelle que la compétitivité dépend d’une production suffisante et d’une gestion efficace des champs et usines. La main-d’oeuvre reste un défi majeur, mais des mesures d’importation de travailleurs ont été annoncées par le gouvernement pour pallier ce manque. Enfin, il considère que les marchés sont suffisamment diversifiés, avec une forte proportion de sucre à valeur ajoutée, incluant les sucres spéciaux et le sucre blanc spécialisé pour boissons ou usage extra fin. L’enjeu est désormais de répondre à cette demande de manière compétitive, malgré les contraintes de production actuelles.
Thé
À l’image de la canne à sucre, le thé connaît aussi un net recul à Maurice. Les chiffres de Statistics Mauritius sur la production agricole sont révélateurs : malgré une superficie de culture maintenue à 623 hectares, la production de feuilles de thé vert a chuté de 8,6 % pour s’établir à 3 030 tonnes, tandis que celle du thé manufacturé a reculé de 14,1 %, atteignant seulement 530 tonnes.
Pour Manilall Dhoboj, secrétaire général de la Grand-Port/Savanne Tea Cooperative Federation, l’industrie traverse une période difficile marquée par de multiples défis. Le plus urgent est le vieillissement des planteurs : nombre d’entre eux approchent ou dépassent l’âge de la retraite et l’absence de relève générationnelle fragilise la pérennité du secteur. Les jeunes, attirés par des métiers jugés plus lucratifs ou moins contraignants, se détournent de la culture du thé, accentuant la pénurie de main-d’oeuvre et entraînant l’abandon progressif de certaines plantations, devenues trop coûteuses à entretenir.
S’ajoute à cela l’âge avancé des théiers. Beaucoup de plantations, souligne-t-il, voient leur rendement décliner saison après saison. Le renouvellement est indispensable, mais il représente un pari risqué : une nouvelle plantation nécessite environ cinq ans avant d’atteindre la pleine production, période durant laquelle les planteurs doivent assumer les frais à l’entretien, sans rentrée d’argent. Pour les exploitants aux moyens limités, un tel investissement est difficilement envisageable.
Le changement climatique accentue ces difficultés : hausse des températures, irrégularité des pluies et multiplication des phénomènes extrêmes perturbent les cycles de croissance des théiers, réduisent leur productivité. Résultat : la récolte nationale s’amenuise, compromettant l’avenir de la filière.
Cette tendance est d’autant plus préoccupante que le thé représente non seulement une activité agricole, mais aussi une part du patrimoine culturel mauricien. Jadis fleuron d’exportation et source d’emplois pour des milliers de familles, le secteur théier risque, selon Manilall Dhoboj, de perdre encore davantage de sa vitalité si rien n’est fait.