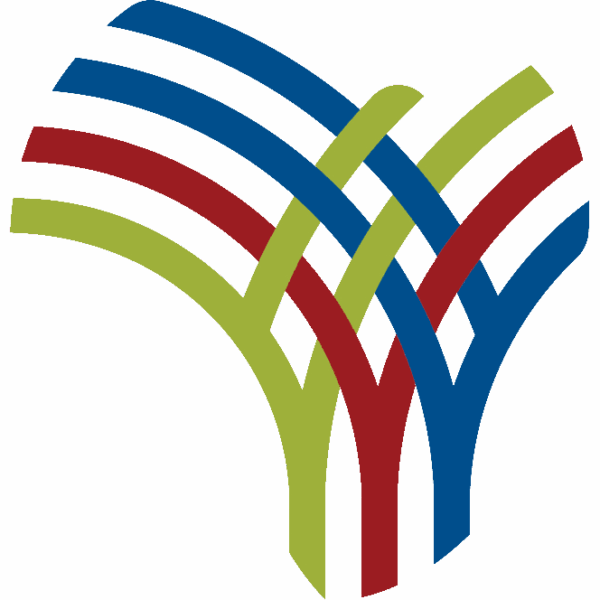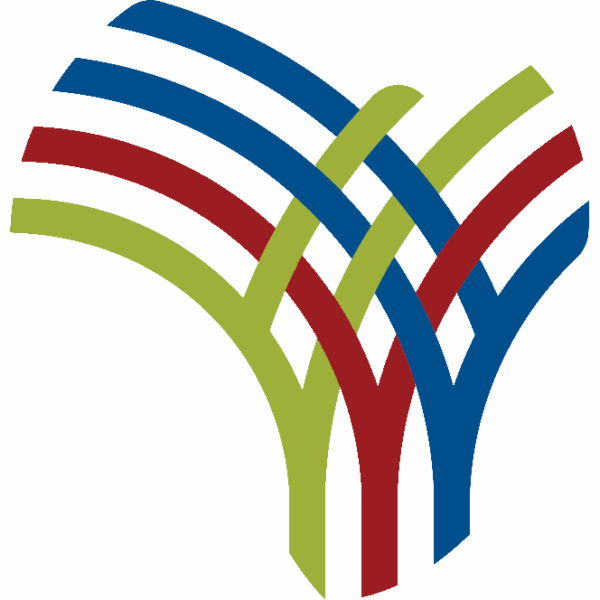Congo-Kinshasa: Démission du président de l'Assemblée nationale

Le président de l’Assemblée nationale de la République démocratique du Congo (RDC), Vital Kamerhe, a finalement jeté l’éponge, hier, 22 septembre 2025. Avait-il le choix ? On en doute fort.
En effet, une pétition avait été lancée contre lui et devrait être mise en vote. C’est dire si l’homme a pris les devants. Et c’est tant mieux. Car, en démissionnant ainsi, Vital Kamerhe évite une humiliation certaine. En politicien averti, Kamerhe savait que son sort était scellé car plus de la moitié des cinq cent députés avait signé la pétition y compris ceux de l’UDPS, le parti au pouvoir.
Les griefs retenus contre le désormais ex-occupant du perchoir, sont aussi divers que variés. Il lui est notamment reproché un manque de transparence dans sa gestion, le retard ou le blocage présumé du contrôle parlementaire, des arriérés de plusieurs mois dans les frais de fonctionnement de l’institution et une couverture médicale inadéquate pour les élus.
Des accusations balayées du revers de la main par les partisans de cet allié historique du président Tshisekedi, qui se retrouve une fois de plus sous les feux des projecteurs. Et ce, après son retentissant procès qui lui avait valu une condamnation en 2020, alors qu’il occupait les fonctions de Directeur de cabinet du chef de l’Etat. Il aura fallu la Cour de cassation pour annuler sa condamnation en appel, le tirant ainsi du pétrin de la peine de treize ans de prison qui avait été prononcée à son encontre.
Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres
Cette démission de Vital Kamerhe paraît comme un aveu de culpabilité
Mais cette fois-ci, l’homme politique n’a pas échappé à son destin, pourrait-on dire. Et il gagnerait à se remettre en cause, ce d’autant que ce n’est pas la première fois qu’il démissionne de son poste de président de l’Assemblée nationale. Et quoi qu’on dise, cette démission de Vital Kamerhe paraît comme un aveu de culpabilité. Certes, le leader de l’UNC (Union pour la nation congolaise) et ses partisans voient derrière cette affaire qui l’a contraint à la démission, « un règlement de comptes » politiques.
Pour eux, les accusations des pétitionnaires sont « sans fondement ». Car, il est de notoriété publique que le budget de l’Assemblée nationale a connu une forte réduction, rendant difficile son fonctionnement, et empêchant toute augmentation des émoluments et autres avantages. La question qui se pose alors est de savoir qui en veut au président de l’Assemblée nationale au point de le pousser à abandonner son fauteuil.
La question est d’autant plus justifiée que dans le contexte actuel de crispation au niveau de l’Exécutif sur fond de crise persistante dans l’Est du pays, tout porte à croire que le contrôle de l’Assemblée nationale est devenu un sujet d’enjeu majeur en RDC où la majorité au pouvoir, l’Union sacrée de la nation (USN), est constituée d’une coalition hétéroclite de partis et « rassemblements » politiques autour du président Félix Tshisekedi. Toujours est-il que l’Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS), le parti présidentiel, a tenu à clarifier la situation en affirmant ne pas être à l’origine de la pétition même si elle est aussi portée par ses élus.
En tout état de cause, ces mouvements de défiance aussi bien à l’Assemblée nationale qu’au Sénat dont le président, Jean-Louis Sama Lukonde, est aussi visé par la même pétition, ne sont pas loin de traduire un profond malaise au sein des institutions législatives en RDC. Et le fait que cela émane d’élus de la majorité au pouvoir, semble symptomatique des guerres souterraines qui s’y mènent.
Lesquelles pourraient être préjudiciables à la cohésion de l’Union sacrée et à l’équilibre de la majorité parlementaire. C’est dire si au-delà de ces pétitions qui ont déjà produit des effets, il appartient au président Félix Tshisekedi de savoir fédérer les énergies de ses soutiens à l’effet de les recentrer autour des priorités nationales, au risque de fragiliser davantage son pouvoir face à une adversité de plus en plus grandissante. La RDC n’a pas besoin d’ajouter une crise institutionnelle à la crise sécuritaire à l’Est, qui met déjà le pays à rude épreuve.