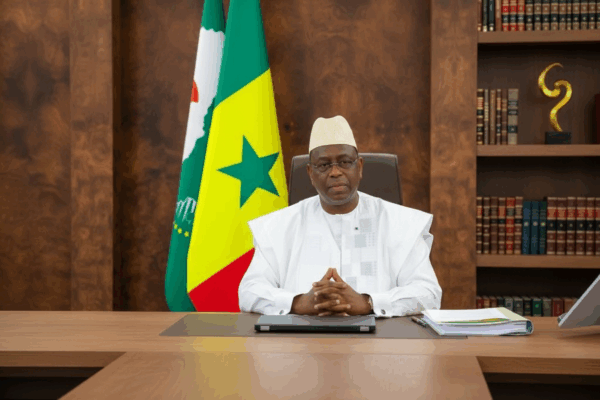Togo : Que faut-il retenir de l’arrestation de Marguerite Gnakadè ?
L’arrestation de Marguerite Gnakadé, ancienne ministre togolaise des Armées, suscite de vives réactions et relance les discussions sur la justice, la démocratie et la stabilité politique du pays. Dans ce contexte marqué par une forte charge émotionnelle, il importe de revenir sur les faits pour permettre un débat plus serein.

L’arrestation de Marguerite Gnakadé, ancienne ministre togolaise des Armées, suscite de vives réactions et relance les discussions sur la justice, la démocratie et la stabilité politique du pays. Dans ce contexte marqué par une forte charge émotionnelle, il importe de revenir sur les faits pour permettre un débat plus serein.
Nommée en octobre 2020, Marguerite Gnakadé avait marqué l’histoire en devenant la première femme ministre des Armées du Togo. Mais deux ans plus tard, en décembre 2022, elle avait été relevée de ses fonctions lors d’un remaniement gouvernemental. Le ministère des Armées avait alors été rattaché directement à la présidence de la République, mettant fin à son mandat. Ce limogeage, qui n’avait pas été motivé publiquement par des accusations pénales, démontrait déjà qu’elle n’était pas protégée par un quelconque statut privilégié, contrairement à ce que certains affirment aujourd’hui. L’épisode s’inscrivait plutôt dans un ajustement politique et institutionnel, confirmant qu’aucune fonction publique n’immunise contre les décisions de l’État.
Son arrestation en septembre 2025 intervient donc dans un tout autre cadre. Selon plusieurs sources, elle est liée à des prises de parole publiques appelant à la démission du chef de l’État et à l’intervention de l’armée dans le cadre des manifestations. Ces propos, interprétés comme des incitations possibles à l’insurrection ou à la désobéissance militaire, constituent la base de l’enquête en cours. Il ne s’agit donc pas de son appartenance à l’opposition politique ni de sa participation au débat démocratique, mais bien de propos susceptibles de relever d’atteintes à la sûreté de l’État. Les précisions officielles sont désormais attendues du procureur de la République, seul habilité à détailler les faits reprochés.
L’émotion et l’emballement qui entourent cette affaire tiennent surtout aux prises de parole rapides de certains groupes d’opposition. Ceux-ci, parfois relayés par les réseaux sociaux, cherchent à imposer un jugement médiatique avant que la justice n’ait pu établir les faits. Dans un Togo où la vie politique avait retrouvé un climat d’apaisement, après que des discours alarmistes aient tenté de présenter le pays comme au bord de l’implosion, cette nouvelle séquence rappelle combien les tensions peuvent être réactivées. Les réalités observées ces derniers mois montraient au contraire une société globalement revenue au calme, mais il est clair que des forces de déstabilisation, parfois alimentées de l’extérieur, continuent de chercher à fragiliser ce retour à la stabilité.
Il est donc essentiel de rappeler que dans un État de droit, la présomption d’innocence doit s’appliquer à tous et que l’égalité devant la loi reste la garantie première pour chaque citoyen. Ni protection spéciale, ni condamnation anticipée : seule la justice doit trancher, dans le respect des règles et des procédures. Les débats politiques et les divergences d’opinion sont le propre d’une démocratie vivante, mais ils doivent s’appuyer sur des faits et non sur des insinuations ou des rumeurs.
Au-delà du cas personnel de Madame Gnakadé, cette affaire met en lumière un enjeu fondamental : la nécessité pour chacun, qu’il soit citoyen, responsable politique ou acteur médiatique, de contribuer à un débat démocratique responsable et apaisé. Le Togo a tout à gagner à ce que la justice suive son cours en toute indépendance et que les institutions continuent de fonctionner dans la transparence. L’équité, l’égalité de traitement et le respect des procédures ne sont pas seulement des principes abstraits : ils sont la condition de la confiance collective et du vivre-ensemble.