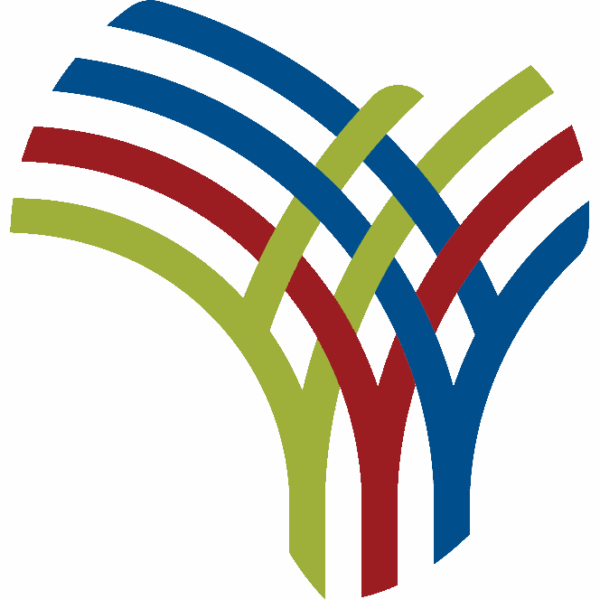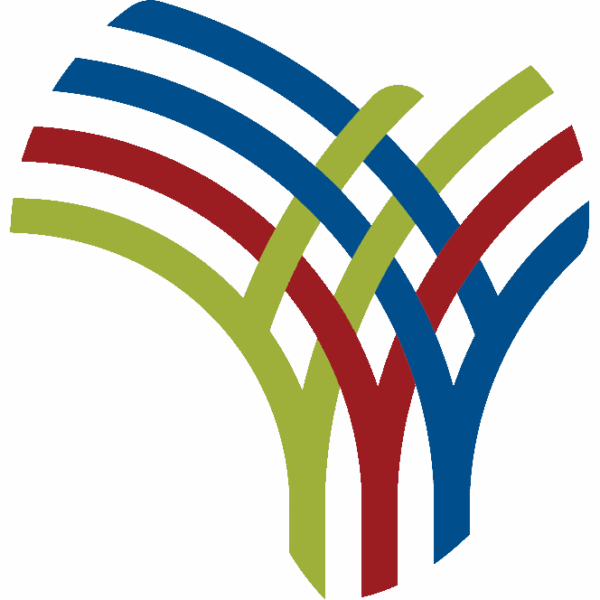Afrique de l'Ouest: Le colonialisme et les risques climatiques sont liés – Preuves issues du Ghana et du Sénégal

L’expérience coloniale a profondément transformé les économies et les sociétés, avec des conséquences profondes.
En tant que chercheur intéressé par l’histoire coloniale et son impact sur le développement actuel, j’ai récemment étudié certains aspects de cet héritage à travers une analyse comparative du Sénégal et du Ghana, basée sur des recherches archivistiques antérieures.
Dans cet article, j’explore les liens entre les principales cultures d’exportation coloniales et les formes quotidiennes de vulnérabilité climatique rencontrées dans ces deux pays. Je montre comment les formes d’exploitation qui ont émergé dans le contexte du capitalisme colonial sont liées à la forme et à la répartition inégale des risques climatiques actuels. Ces histoires ont profondément influencé la manière dont les populations sont exposées à des températures record et à des régimes pluviométriques imprévisibles.
Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn
Il est de plus en plus reconnu que la dégradation du climat mondial et la vulnérabilité à ses effets sont profondément enracinées dans l’histoire du colonialisme. Cette reconnaissance s’est même frayé un chemin dans les cercles politiques officiels. Le sixième rapport d’évaluation du GIEC de 2022 (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, l’organe scientifique des Nations unies chargé du climat), par exemple, reconnaît que la vulnérabilité au changement climatique est « souvent rendue plus complexe par des événements passés, tels que l’histoire du colonialisme ».
Mes recherches aident à compléter ce tableau en montrant à quel point ces impacts sont complexes et profondément ancrés.
Répartition inégale
Les personnes les plus exposées à la crise climatique sont souvent celles qui ont le moins contribué à la créer. En tant que région, l’Afrique contribue à environ 4 % des émissions mondiales de CO₂. En effet, certaines estimations montrent que ce n’est qu’au cours de la dernière décennie que l’Afrique a collectivement émis plus de carbone qu’elle n’en stocke dans divers écosystèmes.
Selon l’Organisation météorologique mondiale, les températures en Afrique augmentent plus rapidement que la moyenne mondiale. Selon des estimations récentes, les pertes économiques dues à la chaleur seule ont atteint 8 % du PIB dans une grande partie de l’Afrique entre 1992 et 2013.
Les puissances coloniales ont extrait des richesses se chiffrant en milliers de milliards des peuples et des territoires colonisés. Elles ont continué à le faire après la fin officielle de la domination coloniale. Les pays riches ont brûlé bien plus que leur juste part de combustibles fossiles au cours de ce processus.
Cela signifie que les pays colonisés, dotés d’infrastructures sous-développées et dont les citoyens sont appauvris, ont moins de capacités pour résister et réagir à des conditions météorologiques de plus en plus sévères.
Mais les liens entre le colonialisme et la vulnérabilité climatique ne se réduisent pas à ces indicateurs économiques ou aux seules émissions de carbone.
Les dégâts causés par les modèles économiques de l’époque coloniale
Dans mon article, je montre comment les modes de vie quotidiens spécifiques des populations exposées aux risques climatiques dans les anciens pays colonisés sont également étroitement liés à l’organisation des économies coloniales.
Les économies coloniales du Sénégal et du Ghana étaient dominées par des sociétés commerciales françaises et anglaises. Ces marchands ont profondément remodelé les structures économiques, en particulier au cours des dernières décennies du XIXe siècle et des premières décennies du XXe siècle.
L’une des stratégies utilisées par les marchands britanniques et français consistait à prendre le contrôle du commerce des matières premières (cacahuètes au Sénégal, cacao au Ghana) par le biais de chaînes de dettes. Grâce à des réseaux complexes de courtiers et de négociants, les marchands coloniaux fournissaient aux agriculteurs des intrants agricoles et des biens de première nécessité en échange des récoltes attendues.
Ce système protégeait largement les entreprises européennes contre les risques inhérents à l’agriculture, tels que les intempéries et les parasites.
Ce système a également entraîné un endettement de plus en plus important des agriculteurs locaux. Lorsque les gens devaient emprunter de l’argent ou des biens pour planter leurs cultures et survivre jusqu’à la récolte, cela avait tendance à contraindre les agriculteurs à produire les mêmes cultures pour l’exportation année après année.
Dans les deux pays, cela signifiait que la productivité des agriculteurs avait tendance à baisser au fil du temps en raison des problèmes liés aux parasites et à l’appauvrissement des sols. Souvent, la seule solution pour les agriculteurs, qui dans de nombreux cas avaient déjà vendu leurs récoltes à l’avance, était de cultiver de manière plus intensive.
Cela a eu pour effet d’aggraver à la fois l’endettement et la vulnérabilité aux risques écologiques. Les agriculteurs endettés étaient plus exposés aux mauvaises récoltes et les rendements agricoles étaient souvent réduits, ce qui les obligeait à dépenser de plus en plus pour les intrants. L’intensification des cultures a également accéléré l’érosion des sols et la propagation des parasites.
Le système colonial a également limité les investissements qui auraient pu améliorer la productivité ou offrir une meilleure protection contre les risques climatiques. Au Sénégal, par exemple, la culture coloniale de l’arachide dépendait principalement des eaux de pluie pour son approvisionnement en eau. Les responsables du gouvernement colonial ont rejeté les propositions de construction de systèmes d’irrigation, et les entreprises commerciales qui n’étaient pas directement impliquées dans la culture n’avaient guère d’intérêt à investir.
Les économies postcoloniales ont considérablement changé, mais des éléments importants du système commercial de l’époque coloniale sont néanmoins restés en place. Les principales cultures d’exportation dans les deux pays continuent d’être cultivées par de nombreux petits producteurs, et les moyens de subsistance de nombreuses personnes restent fortement dépendants des cultures commerciales.
Plus important encore, la forme de vulnérabilité climatique reflète étroitement les risques qui sont apparus à l’époque coloniale. La disponibilité imprévisible de l’eau, par exemple, reste l’une des formes les plus pressantes de vulnérabilité climatique dans les régions productrices d’arachides. C’est particulièrement le cas au Sénégal, où la culture de l’arachide reste largement dépendante de la pluie pour son approvisionnement en eau. Il en résulte, comme l’a montré une étude, que les niveaux de pauvreté dans les régions productrices d’arachides restent étroitement liés aux niveaux de précipitations.
Prochaines étapes
La situation n’est pas la même partout. L’un des héritages du colonialisme est qu’il a créé de nouveaux modèles de développement inégal et inéquitable au sein des colonies et entre elles. Dans des pays comme le Kenya et l’Afrique du Sud, la colonisation a entraîné l’installation de populations européennes. Les populations et les communautés africaines ont été déplacées pour faire place à des plantations et des mines. Les luttes pour l’accès à l’eau, pour ne citer qu’un exemple, restent fortement marquées par ces histoires.
Le fait est que l’empreinte du colonialisme sur la crise climatique est profonde et complexe. Le colonialisme ne s’est pas contenté d’extraire des richesses et des ressources. Il a profondément transformé les sociétés, les économies et les relations des populations avec le monde naturel.
Cela signifie que la dette climatique des pays riches envers le reste du monde dépasse la simple valeur des richesses extraites ou le volume de carbone émis. Elle est probablement incalculable et impossible à rembourser.
Nick Bernards, Associate Professor of Global Sustainable Development, University of Warwick